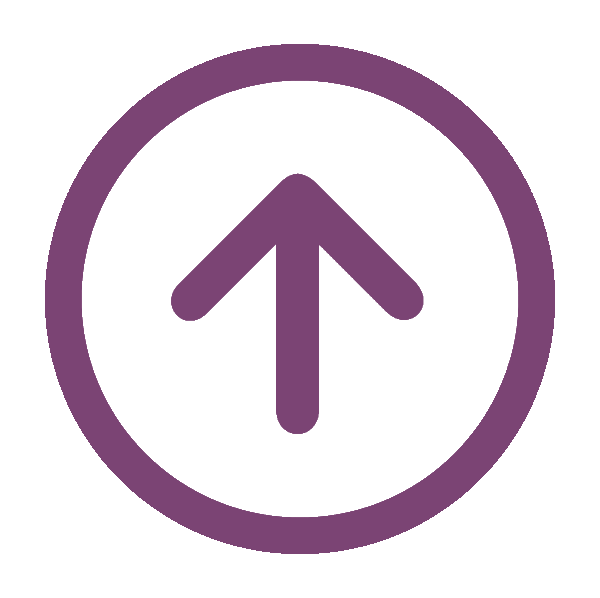Résumé
La pratique de l’expertise psychiatrique pénale garde son objectif initial : évaluer l’état mental des criminels, comme dans l’ensemble des pays comparables, pour confier au soin psychiatrique ceux qui présentent des signes de maladie. La formulation des questions a introduit un distingo entre abolition du discernement et du contrôle des actes (aboutissant à une décision d’irresponsabilité) et altération du discernement ou du contrôle des actes, supposée atténuer le niveau de responsabilité. La diminution du nombre de cas d’irresponsabilité pénale participe à l’augmentation significative du pourcentage de malades mentaux dans les prisons. On constate un nombre croissant de sujets confrontés à la sanction judiciaire ensuite orientés vers le soin psychiatrique. Plus qu’un débat sur les limites entre responsabilité et irresponsabilité du malade criminel, la question est de savoir quelle stratégie, punir ou soigner, est la mieux adaptée à la prévention de futures récidives. Les études en population générale ou clinique démontrent qu’un faible pourcentage de malades psychiatriques ont des comportements violents. Ceux-ci sont du ressort du psychiatre mieux armé pour traiter une pathologie identifiée que pour prédire un comportement ou accompagner des déviances pour lesquelles il n’existe ni preuve d’une maladie évolutive, ni thérapeutique à l’efficacité démontrée. L’éthique du psychiatre impose de faire connaître les progrès de son savoir, des hypothèses physio et psychopathologiques et des thérapeutiques ; elle doit aussi conduire à dire les limites d’une spécialité pour laquelle les examens paracliniques sont encore du domaine de la recherche. Ceci justifie plus de rigueur clinique encore qu’en d’autres champs de la médecine.
Summary
Current situation : in France about 700 psychiatrists are licensed to determine criminal responsibility before the courts, in other words to assess whether a criminal was capable of knowing what he or she was doing or of controlling him or herself. Criminals who are considered irresponsible are committed to psychiatric hospitals. Criminals who are considered to have diminished judgment or control may nonetheless be prosecuted and jailed. Psychiatric experts may also be asked to predict aggressive behaviour, and to identify determinants of crime. Too often the answers are not fully grounded in science, and this is not made sufficiently clear. There are 26 psychiatric wards in French prisons, which only treat inmates who accept to be treated. When prisoners are prescribed compulsory treatment, they are discharged from prison and transferred to a psychiatric ward. This situation is more and more frequent but is not the most convenient : it delays treatment and does not facilitate long-term therapeutic relationships. Responsibility or pragmatism ? About 20 % of French prison inmates are psychotic, and these individuals are at risk of repetitive violent behaviour if left untreated. The main question is not one of criminal responsibility, but rather the most effective response to antisocial behaviour : is punishment or medical treatment the most effective way of preventing future crimes and protecting society ? Ethical aspects : the situation could be improved by a number of measures. For example, training in forensic psychiatry should be obligatory before accreditation before a Court, and psychiatric diagnoses should be based systematically on the ICD10. Psychiatrists have a special duty to inform on advances and uncertainties in their field, in terms of diagnosis, prognosis and treatment.
INTRODUCTION
Les désordres mentaux sont à l’origine de comportements déviants voire antisociaux. Interrogations et controverses persistent pour distinguer les déviances liées à des traits pathologiques de personnalité ou des styles de vie anormaux d’une part et les déviances symptomatiques d’une maladie psychiatrique d’autre part.
État des lieux
Environ sept-cents psychiatres sont inscrits comme experts sur les listes des Cours d’Appel. Avant d’être jugé tout criminel doit bénéficier d’un examen psychiatrique ;
il s’agit de savoir si au moment des faits le sujet était ou non en situation de libre arbitre. Il est en effet admis que certains états mentaux pathologiques abolissent discernement et contrôle des actes. Les questions posées à l’expert psychiatre vont au-delà de cette seule interrogation : désormais il ne s’agit plus simplement de décrire une possible affection psychiatrique mais de dire le lien pouvant exister entre les faits reprochés et l’éventuelle maladie, en un mot de préciser l’imputabilité.
Le juge demande aussi au psychiatre de se prononcer sur :
— les traits de personnalité et leur potentielle évolutivité ;
— l’état de dangerosité du sujet : ceci revient à prédire les risques de comportements violents alors que la psychiatrie n’a guère su établir des critères prédicteurs d’agressivité ou violence [1].
La formulation longtemps retenue pour interroger l’expert psychiatre était : « le sujet présentait-il un état de démence au temps de l’action ? ». La question est désormais : « le sujet était-il au moment des faits soumis à un état altérant ou abolissant discernement et contrôle des actes ? ». En cas d’abolition, on revient à l’état de démence : le sujet est irresponsable, l’affaire classée pour non lieu psychiatrique, le malade orienté vers l’hôpital psychiatrique sous hospitalisation d’office.
Celle-ci ne pourra être levée qu’après un arrêté préfectoral pris sur demande du psychiatre traitant validée par deux avis expertaux indépendants. Abolition du discernement est donc synonyme de priorité aux soins sans négliger le risque social :
la sortie de l’hôpital ne peut être décidée par un seul médecin. Si l’expert conclut à une altération du discernement le sujet est considéré responsable de son acte. Il sera jugé aux Assises mais ses défenseurs essaieront de souligner les signes de pathologie mentale pour obtenir une atténuation de la sanction ; celle-ci peut alors être étonnamment légère au regard de l’acte reproché.
Une pathologie psychiatrique peut au contraire conduire à une… aggravation de la sanction par un réflexe de protection d’un jury impressionné par de telles anomalies : certains dénoncent une telle éventualité comme une forme de violence légale à l’encontre du malade mental [11]. Abolition ou altération du discernement ?
Un débat existe parmi les professionnels pour tracer les limites de l’imputabilité de l’acte à la maladie et définir la meilleure proposition pour les malades criminels :
— pour quelques-uns, qui ne sont pas les moins actifs, le non lieu judiciaire pour motif psychiatrique efface une réalité et « prive » le malade de son acte ; les mêmes soulignent le risque de clôture prématurée de l’enquête, avant même que la preuve ne soit bien établie concernant l’identité du coupable. L’idée est effectivement insoutenable qu’un malade puisse être indûment considéré auteur d’un crime dont il ne serait certes pas puni ;
— on peut certes accepter l’idée selon laquelle la dignité de tout sujet suppose qu’il soit comptable de ses actes et que, même malade, il mérite le même traitement social que quiconque : hélas la maladie peut rendre évidente l’incapacité du sujet à comprendre le sens de la punition et à amender ses comportements sous l’effet de celle-ci ;
— pour le plus grand nombre des professionnels le bon sens et l’éthique imposent a priori que la pathologie sous tendant l’acte soit en priorité médicalement traitée [3].
Un point de difficulté dans ce débat, punir ou soigner, tient au fait que le malade mental accomplissant un acte criminel garde une part de lucidité : pour certains experts ceci justifie une confrontation à la réalité des faits et leurs conséquences.
D’ou la notion d’atténuation de la responsabilité : les signes de maladie sont mentionnés et le déterminisme de l’acte imputé aux dimensions psychologiques « physiologiques » qu’il est pourtant périlleux de distinguer dans le contexte d’un trouble psychique avéré..
Ce débat pèserait peu s’il n’était que théorique : de plus en plus les expertises concluent à une altération de la responsabilité d’où une diminution des cas de non lieu psychiatrique [7].
Conséquences de cet état des lieux
Déclaré responsable le criminel malade est confronté à la Cour d’Assises et la prison : priorité est à l’application de la décision du jury populaire. A la sortie de prison, la même pathologie aura une probabilité élevée de rester évolutive, à l’origine d’une répétition des mêmes troubles du comportement.
Une étude américaine sur vingt-cinq jeunes criminels laisse à réfléchir : elle a montré que tous avaient des anomalies cérébrales, neuropsychologiques ou cliniques et que les deux tiers d’entre eux étaient porteurs d’une maladie mentale avérée [5].
En France, comme dans la majorité des pays, le criminel perd automatiquement certains avantages sociaux : fonctionnaire il est radié. La décision expertale aboutit aussi à ce type de conséquence. Les psychiatres travaillant en milieu carcéral ne peuvent dispenser des soins qu’acceptés par le détenu. Ceci est vrai aussi dans les structures de soins psychiatriques existantes au sein de vingt-six établissements pénitentiaires, les SMPR (Services Médico-Psychologiques Régionaux). La création d’unités de soins psychiatriques pouvant accueillir des prisonniers malades mentaux est en cours : ces Unités d’Hospitalisation Spécialement Aménagée ou UHSA seront au nombre de dix-sept pour traiter sans leur consentement des détenus malades mentaux [7].
En réalité ce processus est déjà entamé : un nombre croissant de criminels malades sont aujourd’hui transférés de la prison en Unités pour Malades Difficiles ou UMD.
Ceci survient lorsque le malade est en danger face à ses co-détenus ou plus rarement lorsqu’il paraît lui-même dangereux. Dès lors le circuit du malade criminel est :
Cour d’Assises, prison, soins psychiatriques. On estime à 10 à 20 % le nombre des détenus porteurs d’un trouble schizophrénique [5]. La dangèrosité de certains états psychiatriques est un fait établi. Dans une étude sur une cohorte de 14 110 sujets souffrant de schizophrénie, Swanson et coll . [8] relèvent 19,1 % de cas avec conduites violentes et 3,6 % avec des violences graves. Toutes les études convergent : chez l’homme le trouble psychotique multiplie par deux le nombre d’actes criminels, par cinq chez la femme [11]. Certains indices sont prédicteurs d’un risque de violence du malade mental : trouble non identifié ou non traité (arrêt du traitement et du suivi), désocialisation, consommation de toxiques. Le cumul de ces trois indices chez un même individu pourrait multiplier par huit le risque d’acte criminel [10]. La responsabilisation des malades mentaux risque de participer à la mise en place de ces facteurs de dangerosité.
La limite entre responsabilité et non responsabilité
Elle peut être évidente à tracer dans le cas de l’épisode psychotique aigu, par exemple lorsque une injonction hallucinatoire ordonne l’accomplissement d’un acte absurde au regard de l’histoire du sujet et de sa victime. C’est le cas du sujet qui tue un passant qu’il ne connaissait pas parce qu’un automatisme mental l’y pousse soudainement sans aucune préméditation. Certains discuteront cependant l’irresponsabilité dans le cas ou cet acte surviendrait après qu’une fois encore ce malade ait « volontairement » interrompu son traitement anti-hallucinatoire du fait de son anosognosie. Plus souvent le syndrome hallucinatoire paraît moins absurde, semblant prendre racine dans l’histoire du sujet, ses amours et ses rancœurs. Il n’empê- che : le phénomène hallucinatoire ou délirant est le déterminant de l’acte criminel si on veut bien le considérer comme un fait pathologique en soi. Pour qui au contraire privilégie une analyse psychologique du contenu délirant ou hallucinatoire le caractère pathologique paraît moins évident en raison d’une cohérence retrouvée par ce travail de reconstruction voire… de construction.
Lorsque la dimension de désorganisation psychotique est trop peu marquée pour rendre très manifeste l’incohérence des idées et du comportement, entraver toute capacité à préméditer et construire un crime le caractère pathologique de celui-ci peut échapper à l’examinateur naïf. La violence de l’acte par une levée des inhibitions peut être aussi un signe de la maladie mentale : les sujets atteints de schizophrénie sont capables d’actes criminels d’une singulière cruauté [3]. Pour peu que l’acte criminel ait été antérieurement nourri d’un lot d’incompréhensions et disputes entre victime et criminel, le bon sens populaire peut avoir beaucoup de mal à admettre la notion d’acte pathologique. Et certains experts ne manquent pas de bon sens citoyen : est-ce vraiment la mission d’un technicien expert ?
Le délire ne se résume pas à un contenu décalé ou inexact. Il est un bloc idéo affectif imperméable à la discussion ou la mesure. Parfois même le délire s’appuie sur une réalité avérée : la majorité des jaloux délirants ont été ou sont bel et bien cocus.
« Plût au ciel qu’il suffit d’être cocu pour n’être point malade » disait de Clérambaut :
le jaloux devient délirant quand sa vie est toute entière envahie par cette douloureuse conviction de chaque instant. Indice ou absence d’indice ont la même valeur de preuve. La croyance délirante ne peut être durablement effacée ou apaisée : ni par la discussion, ni par le dialogue, ni par la réalité des faits présents. Certains rapports d’expertise adhèrent davantage à la logique du quidam qu’à celle de la connaissance médicale : puisque réputé cocu, il ne saurait être désormais tenu pour délirant. La difficulté à tracer la limite entre responsabilité et non responsabilité est plus grande encore lorsque le syndrome schizophrénique est surtout déficitaire : a-t-il volé et tué pour survivre ou du fait de ses difficultés à appréhender le réel et à organiser le quotidien ? Le schizophrène à la rue, sans ressources s’habitue à user de moyens de survie qui apparaissent comme une forme de réponse adaptée à la situation.
Comment ignorer que la désocialisation est le résultat de la maladie et les comportements antisociaux induits par une méconnaissance des conséquences des actes ?
Hallucinations et délires aigus ou chroniques ne sont pas assimilables à des états confusionnels aigus. Les dimensions de désorganisation et de déficit psychotiques peuvent être causes de troubles du comportement social, y compris d’actes criminels.
Plaidoyer pour une médecine pragmatique
Constatant une continuité entre normal et pathologique, l’infiltration d’aspects psychologiquement cohérents dans le contenu du fait pathologique, ne doit-on pas donner avantage au pragmatisme ? Qui du juge ou du médecin peut le mieux gérer la situation présente ? Quels outils, punition ou intervention médicale, peuvent le mieux orienter le futur ?
Quelques évidences s’imposent :
— les victimes ont besoin de connaître les arguments justifiant une réponse médicale plutôt que judiciaire ; elles ne peuvent accepter de retrouver le criminel devant leur porte quelques semaines après les faits. Conduire les victimes à renoncer au sentiment de vengeance guidé par la loi du talion est nécessaire ;
ceci suppose explications et accompagnement ;
— les troubles psychotiques se soignent d’autant mieux que le traitement est précocement mis en route ; celui-ci n’est pas exclusivement chimique : il est aussi psychologique et social. Choisir une séquence punition puis traitement n’est pas la meilleure façon de procéder ;
— même d’expression aigue, les troubles psychotiques se soignent dans la durée, sur plusieurs années, voire tout au long de la vie. La probabilité d’aboutir au meilleur résultat est d’autant plus élevée qu’une alliance a pu se nouer entre patient, famille ou entourage et soignants [2].
Le passage par la prison ne prépare pas un avenir favorable : ce sont ces criminels malades qui sont le plus à risque de récidive s’ils ne sont pas soignés, socialement soutenus et de surcroît protégés des toxiques : l’intervention psychiatrique la plus précoce possible offre les meilleures probabilités d’amendement voire de guérison.
Elle permet la mise en œuvre du soin adapté, ôtant toute ambiguïté au rôle des soignants. Elle signifie le statut de malade au regard de la société, de la famille et du sujet. On ne peut pas exclure que dans le cours d’une psychose chronique le médecin ait besoin de l’aide de la police voire de la justice : quand il faut appréhender un malade désocialisé et dangereux ; quand il semble pertinent de le confronter à la punition parce qu’à ce moment il peut en comprendre le sens et que cette confrontation peut avoir valeur éducative. Cette hypothèse correspond à de rares situations, acceptable à condition de la désigner pour ce qu’elle est : un constat des limites de nos outils thérapeutiques conduisant à estimer possible la punition en réponse à des comportements itératifs.
La France reste un des rares pays ne reconnaissant pas la nécessité d’une formation et d’une qualification en psychiatrie médico-légale.
Au lieu de cela existent deux phénomènes :
l’auto proclamation par celui qui décide d’exercer ce métier d’expert et trop souvent accepte de rendre les services attendus des magistrats entre les mains desquels est la cooptation , nécessaire pour l’inscription sur les listes et la désignation pour chaque mission.
Aucun argument technique n’est pris en compte pour inscrire tel ou tel sur les listes d’experts prés la Cour d’Appel, l’autorité judiciaire ayant jusqu’à ce jour réfuté les propositions d’avis donné par l’université par exemple. Les Compagnies des experts peuvent jouer ce rôle rétorquera-t-on : en réalité ces compagnies sont plus proches d’organismes syndicaux que d’instances d’évaluation travaillant avec des critères d’évaluation des compétences.
Dimension éthique
Les pratiques expertales doivent évoluer en prenant en compte les évolutions sociales et plus encore les acquis des connaissances. Qui d’autre que le médecin peut faire connaître les progrès des thérapeutiques, les interrogations et les réponses des neurosciences et des sciences humaines ?
Le développement d’actions de recherche spécifiquement dévolues à ce domaine permettrait de définir mieux parmi les comportements criminels ce qui relève d’abord du judiciaire et ce qui doit être confié à la médecine. On assiste aujourd’hui à une épidémie d’actes de délinquance sexuelle : certaines études ont rapporté que 50 % des sujets atteints de maladie mentale avaient subi des abus sexuels durant l’enfance. Ces malades peuvent eux-mêmes commettre de tels actes sur des proches ou des moins proches. Cependant la majorité des délinquants sexuels sont des anormaux auxquels le psychiatre ne peut apporter qu’une aide limitée : il est raisonnable dans ces conditions d’accepter qu’ils relèvent d’abord du judiciaire.
Les déviances sexuelles sont un domaine ou la connaissance et le savoir faire psychiatriques restent limités La loi a cependant instauré l’obligation d’un suivi médico judiciaire des criminels sexuels : nul ne saurait se plaindre qu’un accompagnement psychologique soit ainsi mis en place encore qu’on pourrait se demander si ceci correspond à une vraie priorité pour des psychiatres. Le psychologue clinicien ne pourrait-il pas aussi bien remplir un tel office ? Et surtout ne devrait-on pas prévoir comment évaluer les effets d’un tel suivi ? Cette mission d’évaluation de nature médicale serait une occasion pour le psychiatre d’apporter ses compétences.
Il faut aussi faire savoir combien sont aléatoires les réponses du psychiatre quant à l’évaluation du risque criminologique d’un sujet. Nous ne disposons pas de critères surs : antécédents de comportements violents, contenu du délire, froideur émotion-
nelle sont certes des indicateurs de risque, pertinents à condition d’être évalués dans un moment pathologique et un contexte bien identifiés. Le même sujet régulièrement suivi et médicalement traité peut passer du niveau risque élevé au niveau pas de risque. Les déterminants des comportements sont multifactoriels : c’est cette synthèse que les criminologues tentent de faire [10].
La mesure de la crédibilité d’une victime est une autre des missions impossibles confiées aux psychiatres qui se sont laissés entraîner d’une question médicale (délirant, mythomane ou non) à une sorte de lecture psychologique sur la vraisemblance du récit et …des faits ! Ces questions de l’autorité judiciaire sont justifiées par le souci de compréhension des facteurs psychologiques sous tendant ou accompagnant tel ou tel comportement dans le déterminisme duquel interviennent divers éléments :
— individuels innés et acquis, éventuellement perturbés par une maladie mentale.
On suppose que certains aspects biologiques pourraient faciliter l’agressivité ou l’impulsivité. On peut aussi proposer une reconstruction de la trajectoire de l’individu avec une grille de lecture psychanalytique qu’il serait absurde de considérer comme certitude ou vérité. Parler d’un acte motivé par une attache oedipienne anormale ou une nécessité de tuer l’image paternelle ne sont que métaphores de l’apprenti biographe qu’est le psychiatre surtout lorsqu’il se prétend capable d’un exercice psychanalytique le temps d’un examen expertal !
— environnementaux : les spécialistes des comportements animaux savent que chaleur et promiscuité facilitent l’émergence de comportements agressifs tout comme les sociologues savent que l’anonymat est un facilitateur de conduites antisociales, — contextuels : certaines situations de groupe freinent ou activent l’agressivité.
CONCLUSION
Notre société est contrainte de s’interroger sur les causes d’accroissement du nombre de violences par des sujets de plus en plus jeunes. Elle aurait tort de croire que la psychiatrie est en mesure de donner des réponses à ce constat : les enquêtes épidémiologiques ne montrent pas une augmentation du taux d’incidence des grandes maladies mentales. Interrogeant le psychiatre, le juge doit exiger un diagnostic en référence aux catégories retenues par l’OMS, l’énumération des critères pronostiques et leur poids respectif, l’inventaire des thérapeutiques médicales disponibles et leur niveau d’efficacité. Conduire l’expert psychiatre vers davantage de rigueur scientifique permettra une meilleure connaissance de la contribution possible de la médecine à la prise en charge de criminels porteurs de signes de pathologie psychiatrique. La place des examens paracliniques doit aussi être reconsidérée [6].
Très peu d’expertises s’appuient sur les données de l’imagerie, de la neuropsychologie qui pourtant sont de plus en plus nombreuses même si, hélas, elles ne sont pas encore des outils de certitude.
BIBLIOGRAPHIE [1] ARANGO C., BARBA AC., GONZALEZ-SALVADOR T., ORDONEZ AC. — Violence in inpatients with schizophrenia : a prospective study . Schizophr. Bull., 1999 , 25, 493-503 .
[2] BONSACK C., PFISTER T., CONUS P. — Insertion dans les soins après une première hospitalisation dans un secteur pour psychose. L’Encéphale, 2006, 32 , 679-85.
[3] CORNIC F., OLIÉ JP. — Le parricide psychotique. La prévention en question.
L’Encéphale , 2006, 32 , 452-8.
[4] JAMES E., HASTING S., KEVIN HAMBERGER L. — Sociodemographic predictors of violence . The
Psychiatric Clinics of North America, 1997, 20, 2, 498.
[5] MYERS WC., SCOTT BS., BURGESS A. BURGESS A. — Psychopathology, biopsychosocial factors, crime characteristics, and classification of 25 homicidal youths. DBA J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 1995, 34, 1483-9.
[6] SCARPA A., RAINE A. — Psychophysiology of anger and violent behavior.
The Psychiatric
Clinics of North America , 1997, 202, 498 p.
[7] SENON J.L. — L’expertise psychiatrique légale : les données d’un débat.
Actualité Juridique
Pénal., Février 2006.
[8] SWANSON J.W., HOLZER C.E., GANJU V.K. et al. — Violence and psychiatric disorder in the community : Evidence from the Epidemiologic Catchment Area Survey.
Hosp . Community
Psychiatry, 1990, 41, 761-770.
[9] TEPLIN L.A. — The prevalence of severe mental disorder among male urban jail detainees :
Comparison with the Epidemiologic Catchment Area program . Am. J. Public Health, 1990, 80, 663-669.
[10] The Psychiatric Clinics of North America. Anger, aggression and violence. Saunders edit. 1997, Volume 20, Number 2, 498 p.
[11] VIDON G. — Conduites agressives et schizophrénie.
Séminaire de Psychiatrie Biologique, Hôpital
Sainte-Anne, 2007. (à paraître).
DISCUSSION
M. Patrice QUENEAU
L’on connaît bien la dangerosité, notamment par mésusage des psychotropes (par les médecins, mais aussi par les malades : utilisation anarchique…). Personnellement, je crains que ce paramètre pharmacologique ne soit pas suffisamment pris en compte dans le diagnostic médical mais également médico-légal de certaines déshinibitions avec passages à l’acte et conduites criminelles pouvant conduire à d’authentiques assassinats, blessures graves, suicides ou violences sexuelles. Qu’en pensez-vous ? Ce qui pose à nouveau la question de la formation des experts, comme vous l’avez très opportunément souligné.
Je crois, comme vous, que l’effet des agents psycho actifs licites ou illicites est très imparfaitement pris en compte par les experts : c’est en tous les cas ce que j’ai observé en de multiples occasions. Sans aucun doute, il conviendrait de mieux connaître et faire connaître les capacités désinhibitrices de certaines substances, par exemple les benzodiazépines.
M. Pierre PICHOT
Cette lecture expose un aspect technique. Les problèmes soulevés par la psychiatrie médicojudiciaire d’un problème fondamental de la psychiatrie : les limites entre normalité et pathologie et les critères sur lesquels sont fixées ces limites. Il est significatif que les ouvrages de référence, ou bien s’abstiennent de donner des critères (comme la liste des maladies de l’OMS qui d’ailleurs ne parle pas de maladies mentales mais de troubles mentaux), ou proposent un critère extrêmement vague : l’expérience clinique des psychiatres.
Je vous remercie pour vos remarques. Il est vrai que dans notre spécialité, les limites entre normal et pathologique peuvent être difficiles à tracer. Ceci devrait être une raison supplémentaire pour prendre en compte, aussi loin que nous le pouvons, les états clairement identifiés comme pathologiques.
Mme Monique ADOLPHE
Comment sont choisis actuellement en France les experts psychiatriques ? Et quelles en sont les conséquences éventuelles ?
Par pure cooptation. Tout d’abord pour être inscrit sur une liste de Cour d’appel : certes la Compagnie des Experts peut donner un avis mais il n’y a aucune évaluation quant au niveau scientifique initial du candidat expert. Nous avions suggéré qu’un jury incluant des universitaires soit sollicité pour donner un avis : ceci ne fut pas retenu par le Garde des Sceaux. Il y a aussi cooptation pour chaque mission, le Magistrat ayant la totale liberté de choix quant à l’expert sollicité. Les autorités judiciaires ont une conscience de ceci :
une incitation à la formation continue des experts est depuis peu en place.
M. Pierre GODEAU
Quelles sont les possibilités des psychiatres d’agir en amont, c’est-à-dire action de prévention d’un acte dangereux sans attendre le classique ‘‘ passage à l’acte ’’ ?
Les psychiatres savent utiliser certains critères de dangerosité. Par exemple, il est bien établi que certains traits de personnalité, la prise de toxiques et la nature de leurs effets individuels, la désocialisation et le stress sont des facteurs de risque. Le psychiatre n’a pas une capacité de prédiction absolue des comportements mais il peut identifier des indices de risque et guider la gestion de ces situations.
M. Marc GENTILINI
Si on trouvait d’autres formules répressives concernant les détenus pour infraction à la législation des étrangers (les ILE) et aux détenus pour infraction à la législation des stupéfiants (les ILS), et surtout les 10 à 20 % des psychotiques estimés dans nos prisons, l’on réduirait considérablement la population carcérale. Mais, pour cette dernière catégorie, celle qui nous préoccupe, que peut-on faire ? En quoi l’Académie nationale de médecine pourrait-elle vous aider à obtenir des pouvoirs publics une prise en charge réelle et durable de ces malades incarcérés ?
L’Académie pourrait opportunément faire connaître : — la nécessité d’encadrer la formation des futurs experts par un DESC de psychiatrie médicolégale, — l’opportunité de mettre en place les conditions d’évaluation de stratégies psycho-rééducatives sans lesquelles toute rétention ou supposé traitement pourraient être vains.
* Membre de l’Académie nationale de médecine. ** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine, Service de Santé mentale et de thérapeutique, Hôpital Sainte-Anne, 1, rue Cabanis 75014 Paris. Tirés-à-part : Professeur Jean-Pierre OLIE, même adresse. Article reçu le 26 mars 2007, accepté le 26 novembre 2007 .
Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 2, 381-391, séance du 26 février 2008