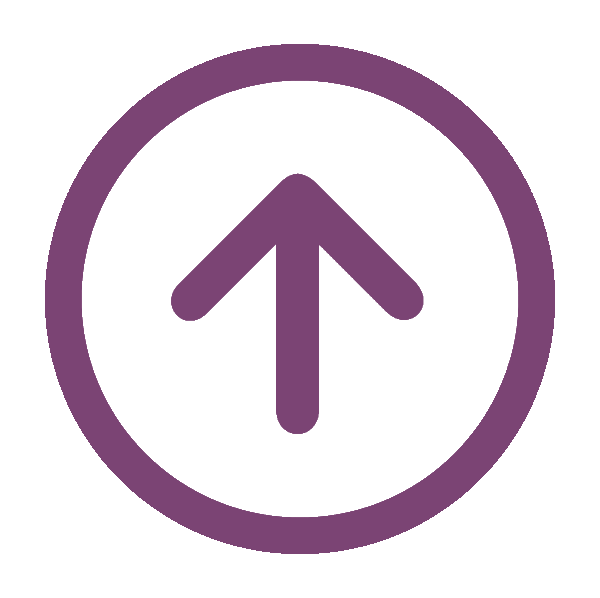Éloge de Lucien Hartmann (1915-2004)
Jacques Louis BINET
Madame, Après avoir bien voulu me recevoir, vous m’avez écrit pour me demander de rester très discret sur la vie personnelle de notre confrère, Lucien Hartmann. Croyez bien que, connaissant sa pudeur, ses réserves, je le resterai, mais je ne peux oublier qu’un éloge n’est pas un exposé de titres et travaux et que cette vie affective, finalement cette vraie vie, fait partie intégrante de l’œuvre. Elle ne l’explique pas mais la soutient. Elle ne la motive pas mais lui donne ses vraies couleurs, son empreinte, la personnalise dans sa plénitude et ses paradoxes. Ce sont, peut-être, ces paradoxes qui apparaissent d’emblée dans le portait de Lucien Hartmann Monsieur le Président, Messieurs les membres du Bureau, Mes chères consœurs, Mes chers confrères, A vous interroger, je me suis aperçu que certains d’entre vous avaient été des familiers de Lucien Hartmann : Gabriel Richet compagnon de lutte depuis 1953, François Darnis rencontré chez René Cachera, Claude Dreux à l’Académie de pharmacie, Alain Rérat parmi nos vétérinaires, Marie-Odile Réthoré à côté de laquelle il siégeait ici à ma gauche dans ces rangs le plus souvent occupés par les biologistes et les pharmaciens. Chacun d’entre vous peut témoigner de sa rigueur scientifique, presque tatillonne où tous les détails techniques seront vus et revus, comme de sa grande ouverture vers le monde scientifique qui deviendra aussi sa famille (la famille Wurmser en fut). Sa curiosité clinique était permanente : il était avide d’apprendre et de comprendre, et soulignons également, son respect pour la hiérachie et les valeurs établies, son sens de la franchise, de l’amitié et de la fidélité, dut-il en subir les conséquences.
Le reste s’efface devant un écran de pudeur et de silence poli, que certains, le connaissant mal, prendront pour de l’orgueil ou de l’indifférence. Il s’agit de cette vie privée dont nous nous permettrons de tracer, toujours avec pudeur, les grands traits aujourd’hui, car elle l’honore, même si sa modestie en aurait peut-être souffert.
Cette vie fut souvent difficile
Né en 1915, Lucien Hartmann perd son père dans sa petite enfance. Il retrouvera cinq ans plus tard un beau-père, journaliste qui, bien que d’une religion différente, l’élèvera comme son fils. Après de brillantes études au lycée Carnot, il commence ses études médicales, devient externe en 1939. La guerre le mobilise comme médecin auxiliaire, il est fait prisonnier puis libéré et remobilisé en 1944.
Il fonde un foyer et aura quatre enfants auxquels il restera très lié. Puis vint la séparation d’avec sa femme. Il la vivra d’autant plus douloureusement qu’en croyant chrétien il était très attaché à l’idée de la famille.
Deux autres épreuves le toucheront profondément. La première, celle de la disparition de sa fille, d’une maladie hépatique qu’il ne pourra guérir. Puis la mort de son petit-fils, malgré tous les soins prodigués par Georges Mathé.
A la mort de sa mère, il reviendra près de son beau-père, avenue Mozart.
Atteint d’une maladie chronique, il connut une fin de vie douloureuse malgré tous les efforts de Pierre Godeau, et surtout l’admirable soutien de sa seconde épouse, Marie-Paule.
Dans ce long parcours, il restera toujours le même, rigoureux mais sensible, froid au premier abord mais vite chaleureux, à votre écoute mais jamais à la sienne, avec toujours le même refus de tout compromis, la même opposition aux compromissions, aux consensus « mous », même parfois à ses dépens.
Ces trois traits de caractère nous les retrouverons dans toute la carrière de Lucien Hartmann et en particulier dans deux évènements, qui joueront un rôle essentiel pour ma génération, la création du laboratoire central de l’hôpital Beaujon et le club des treize.
Lucien Hartmann avait suivi jusque-là un parcours classique de bon clinicien, avec trois certificats d’hématologie, d’anatomopathologie et de médecine nucléaire, un clinicat dans la clinique médicale de Paul Harvier, puis de dermatologie chez
Henri Gougerot, et un poste d’attaché de consultation chez Madame BertrandFontaine, d’où l’arrachera René Fauvert.
Le laboratoire central de l’hôpital Beaujon
Un instant, laissons-nous guider par l’architecture et l’histoire.
En 1935, l’architecture de Beaujon, en dehors de Paris, mais toujours à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, est réécrite par Jean Walter, l’immense architecte milliardaire, propriétaire des mines de Zellidja, l’auteur du riche ensemble du boulevard Suchet, mais aussi le pionnier des cités-jardins. Dans un nouveau style, il refuse le système pavillonnaire et préfère dans un seul bloc « en dents de peigne », l’empilement sur dix étages successifs, de tout ce que pouvait demander le chef de service mandarin d’avant-guerre : quatre vingt dix lits, distribués en huit unités parallèles, reliées par un couloir transversal, où il disposait de sa propre consultation, ses propres laboratoires, de ses propres salles d’opération, et de tous ses services annexes.
1952, c’est l’époque des questions, des concours sur questions, des admissibilités et sous admissibilités, des misérables rétributions par l’Assistance publique, les médecins devant vivre de leur propre clientèle. C’est aussi le temps des laboratoires de la Faculté et des chaires de science fondamentale de l’Ecole pratique totalement séparés des hôpitaux. René Fauvert, alors médecin des hôpitaux, devient chef de service du laboratoire central, c’est-à-dire, d’une nouvelle structure hospitalière, avec sur un demi étage, un laboratoire polyvalent et moins de trente lits. Il demande à Lucien Hartmann de le rejoindre, et le nomme attaché médical, je dis bien médical.
Ce dernier installe dans le laboratoire de l’hôpital les techniques les plus sophistiquées, physico-chimiques et immunologiques des protéines, un matériel de médecine nucléaire, et met au point une recherche technologique, tout en passant sa visite tous les matins.
Les résultats replaçaient la médecine française dans la compétition internationale :
traitement de la poyglobulie par le phosphore radioactif ; exploration et traitement de la pathologie thyroïdienne par la même médecine nucléaire ; analyses du sérum, des urines, des ascites par les réactions immunologiques…
Les publications se multipliaient d’autant que Jacques Mallarmé assurait une consultation hebdomadaire d’hématologie, et qu’un jeune anatomopathologiste venait commenter les coupes de foie et de thyroïde. Il s’agit bien évidemment de Louis Orcel, celui qui deviendra le trésorier de notre Compagnie René Fauvert et Lucien Hartmann réinventent à Beaujon la nouvelle médecine, et le petit externe que j’étais en 1954, comme toute une partie de ma génération ne l’oublieront jamais.
Moment privilégié de la création médicale, où clinique et biologie ne font plus qu’un, et comparable à celui que font connaître, dans le domaine des arts, les grands créateurs lorsqu’ils changent de registre : Fautrier ou Dubuffet passant de la peinture à la sculpture, Lurçat de la peinture à la tapisserie, ou dans le domaine musical, Menuhin quittant son violon pour diriger l’orchestre et Barenboïm abandonnant sa baguette pour le piano.
Ce moment privilégié devait disparaître. René Fauvert, victime de son succès, devenait chef d’un grand service de gastro-hépatologie où Jean Pierre Benhamou le secondait. Toute l’activité de clinique, de thérapeutique, de réanimation et de recherche se centrait sur le foie. Pierre Boivin créait un service d’hématologie dans le même hôpital. Lucien Hartmann était nommé maître de conférence agrégé en 1961, biologiste des hôpitaux en 1962, Professeur sans chaire en 1962, Professeur titulaire à titre personnel en 1967, Professeur de biologie médicale à l’U.E.R. Cochin en 1970, et passait à la classe exceptionnelle en 1978. Ayant acquis un laboratoire à l’ancienne Faculté de médecine, dans les locaux de l’Ecole pratique, il quittait l’hôpital car son intégration ne fut jamais effective. Il abandonnait l’hôpital et René Fauvert. Cette séparation fut pour lui d’autant plus douloureuse qu’ils avaient, tous les deux, participé à une autre aventure, celle du club des treize.
Sous ce nom emprunté à Balzac, le club des treize n’avait rien d’un club littéraire.
Créé en 1951, dissous en 1971, son importance ne peut être comprise (Gabriel Richet l’a fort bien analysée dans un article pour l’internat de Paris) que dans le contexte de son époque, celui de la création du laboratoire central de Beaujon. A l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, dans un esprit nouveau, né des lectures américaines et des récits d’internes de retour des Etats-Unis, d’autres services spécialisés avaient plus ou moins recréé cette médecine biologique et ces nouvelles technologies pour les soins à dispenser au patient.
Treize jeunes médecins ou chirurgiens des Hôpitaux, très engagés dans la biologie et voulant la mettre au service de la médecine interne, se sont réunis pour discuter de leurs recherches et se tenir au courant des progrès dans leur discipline : un hématologiste Jean Bernard, un hépatologue René Cachera, un neurologue Paul Castaigne, un gastroentérologue Charles Debray, un autre hépatologue René Fauvert, un autre gastroentérologue André Lambling, un chirurgien thoracique et cardiaque Jean Mathey, un cardiologue Pierre Soulié, et quatre biologistes dont un coagulationiste Jean-Pierre Soulier.
Ce cercle de réflexion devait s’élargir en plusieurs vagues. Lucien Hartmann, comme Gabriel Richet ou Georges Mathé, faisait partie de la première de 1954 et devait jouer un grand rôle dans le choix des sujets et l’organisation de ces réunions. Ces dernières avaient lieu, une fois par mois, avec deux exposés, l’un avant et l’autre après un dîner frugal, sans souci de hiérarchie, sans obligation de publication et avec toujours la même liberté de propos, la même recherche de nouvelles hypothèses à propos d’un travail en cours.
D’abord Cercle René Cachera, en mémoire de l’un de ses fondateurs, il devient Cercle d’études cliniques et biologiques en 1961. En 1968, d’une quarantaine de membres on passait à une centaine, après un vote acquis moins une voix, celle de Lucien Hartmann qui ne voulait pas que ce lieu de réflexion se transforme en une société médicale, pluridisciplinaire comme les autres. Il avait raison et il fut mis fin, très sagement, en 1971, à cette nouvelle assemblée devenue presque solennelle, conventionnelle et de moins en moins fréquentée. Accusé d’élitisme, le club des treize ne put se reprocher que d’avoir tenté de mieux faire que par le passé.
Après le laboratoire central de Beaujon et le club des treize, c’est à partir de 1970, la période du laboratoire à l’ancienne faculté de médecine, celle des grandes publications, de la société française de biologie clinique, des responsabilités dans les structures de recherche, des académies et des honneurs.
A l’école pratique de la faculté de médecine , Lucien Hartmann installe un laboratoire de haut niveau, avec le label de l’Association Claude Bernard, de l’INSERM, dont il était une unité et du CNRS, à titre d’Era. Il y dispose d’une technologie de pointe, prêt à la compléter de ses propres deniers, y attire d’éminents scientifiques, comme le couple Wurmser, d’excellents collaborateurs, dont lui et son épouse Marie-Paule Ollier-Hartmann surveillent, avec une rigueur obsessionnelle, presque maniaque, toujours à la recherche de l’erreur, les différents temps de l’expérience.
Très naturellement les publications devaient se multiplier : plus de 260 travaux.
Claude Dreux en a déjà fait la synthèse dans son hommage pour les Annales de biologie clinique, et dans les meilleures revues. Elles portent sur : les immunoglobulines, leurs structures, leurs propriétés physico-chimiques et immunologiques, au cours des diverses affections, digestives, hépatiques, rénales, l’amylose, le myélome et la maladie de Waldenström ; les diverses fractions du complément surtout dans l’œdème angio-neurotique héréditaire, dont il a groupé une des plus grosses séries mondiales, grâce à des collaborations avec des services non parisiens ; les effets, avec Pierre Godeau, du traitement par la colchicine dans la maladie périodique ; les études par radio-immunologie et chromatographie d’immunité de la glycoprotéine de Tamm-Horsfall dans les neuropathies ; les explorations isotopiques dans la pathologie thyroïdienne et sanguine.
Très naturellement aussi de nombreux livres : huit monographies pour la Société française de biologie clinique, huit pour les Rencontres biologiques, deux gros traités de technique de biologie médicale, des cahiers d’enseignement postuniversitaires, des thèses de médecine, de pharmacie, de science et pour les hautes études. Car Lucien Hartmann ne cessera pas d’enseigner dans le cadre de la biologie médicale, de la biochimie, de l’immunologie ou de la génétique, mais surtout dans celui qu’il avait créé, des biologistes médicaux pour médecins, pharmaciens, biologistes et qu’il assumera, tous les ans de 1960 à 1982.
Vint alors le temps de la consécration et de la reconnaissance
Il est élu membre et secrétaire général de la Société française de biologie clinique de 1961 à 1973.
Il est à deux reprises lauréat de l’Académie nationale de médecine, élu membre de notre Compagnie en 1985, et de l’Académie de Pharmacie en 1988,
Il est promu au grade de Commandeur de la légion d’Honneur.
Quand la maladie l’a frappé, pour la première fois il n’était plus seul pour se battre :
Marie-Paule assumait.
Mais plus que le maître de la biologie clinique, Lucien Hartmann doit rester pour nous, l’homme des paradoxes.
Chrétien croyant, il vivra difficilement la division familiale et fera tout pour reconstituer une seconde famille autour de Marie-Paule et de Laurent.
Respectueux de l’ordre établi, très, trop attaché à la tradition (il ne désignait, René Fauvert, Jean Bernard et Jean Hamburger, que par Monsieur René Fauvert, Monsieur Jean Bernard, Monsieur Jean Hamburger). D’ailleurs, il me reprochera souvent de ne pas porter de chemise blanche, mais seulement claire le jour des séances.
Mais, il sera un des premiers à faire évoluer la médecine de son temps.
Clinicien biologiste, il se voit éloigné des patients lorsqu’il dirige son propre laboratoire. Précuseur du temps plein hospitalo-universitaire, il n’obtiendra jamais son intégration, et restera enfermé dans l’ancienne Faculté de médecine.
Ces paradoxes, Lucien Hartmann les a assumés à ses dépens, sans se plaindre, car il faisait passer la droiture et l’honneur avant toutes choses.
Droiture, Honneur, deux mots totalement oubliés aujourd’hui.
Mais non, Madame, chère Marie Paule, l’Académie ne les oubliera pas.