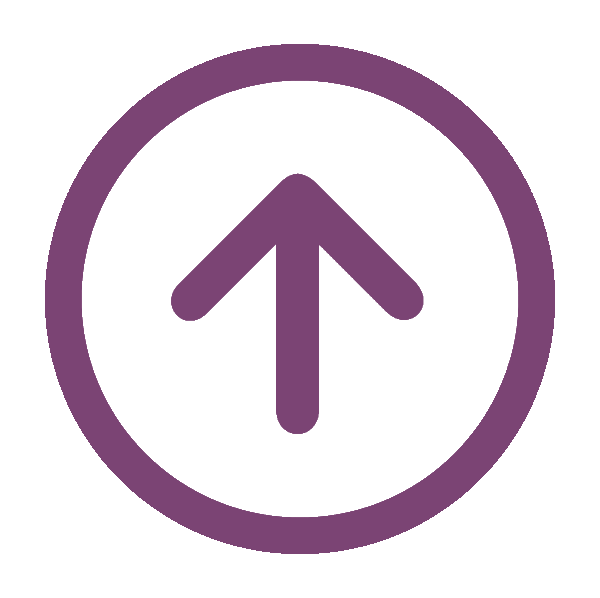le second sur l’évaluation des thérapeutiques . Ces deux rapports avaient déjà soulevé des critiques et un malaise chez une part importante de la communauté des pédopsychiatres et des psychologues et plus généralement des acteurs de soins dans le domaine de la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent.
Il était déjà reproché à ces rapports de s’appuyer presque exclusivement sur la littérature anglo-saxonne et de ne pas prendre suffisamment en compte les pratiques françaises largement influencées par l’approche psychodynamique si ce n’est psychanalytique avec pour conséquence un sentiment d’ignorance voire de disqualification d’une pratique, notamment au niveau du secteur, riche tant sur le plan quantitatif que qualitatif, avec en arrière-fond la perception que la qualité relationnelle du travail et le souci de soutenir un développement le plus satisfaisant possible de la personnalité étaient méconnus au profit des résultats essentiellement comportementaux et à court terme.
Dans ce contexte tendu de méconnaissance réciproque le dernier rapport sur le trouble des conduites est venu mettre le feu aux poudres. Il est vrai que le sujet s’y prêtait et qu’il était pour le moins délicat de traiter de troubles difficiles à définir, dont les limites entre normal et pathologique sont floues, en partie dépendantes de la tolérance de l’environnement et des normes sociales et dont la qualification même de trouble des conduites prend en français une connotation morale et disciplinaire qu’elle n’a pas en anglais. Plus encore le rapport prône un repérage précoce des troubles, en particulier entre trois et cinq ans et fait le lien entre ces troubles précoces et des troubles graves du comportement à l’adolescence de type anti-sociaux conduisant à la délinquance. Il souligne également le rôle possible des facteurs biologiques et d’héritabilité. La juxtaposition dans un communiqué de presse de l’Inserm très lapidaire et percutant de quelques mots « phares », tels que : enfants de trois à cinq ans, troubles des conduites, dépistage, délinquance, hérédité, médicaments psychotropes a eu l’effet d’un détonateur et suscité une pétition qui a recueilli autour de 200 000 signatures et peut-être plus à ce jour. L’amalgame était facilité par la publication peu après du rapport parlementaire sur la prévention de la délinquance, en même temps que se profilait la loi sur ce sujet.
Il est vrai que si le contenu de la pétition correspondait à celui du rapport il était difficile de ne pas la signer. En effet par « une logique linéaire implacable », celle dont ferait preuve le rapport Inserm selon les rédacteurs de la pétition contre celui-ci, ce dernier est accusé de suivre une : « approche déterministe et suivant un implacable principe de linéarité, le moindre geste, les premières bêtises d’enfant risquent d’être interprétés comme l’expression d’une personnalité pathologique qu’il conviendrait de neutraliser au plus vite par une série de mesures associant rééducation et psychothérapie. A partir de six ans, l’administration de médicaments, psychostimulants et thymorégulateurs, devrait permettre de venir à bout des plus récalcitrants. L’application de ces recommandations n’engendrera-t-elle pas un formatage des comportements des enfants, n’induira-t-elle pas une forme de toxicomanie infantile ». Et pour faire bonne mesure on appelle à la rescousse deux leviers habituels de la manipulation populiste : la dérision « faudra-t-il aller dénicher à la crèche les voleurs de cubes ou les babilleurs mythomanes ? » ; et l’amalgame politique où sous prétexte de l’existence de « rapports au sujet de la prévention de la délinquance » il s’agirait ni plus ni moins pour l’Inserm de servir « de caution scientifique à la tentative d’instrumentalisation des pratiques de soins dans le champ pédopsychiatriques à des fins de sécurité et d’ordre public ».
Qu’en est-il en fait ? Le rapport précise qu’on ne peut parler de trouble des conduites que devant un « ensemble de conduites répétitives et persistantes » décrits de façon précise dans un ensemble de quinze symptômes regroupés en quatre catégories pour la classification Nord-américaine DSMIV-R et de vingt-trois symptômes classés en trois catégories pour la classification internationale CIM10. Le diagnostic en peut être porté que si les symptômes sont « sévères, repérés, durables ».
Le trouble est rarement isolé et souvent associé avec l’hyperactivité avec ou sans trouble de l’attention, le trouble dépressif et les troubles anxieux.
Bien que les études génétiques demeurent hétérogènes, une héritabilité génétique, mais pas une hérédité bien sûr, est estimée de l’ordre de 50 %, en interaction avec tous les autres facteurs notamment environnementaux.
Un tempérament et une personnalité qualifiée de « difficiles » sont fréquemment retrouvés, comme pour beaucoup de troubles mentaux caractérisés par : « qualité négative de l’humeur, faible adaptabilité, forte distractibilité, réaction émotionnelle intense, hyperactivité, repli social, agressivité, indocilité, impulsivité, absence de culpabilité ».
Enfin une longue série de paramètres, eux aussi peu spécifiques, sont retrouvés avec une fréquence suffisamment importante pour en faire des facteurs de risque. Ils vont de différentes modalités d’inadaptation des attitudes éducatives parentales à l’influence de contextes environnementaux familiaux et sociaux défavorables, aux troubles psychiques des parents, notamment dépression maternelle, jeune âge de celle-ci, stress et prises de toxiques pendant la grossesse.
L’ensemble peut faire cataloguer à la Prévert et les détracteurs n’ont pas manqué d’ironiser sur le peu de spécificité de ces facteurs sur fond de stigmatisation sociale et morale ; néanmoins le regroupement de l’ordre d’un millier de publications convergentes confirme bien la pratique clinique et fait sens. C’est le cumul de ces facteurs de risque sur une personnalité vulnérable, dans un contexte familial affectif et éducatif défaillant, qui potentialise chaque facteur et enferme l’enfant dans un comportement qui va lui-même s’auto-renforcer dans une interaction négative avec l’environnement, notamment scolaire et familial, et conduire à une marginalisation progressive que l’adolescence a de grandes chances d’aggraver enfermant le sujet dans une identité de plus en plus négative.
Le trouble des conduites s’exprime alors logiquement sur un mode franchement anti-social. L’accrochage et même plus souvent l’agglutinement avec des pairs dans la même situation vient compenser l’absence de liens gratifiants avec des adultes de référence et colmater le vécu d’abandon affectif, de dévalorisation et de dépression sous-jacente de ces adolescents, faisant le lit naturel d’une néo-organisation sociale qui peut prendre le visage de la délinquance. L’absence de ressources internes de ces adolescents, la profonde insécurité qui les habite les rend paradoxalement massivement dépendants du regard des autres, les adultes ou les pairs de la société établie, sur un mode qui oscille de l’angoisse d’abandon « tu ne me regardes pas tu me méprises » à l’angoisse d’intrusion persécutive « tu me regardes, qu’est-ce que tu me veux ? » ressentie très vite comme une menace sur leur identité et une forme de violence à laquelle ils se sentent justifiés de répondre par une violence en miroir de celle éprouvée.
L’absence de sécurité interne, de confiance en eux comme dans les autres (à l’exception de leurs doubles ceux qu’ils perçoivent comme étant comme eux) est le résultat de ces facteurs conjugués. Une fois le comportement installé il échappe en grande partie aux multiples facteurs qui ont favorisé son installation. Il n’est pas inutile de tenter de supprimer ou d’alléger le poids de ces facteurs. Mais leur multiplicité, comme la complexité de leurs causes ne favorisent pas une résolution rapide. Quoiqu’il en soit des efforts nécessaires entrepris pour les faire disparaître il est essentiel de ne pas perdre de vue le trouble des conduites dont la permanence est organisatrice de l’avenir de l’enfant en l’empêchant de se nourrir des apports nécessaires au développement de sa personnalité.
Ce point semble largement sous estimé encore, avec l’illusion qu’un regard nouveau et positif sur l’enfant suffira à inverser le cours des choses. C’est toujours possible, heureusement, et c’est le but poursuivi mais à condition que cette évolution positive s’inscrive dans la réalité d’un changement de comportement qui seul permettra une inversion du cours des choses. Plus le changement est tardif plus le poids du passé obèrera l’avenir rendant de plus en plus difficile une évolution positive. Plus les acquisitions seront faibles, plus l’abandon du comportement destructeur et négatif laissera l’enfant ou l’adolescent sans protection, comme à nu dépourvu des ressources indispensables à un minimum d’estime de soi et de confiance en lui-même.
L’écart risque d’apparaître insurmontable entre ses aspirations positives retrouvées et la réalité du possible et ce qui s’offre à lui. La déception risque d’être dramatique avec pour issue l’effondrement dépressif ou la reprise des conduites destructrices dans une fuite en avant dangereuse.
Tous les intervenants en santé de l’enfant s’accordent sur le fait qu’un enfant qui présente des troubles des conduites importants et durables est en difficulté et court des risques majeurs pour le développement de sa personnalité. Tout enfant qui ne peut se nourrir de l’apport de l’environnement et des autres, que ce soient la nourriture,les échanges sociaux, le développement des apprentissages et des compé- tences, altère son image de lui-même, accroît sa dépendance à l’environnement et son besoin de s’opposer pour affirmer sa différence. Il se marginalise inévitablement s’il n’abandonne pas ce comportement.
C’est cette marginalisation de fait qui représente le vrai danger de stigmatisation.
Bien sûr le repérage précoce de ces difficultés peut être mal perçu par l’enfant et plus encore par sa famille s’il est mal fait et vécu comme un rejet, non comme une occasion d’être aidé. Mais être aidé ne veut pas dire attendre indéfiniment et accepter la poursuite du comportement. C’est à ce niveau qu’il convient d’inventer de nouvelles formes d’aide à côté de celles existantes. Le rapport en fournit de multiples exemples, en rien exhaustifs, qui ne concernent pas tous le domaine médical, loin s’en faut, mais où celui-ci part contribuer à orienter et à soutenir l’action des enseignants et des éducateurs.
Il ne s’agit pas de disqualifier le travail déjà existant mais de profiter de l’opportunité du rapport pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’intérêt d’une action plus soutenue dans le temps, plus cohérente et plus diversifiée. Mais pour cela il faut que ces enfants et plus encore leurs familles acceptent et soutiennent ces actions.
C’est loin d’être toujours le cas pour des raisons multiples mais où la peur joue un rôle dominant. Il peut être utile et même indispensable que la société pose fermement des limites et explicite ce qu’elle peut tolérer et ce qu’elle n’accepte pas. Non par caprice ou excès de pouvoir, certes toujours possible, mais parce qu’elle a la conviction qu’on ne peut se développer sans acquisitions et sans une exigence de respect pour soi et pour les autres, les deux se construisant toujours de pair. Respect de son corps et de celui de l’autre, comme de sa pensée, de ses convictions et de son image de lui. Pour que cela soit possible il faut que la rencontre soit possible. Pour le sujets les plus en difficulté la peur leur fait fuir cette rencontre ou ne la rend possible que dans l’affrontement comme nous le soulignions ci-dessus.
Il faut savoir et pouvoir organiser cette rencontre parfois contre le gré de l’autre. Où est la liberté quand c’est la peur qui guide le comportement ? Parce que la peur est inscrite au cœur de l’individu, du fait de ses expériences antérieures mais aussi de son tempérament. L’interdit et les limites imposées de l’extérieur peuvent être alors les seuls moyens de faire contrepoids à cette peur intérieure qui habite le sujet et qu’il n’a pas choisie. La destructivité n’est jamais un choix chez l’enfant mais elle peut être agie par une contrainte interne qui ne dit pas son nom, qu’il subit et contribue à organiser ses relations et à le confirmer dans ses craintes. Ce n’est pas parce qu’on a été victime que cela justifie de devenir son propre bourreau ni celui des autres. Une contrainte extérieure peut être libératrice si elle est l’occasion de rendre une rencontre possible, dont le sujet puisse se nourrir, à condition que l’autorité, même si elle appelle des sanctions, ne s’exerce pas pour humilier celui sur qui elle s’exerce. En miroir de ce que vit ce dernier on est toujours entre le risque de l’abandonner à la tyrannie de ces contraintes internes ou d’exercer une violence intrusive.
Le rapport rappelle qu’on ne connaît pas les causes de ces troubles du comportement mais qu’il existe des facteurs de risque multiples : familiaux, sociaux mais aussi génétiques. Il n’est pas question d’hérédité de type mendélien. Il n’y a pas de gène de la délinquance, de la violence pas plus que de tout trouble du comportement. Par contre oui il existe une héritabilité c’est-à-dire des facteurs appartenant à plusieurs gènes qui combinés entre eux vont influencer en particulier l’expression de nos émotions et leur intensité sur un mode plutôt qu’un autre. On ne choisit pas ses émotions. Elles surgissent du plus profond de notre cerveau biologique sans nous demander notre avis. Plus elles sont intenses plus elles risquent d’être contraignantes, c’est-à-dire difficiles à contrôler. C’est surtout le cas des émotions négatives, de rage, de peur, de colère… On devient alors dépendant de l’environnement qui les suscite, comme le taureau dans l’arène est dépendant du rouge que le torero agite devant ses yeux.
Or il s’agit bien d’un vrai problème de santé publique : parce que ces comportements augmentent de fréquence ces dernières années en raison de facteurs multiples et dont les conséquences cumulées font que l’absence croissante à la fois de limites et d’attention spécifique de la part des adultes équivaut à abandonner ces enfants à la violence de leurs réactions émotionnelles dont ils deviennent prisonniers. Ce sera d’autant plus vrai que ces enfants seront émotionnellement plus vulnérables. Le comprendre n’est pas les stigmatiser mais au contraire les aider ainsi que leur famille à réaliser que ce n’est pas nécessairement de leur faute s’ils sont ainsi et ont du mal à changer. Mais ils peuvent décider avec l’aide des parents de chercher des moyens pour retrouver plus de choix c’est-à-dire plus de liberté dans leur façon de réagir.
Aux adultes de les aider à trouver ces moyens.
Personne ne peut se targuer d’avoir la recette contre l’enfermement d’un enfant dans ses conduites destructrices. Quelles que puissent être les causes de sa souffrance il est injuste qu’il devienne involontairement son propre bourreau en se privant des apports dont il a besoin pour se développer. Il appartient aux adultes responsables de ne pas le laisser s’enfermer dans son comportement. Toute approche nouvelle efficace est une chance car elle permet, bien utilisée, d’élargir notre palette d’outils et d’accroî- tre pour l’intéressé ses chances de regagner en liberté. Ce débat en terme de combat n’a pas lieu d’être. Il est aussi stérile que désolant. Il se fait au détriment de l’intérêt de l’enfant, en principe point commun essentiel des protagonistes. Il contribue ainsi posé à dramatiser la situation et à inquiéter les parents au lieu de favoriser une indispensable alliance. C’est aux professionnels de s’entraider dans la recherche des outils les plus performants, plutôt que de jouer aux pompiers pyromanes. C’est bien à l’enfant et à sa famille à juger en fin de compte après essai ce qui semble le mieux convenir.
Ce rapport pourrait être une chance. A nous professionnels de la saisir. Il peut permettre de développer un véritable travail de prévention et de prendre conscience de l’ampleur des besoins. Une chance, oui, de sortir ces enfants de la véritable situation d’abandon où on les laisse. Car on est devant un problème de massification des besoins auquel l’approche purement individuelle qui prévaut actuellement ne peut répondre et qui ne peut concerner qu’une minorité, souvent privilégiée du fait de l’attention dont elle bénéficie. On ne peut continuer ainsi si on veut toucher la masse des enfants qui en ont le plus besoin. Au lieu une fois de plus de dépenser nos énergies en nous apostrophant pour défendre nos territoires et notre confort de pensée, acceptons de travailler ensemble en faisant confiance à tous les acteurs de terrain pour nous éviter de tomber dans des dérives toujours possibles ici ou là, mais qui nous menacent moins que le laisser-faire d’aujourd’hui. Celui-ci laisse bien seuls des parents et des enseignants bien placés pour savoir que ce n’est pas le conformisme social et l’obéissance qui menacent le plus nos écoles.
BIBLIOGRAPHIE — Le trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent. Édition Inserm, Paris, septembre 2005.
INFORMATION au nom du sous-groupe Vaccinations ** de la Commission VI-A (Maladies infectieuses et parasitaires)
La vaccination contre l’hépatite A en France
Yves BUISSON *
Quatorze ans après la mise sur le marché du premier vaccin contre l’hépatite A, la stratégie française de vaccination contre cette maladie reste minimaliste en se limitant à certaines catégories de personnes exposées à l’infection par leurs activités professionnelles ou leurs loisirs. L’épidémiologie de l’hépatite A change rapidement, en France comme dans tous les pays industrialisés, incitant à reconsidérer la position initiale vis-à-vis d’une vaccination efficace mais onéreuse, dont la prise en charge incombe soit aux employeurs, soit aux particuliers.
Données épidémiologiques
L’hépatite A est une maladie cosmopolite due au virus de l’hépatite A (VHA). Le mode principal de sa transmission est la voie féco-orale et sa distribution géographique est inégale, suivant le niveau de développement socioéconomique. Dans chaque pays, le taux d’immunisation à l’âge de 20 ans reflète la précocité de l’infection par le virus de l’hépatite A (VHA), permettant de distinguer des régions d’endémicité élevée (70-100 %), intermédiaire (20- 50 %), modérée (5-15 %) ou faible (moins de 5 %).
En France, une enquête de séroprévalence des anticorps anti-VHA répétée à cinq reprises entre 1978 et 1999 chez les jeunes recrues du service national a * Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine ** Constitué de Mmes BRUGERE-PICOUX, CHOISY, MM. ARMENGAUD, BASTIN, BAZIN, BÉGUÉ (président), BRICAIRE, BUISSON, CHASTEL, DENIS, DUBOIS. G, DURAND, FROTTIER (secrétaire), GERMAN, GIRARD, LAVERDANT, LE MINOR, PILET, PARODI, PECHERE, RERAT, REY, RICHARDLENOBLE, SANSONETTI, TIOLLAIS.
Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 1061-1067, séance du 9 mai 2006