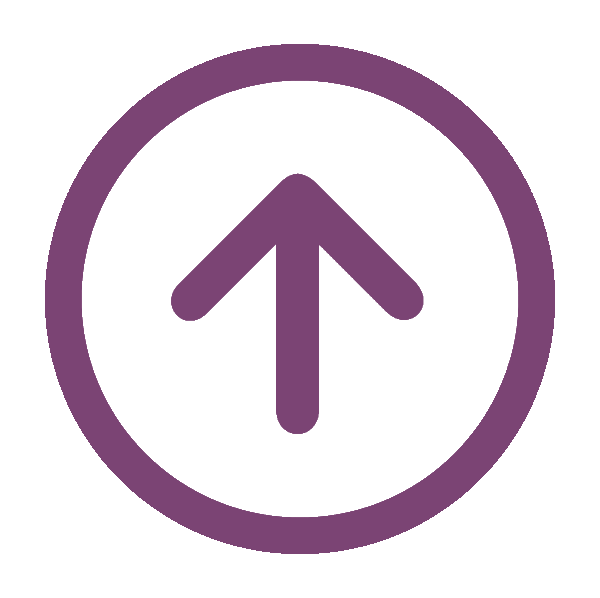Résumé
Au cours des dernières années, l’intérêt pour les troubles psycho-comportementaux des patients atteints de maladie de Parkinson s’est considérablement développé. Ces troubles entrent pour une bonne part dans l’altération de la qualité de la vie des malades et de leurs aidants. Syndromes dépressifs et anxieux, hallucinations et autres symptômes « psychotiques », apathie et troubles du contrôle des impulsions soulèvent de difficiles questions pathophysiologiques et font discuter la part des facteurs liés à une vulnérabilité prémorbide, à la maladie et à ses traitements pharmacologiques ou chirurgicaux. Les trop rares essais thérapeutiques contrôlés laissent souvent le clinicien en partie démuni devant ces troubles dont la prise en charge, conjointe avec un psychiatre, est souvent nécessaire.
Summary
Psychological and behavioral disorders associated with Parkinson’s disease can have a major impact on patients’ and caregivers’ quality of life. Depression, anxiety, psychotic symptoms (e.g. hallucinations), apathy and impulse-control disorders raise questions as to the respective roles of premorbid vulnerability, disease-related factors, and drug adverse effects. These disorders are often difficult to manage, and there is an unmet need for controlled trials in this field.
INTRODUCTION
La maladie de Parkinson (MP) n’est pas réductible à ses manifestations motrices.
L’intérêt pour les troubles mentaux de la MP a considérablement augmenté à partir des années 1970. La dopathérapie, les agonistes dopaminergiques puis le développement de la chirurgie fonctionnelle ont transformé la sémiologie psychocomportementale, soulevant de nouvelles questions pathophysiologiques et thérapeutiques.
DÉPRESSION
Sémiologie
Les syndromes dépressifs de la MP se traduisent par une tristesse de l’humeur, un pessimisme et une péjoration de l’avenir. L’anxiété associée est fréquente, les idées de culpabilité rares. Il existerait une fréquence élevée d’idées suicidaires [1], alors que la fréquence des suicides est débattue. Lorsque la dépression est inaugurale, le diagnostic de MP peut être difficile en l’absence de tremblement, car la lenteur parkinsonienne se confond avec le ralentissement dépressif. Inversement, à un stade tardif, la dépression peut être méconnue chez un sujet qui communique peu (notamment du fait de la dysarthrie ou de l’apathie) et/ou est atteint de troubles cognitifs. De plus, certains symptômes somatiques sont communs à la dépression et à la MP, et une apathie peut être présente sans dépression. Enfin, les variations de l’humeur et l’anxiété font partie des manifestations non-motrices des fluctuations, contribuant à rendre l’expérience de ces changements d’état particulièrement pénible.
Évaluation
La méthode de référence pour le diagnostic reste l’utilisation des critères du
Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV) de l’ American Psychiatric Association . Il existe de nombreuses échelles destinées au dépistage ou à la cotation de la dépression, mais toutes n’ont pas été validées pour la MP. Les échelles de dépression sont inégalement affectées par les symptômes somatiques. En effet, asthénie, ralentissement, insomnie, amaigrissement par exemple sont communs à la dépression et à la MP et peuvent biaiser le résultat.. Dix échelles ont fait l’objet d’une revue critique par un comité d’experts de la Movement Disorders Society [2]. Le choix de l’échelle dépend d’abord de son usage : dépistage ou cotation de la sévérité. Parmi les auto-questionnaires, l’inventaire de dépression de Beck (BDI) est l’un des plus utilisés à ces deux fins. Cependant, les échelles remplies par l’examinateur sont à privilégier, car elles ont des propriétés psychométriques plus intéressantes. C’est le cas de l’échelle de dépression de Hamilton et de celle de Montgomery-A Í sberg (MADRS). Chez les patients déments, l’échelle de Cornell ( Cornell Scale for Depression in Dementia ) peut être utilisée.
Prévalence et évolution
Une revue systématique des études transversales de prévalence conclut à la présence d’un trouble dépressif majeur chez 24 % de patients consultants externes et 8 % des patients dans les études ‘‘ en population ’’. La prévalence de symptômes ‘‘ cliniquement significatifs ’’ est, dans les mêmes types de population, respectivement de 40 % et 11 % [3]. Ces valeurs sont plus élevées que les prévalences observées dans la population générale. La dépression peut être inaugurale, ou précéder le début apparent de l’affection : au moment du diagnostic de MP, les patients ont plus souvent des antécédents de dépression que des sujets contrôles et, par ailleurs, un antécédent de dépression augmente le risque de développer ultérieurement une MP [4].
Facteurs associés
Plusieurs études ont essayé de dégager des facteurs de risque de dépression au cours de la MP[5]. Certains sont également retrouvés dans la population générale, en particulier les antécédents personnels ou familiaux de dépression. Parmi les caractéristiques de la maladie associées au risque de dépression figurent un âge de début précoce, une forme akinéto-rigide, et la prédominance droite des signes. On notera qu’une dépression précoce est liée à un risque plus élevé d’évolution vers la démence, et que l’existence de troubles cognitifs est associée à un risque accru de dépression.
Physiopathologie
La part respective des facteurs environnementaux et des facteurs de vulnérabilité neurobiologiques liés à l’individu ou à la maladie reste débattue. Plusieurs arguments plaident en faveur d’un lien étiopathogénique entre dépression et MP : la précession de la dépression par rapport au diagnostic de l’affection ; la prévalence de la dépression plus élevée qu’au cours d’autres affections invalidantes ; l’absence de corrélation claire entre sévérité des symptômes dépressifs et niveau de handicap ;
surtout, la possibilité de variations de la thymie parallèlement aux troubles moteurs chez les patients fluctuants. De plus, la stimulation à haute fréquence de la substance noire a pu induire un trouble thymique aigu et réversible, ce qui démontre qu’une altération du fonctionnement des ganglions de la base peut modifier l’humeur [6].
Au plan neurochimique, les travaux les plus anciens ont porté sur le rôle des systèmes sérotoninergiques, mais une étude récente en imagerie fonctionnelle suggère que la dépression et l’anxiété sont associées à une réduction spécifique de l’innervation dopaminergique et noradrénergique de plusieurs régions, corticales et sous-corticales, du système limbique [7].
Traitement
Certains agents dopaminergiques auraient, en plus de leur action antiparkinsonienne, un effet antidépresseur. Ainsi, le pramipexole a démontré une action antidépressive chez des patients non parkinsoniens et parkinsoniens dans des études contrôlées [8]. Les essais randomisés et contrôlés d’antidépresseurs classiques au cours de la MP sont rares, et plusieurs sont négatifs, possiblement en raison de l’amplitude de l’effet placebo [9]. Les essais concernant les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine (IRS) ont donné des résultats contradictoires [10]. En pratique, malgré le faible niveau de preuve de leur efficacité, il est raisonnable d’utiliser en première ligne un IRS ou un inhibiteur du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline, en respectant les précautions d’emploi en cas d’association à un IMAO B (sélégiline ; rasagiline), en raison du risque de syndrome sérotoninergique.
Certaines formes sévères de dépression peuvent relever de l’électro-convulsivothérapie, qui a aussi un effet transitoirement bénéfique sur le syndrome moteur. Plus récemment, la stimulation magnétique transcrânienne répétitive a donné des résultats encourageants [11], qui restent à confirmer par des études contrôlées. Un soutien psychologique, dont les modalités varient selon les cas, est nécessaire.
ANXIÉTÉ
Symptôme fréquent, l’anxiété de la MP a fait l’objet de peu de travaux spécifiques [12, 13]. Elle peut prendre plusieurs formes : trouble anxieux généralisé, attaques de panique, phobies (en particulier sociales), ou encore trouble anxieux n’entrant pas dans les catégories spécifiées dans le DSM. Au cours des fluctuations, l’anxiété peut précéder l’aggravation motrice de plusieurs minutes et conduire à des prises anticipées de L-dopa. L’anxiété constitue une des causes d’insomnie d’endormissement chez les patients atteints de MP. L’association à une dépression est fréquente.
L’anxiété participe à l’altération de la qualité de vie des patients.
Les études récentes ont utilisé les catégories et critères diagnostiques du DSM.
Parmi les échelles couramment utilisées en recherche clinique, aucune n’a été considérée par un groupe d’experts de la Movement Disorders Society comme suffisamment validée dans la MP pour en recommander l’usage [14]. La prévalence des troubles anxieux dans des études transversales est supérieure à celles de la population générale, aux alentours de 30 %, et atteint 50 % dans une étude longitudinale [13]. Comme pour la dépression, un lien entre anxiété et développement ultérieur d’une MP a été établi. Autre point commun, il existe un risque accru de trouble anxieux chez les apparentés de premier degré des patients parkinsoniens [15], ce qui suggère des facteurs communs de vulnérabilité génétique.
Le traitement de l’anxiété de la MP n’a pas fait l’objet d’essai contrôlé. Lorsque des crises d’angoisse sont rythmées par les fluctuations, le traitement est d’abord celui des fluctuations. Lorsqu’il est nécessaire, le traitement pharmacologique fait géné- ralement appel à un antidépresseur, éventuellement associé à de petites doses d’anxiolytique, en évitant les benzodiazépines, surtout chez les sujets âgés. Des abords non pharmacologiques peuvent être utiles : relaxation ou autre activité physique relaxante non médicalisée (gymnastiques « douces »), et dans certains cas psychothérapie.
HALLUCINATIONS ET AUTRES SYMPTO
Ù
MES « PSYCHOTIQUES »
Sémiologie [16]
Les hallucinations visuelles complexes mettent habituellement en scène des personnages, familiers ou non, des animaux et plus rarement des objets. Les visions sont souvent pauvres, statiques ou cinétiques, colorées ou non. Les hallucinations auditives sont rarement verbales et isolées, à la différence de celles des psychoses chroniques. Elles constituent volontiers la ‘‘ bande-son ’’ d’une hallucination visuelle, par exemple bruits de conversations de personnages immatériels. Les hallucinations tactiles (par exemple la sensation du passage d’un animal sur la peau) et olfactives sont rarement mentionnées, probablement faute d’être systématiquement recherchées. Les phénomènes hallucinatoires « mineurs » sont fréquents :
hallucinations de présence (sensation forte de la présence d’une personne, identifiée ou non, qui n’est pas vue) ou ‘‘ de passage ’’ (sensation fugace du passage d’un animal à la périphérie du champ visuel). On en rapproche les illusions visuelles, qui consistent en la mauvaise interprétation d’un stimulus réel, conduisant le plus souvent à voir quelque chose de vivant ou animé là où il y a quelque chose d’inerte.
Des idées délirantes sont possibles, habituellement paranoïdes. Les troubles de l’identification (tels que le syndrome de Capgras) sont plus rares, et s’observent chez des sujets déments.
Les hallucinations ont souvent une prédominance vespérale ou nocturne. Elles surviennent sous la forme d’épisodes brefs, parfois stéréotypés. La critique, c’est-à- dire la conscience du caractère hallucinatoire des phénomènes, est variable. Éventuellement différée, elle est la règle chez les patients indemnes de troubles cognitifs sévères. Les hallucinations sont alors généralement bien supportées et vécues avec un certain détachement. Chez les patients atteints de troubles cognitifs, la critique peut être abolie, ou ambiguë et fluctuante, laissant supposer une part résiduelle d’adhésion.
Évaluation
Les hallucinations de la MP sont incluses dans ce que les auteurs anglo-saxons nomment la « psychose » associée à la MP. Ce terme renvoie habituellement aux hallucinations, aux idées délirantes ou à une combinaison des deux. Un groupe d’experts a proposé des critères de psychose parkinsonienne [17] qui élargissent le spectre des phénomènes psychotiques qui incluent hallucinations, idées délirantes, sensations de présence et illusions. Ces symptômes doivent être apparus après la MP, être récurrents ou continus pendant au moins un mois et ne pas avoir d’autre cause identifiable, telle qu’une confusion. La recherche des hallucinations et de leurs caractéristiques repose sur l’interrogatoire des patients ou, en cas de troubles cognitifs sévères, de leur entourage. La plupart des études de prévalence ont utilisé soit des questionnaires structurés, soit l’item correspondant aux hallucinations dans la section I de l’Unified Parkinson’s Disease Rating Scale ou dans le Neuropsychiatric
Inventory (NPI) . Dans les essais thérapeutiques, la quantification des phénomènes « psychotiques » a été jusqu’à présent réalisée à l’aide d’échelles utilisées en psychiatrie pour évaluer les symptômes positifs de la schizophrénie. D’autres échelles, telles que le NPI, proviennent du champ de la démence. Les quelques échelles spécifiquement construites pour la MP sont mal validées. Aucune des échelles utilisées n’est pleinement satisfaisante, ce qui a conduit à la recommandation de l’élaboration et la validation d’un nouvel outil [18], un travail actuellement en cours.
Prévalence et évolution [19]
Dans les études transversales, la prévalence des hallucinations visuelles s’établit entre un quart et un tiers des patients. Les hallucinations auditives sont plus rares (généralement moins de 10 %), et les hallucinations dans d’autres modalités sensorielles sont rarement recherchées. Lorsque les illusions et les formes ‘‘ mineures ’’ d’hallucinations sont prises en compte, la prévalence ponctuelle atteint 40 %. La prévalence des hallucinations est plus élevée chez les sujets déments (entre 41 et 87 %), rejoignant les prévalences rapportées au cours des démences à corps de Lewy.
Les hallucinations commencent habituellement après plusieurs années d’évolution de la maladie. Un début précoce, dans les mois suivant l’instauration de la dopathé- rapie, doit faire évoquer d’autres diagnostics (démence à corps de Lewy, association à une psychose). Des études longitudinales ont montré l’augmentation de la prévalence périodique avec le temps, dépassant 50 % au-delà de dix ans. Chez un individu donné, les hallucinations tendant à persister, et même à s’aggraver avec la perte de la critique et (ou) l’apparition d’idées délirantes associées.
Facteurs associés [16, 19]
Longtemps considérées comme un simple effet indésirable des traitements dopaminergiques, les hallucinations sont à présent considérées comme la conséquence d’interactions complexes entre traitements et facteurs liés au patient et à sa maladie.
Facteurs pharmacologiques
Les hallucinations peuvent apparaître à l’instauration ou à l’augmentation d’un traitement dopaminergique, et régresser à la diminution ou à l’arrêt de celui-ci. Le rôle favorisant de la L-dopa est présumé mais non démontré. Dans les essais comparant un agoniste dopaminergique à la L-dopa ou à un placebo, les hallucinations sont plus fréquentes chez les sujets sous agoniste. Toutefois, un traitement dopaminergique n’est pas suffisant pour qu’apparaissent des hallucinations, et on relève que les patients hallucinés ne reçoivent pas de doses plus élevées de traitement dopaminergique que les patients indemnes d’hallucinations. Il n’est pas certain non plus qu’un traitement dopaminergique soit nécessaire à l’apparition des hallucinations, au moins à un stade tardif de la MP.
Facteurs liés à la maladie
L’existence de facteurs associés à la maladie est bien établie. Le principal d’entre eux est la présence de troubles cognitifs sévères. Les études visant à associer les hallucinations à des altérations dans des domaines cognitifs spécifiques n’ont pas apporté de résultats probants. On retient aussi l’association à une durée d’évolution de la MP plus longue et à un âge plus élevé ; à des troubles moteurs plus sévères (en particulier les troubles axiaux) ; possiblement à une dépression ; enfin à des troubles du sommeil et à des troubles visuels. Les troubles du sommeil associés aux hallucinations sont principalement une fragmentation du sommeil, l’existence de rêves ou cauchemars vivides et d’une somnolence diurne. Arnulf et al. [20] ont montré que, chez des patients parkinsoniens, des hallucinations diurnes pouvaient être associées à des intrusions de sommeil paradoxal, comme on peut l’observer dans la narcolepsie. Par ailleurs, un lien entre troubles visuels perceptifs et hallucinations visuelles est bien établi. Les hallucinations visuelles sont plus fréquentes chez les patients ayant des troubles visuels, liés à la MP et imputés à un dysfonctionnement rétinien, portant sur la vision des couleurs et des contrastes. Le rôle favorisant des ophtalmopathies coïncidentes est également probable. Il semble donc qu’une affé- rentation visuelle anormale augmente la probabilité d’être atteint d’hallucinations visuelles.
Physiopathologie [16]
Les données neurobiologiques sont d’une faible contribution à la compréhension des mécanismes des symptômes « psychotiques », et elles ne concernent que les hallucinations visuelles. Celles-ci sont associées à une densité plus élevée de corps de Lewy dans le lobe temporal, principalement la région parahippocampique et le complexe amygdalien. D’un point de vue neurochimique, on a proposé un lien entre hallucinations visuelles et hyperstimulation dopaminergique, notamment des structures méso-cortico-limbiques. Pour d’autres auteurs, l’intensité du déficit cholinergique cortical ou le déséquilibre monoaminergique-cholinergique ont un rôle pré- pondérant. Dans tous les cas, les arguments sont indirects, pharmacologiques ou théoriques. Finalement, il est difficile d’avancer un schéma pathophysiologique simple intégrant toutes les données disponibles. On peut concevoir les hallucinations visuelles comme un phénomène multifactoriel, résultant de l’activation anormale du cortex visuel associatif. Cette activation résulte probablement de facteurs pharmacologiques, mais aussi d’une altération de la perception visuelle touchant aussi bien le traitement des stimuli à partir de la périphérie (mécanismes ‘‘ bottomup ’’) que la modulation de l’intégration de ces stimuli par des structures frontales et temporales (mécanismes ‘‘ top-down ’’). L’implication de ces deux grands mécanismes de la vision est étayée par les données provenant de l’imagerie fonctionnelle. Par ailleurs, une dérégulation des mécanismes de l’alternance veille-sommeil et des rêves joue probablement aussi un rôle, au moins chez certains patients.
Traitement [16, 21]
Dans la majorité des cas, les hallucinations ne nécessitent pas d’intervention thérapeutique, car elles sont intermittentes et bien supportées. Elles justifient néanmoins de réviser le traitement et de réaliser un bilan cognitif. Des mesures plus vigoureuses sont nécessaires lorsque les hallucinations sont angoissantes et (ou) s’accompagnent de troubles du comportement compromettant le maintien à domicile. Dans un premier temps, tout médicament non indispensable et potentiellement aggravant (anticholinergiques, psychotropes, antalgiques opiacés) est supprimé. Le traitement antiparkinsonien est réduit et simplifié, dans le sens d’une monothérapie par la L-dopa s’il existe des troubles cognitifs. Dans ce dernier cas, la prescription d’un inhibiteur de l’acétylcholinestérase peut avoir un effet favorable sur les hallucinations, mais cet effet n’a pas été confirmé par des essais contrôlés. S’il n’y a pas de trouble cognitif notable, ou en l’absence d’efficacité d’un médicament procholinergique, ou encore d’emblée en cas de situation menaçante, un traitement antipsychotique est indispensable. Les neuroleptiques ‘‘ classiques ’’ sont proscrits, ainsi que la plupart des antipsychotiques ‘‘ atypiques ’’ (tels que la risperidone et l’olanzapine) qui exposent aussi au risque d’aggravation du syndrome parkinsonien. Le traitement repose sur la clozapine qui a démontré son efficacité dans cette indication dans deux études contrôlées. Sa prescription nécessite une surveillance codifiée de la NFS, en raison du risque d’agranulocytose. D’autres molécules sont en cours d’évaluation dans le traitement de la ‘‘ psychose ’’ parkinsonienne, notamment la pimavansérine, un antagoniste sélectif des récepteurs 5-HT .
2A APATHIE
L’intérêt pour l’apathie s’est développé après la redéfinition par Marin de ce symptôme comme entité autonome traduisant un trouble de la motivation. Les difficultés de définition et de diagnostic ont conduit un groupe d’experts à proposer des critères diagnostiques [22] : l’apathie y est définie comme une baisse de la motivation, constatée par le malade ou l’entourage, persistant depuis au moins quatre semaines, et ayant un retentissement fonctionnel. Deux des trois dimensions de l’apathie, réduction des comportements dirigés vers un but, de l’activité cognitive dirigée vers un but et des émotions doivent être présentes. L’apathie doit être distinguée de l’anhédonie, symptôme habituellement défini comme l’inaptitude à ressentir du plaisir qui peut faire partie du syndrome apathique, mais constitue aussi un symptôme dépressif [23].
L’évaluation quantifiée de l’apathie repose sur des échelles spécifiques. Les plus intéressantes sont l’échelle d’apathie de Starkstein et la plus récente échelle de Lille ( Lille Apathy Rating Scale ) [23]. L’apathie concerne environ un tiers des patients, les valeurs variant selon les études de 16,5 à 42 % en raison de l’hétérogénéité des populations et surtout des méthodes d’évaluation [24]. Le niveau d’apathie n’est pas corrélé à la dépression ou à l’anxiété, mais aux performances à diverses tâches cognitives, notamment exécutives [24, 25]. De surcroît, l’existence d’une apathie est prédictive de la survenue ultérieure d’un déclin cognitif ou d’une démence [26].
Certains font de l’apathie une composante d’un fonctionnement hypodopaminergique, à côté de l’anxiété et de la dépression [27]. Les régions impliquées dans la motivation paraissent être principalement le cortex orbitaire et cingulaire antérieur, ainsi que les régions striato-pallidales. Pour Levy et Czernicki, l’apathie est un syndrome hétérogène avec trois sous-types correspondant à des troubles émotionnel, cognitif et de l’auto-activation, chacun de ces sous-types correspondant au dysfonctionnement de circuits distincts unissant le cortex préfrontal aux ganglions de la base [28].
Aucun traitement pharmacologique n’a fait la preuve de son efficacité sur l’apathie dans une étude contrôlée. Les médicaments antidépresseurs sont inefficaces en dehors d’une comorbidité dépressive. Le traitement dopaminergique semble avoir un effet au moins partiellement favorable [29].
TROUBLES DU CONTRO
Ù
LE DES IMPULSIONS ET COMPORTEMENTS
RÉPÉTITIFS
Au cours des dernières années, de nombreux travaux ont été consacrés à des troubles du comportement, favorisés par les traitements dopaminergiques et caractérisés par un défaut de contrôle des impulsions et (ou) un caractère répétitif. Ces troubles du contrôle des impulsions (TCI) sont potentiellement graves et peuvent avoir des conséquences médico-légales.
Sémiologie [30, 31]
Les principaux TCI rapportés chez les patients atteints de MP sont : — la pratique pathologique de jeux d’argent, avec des conséquences financières et familiales parfois désastreuses ; — des achats pathologiques par leur caractère répété, non indispensable et/ou inadapté au budget du patient ; — une hypersexualité, avec augmentation de la libido et recherche de plaisir sexuel, auprès de la conjointe, parfois victime d’un harcèlement, ou à travers des pratiques pouvant prendre un caractère déviant ; — des troubles du comportement alimentaire, sous la forme d’accès boulimiques nocturnes ou de grignotage fréquent de sucreries ; — une addiction à la lévodopa ou plus rarement aux agonistes dopaminergiques, décrite aussi, en association à d’autres troubles du contrôle des pulsions, sous le nom de ‘‘ syndrome de dérégulation dopaminergique ’’ : les patients, augmentent les doses de leur traitement, de manière anarchique, au prix de dyskinésies sévères. D’autres troubles ont été décrits, tels que des ‘‘ errances ’’, parfois loin du domicile, sans but identifié, ou le développement d’une kleptomanie. Enfin, le punding désigne un comportement répétitif plutôt qu’impulsif, sous la forme de manipulations d’objets, stéréotypées, sans finalité ou sans efficacité. Tel patient, par exemple, passe des heures à démonter et remonter un moteur de moto. Les TCI peuvent s’associer entre eux et s’accompagner d’un trouble de l’humeur (hypomanie ou dépression), avec insomnie. La limite entre comportements normaux et pathologiques peut être difficile à tracer. Ainsi, certains patients consacrent beaucoup de temps à une activité de loisirs, ou développent une activité créative (peinture, théâtre, …), cette activité pouvant être bien vécue par le malade et l’entourage, tant qu’elle ne prend pas une dimension addictive.
Évaluation et prévalence
Des critères pour les principaux TCI, issus principalement du champ de la psychiatrie, ont servi aux études cliniques. Des questionnaires de dépistage ou des échelles d’évaluation plus complètes sont disponibles ou en cours de validation [27]. En pratique, l’essentiel est d’interroger systématiquement les patients à la recherche des principaux TCI, en essayant d’avoir le point de vue du conjoint ou d’un aidant, car certains patients minimisent ou taisent leurs TCI. Une étude systématique portant sur plus de 3 000 patients nord-américains a retenu le diagnostic de jeu pathologique chez 5 %, des achats compulsifs chez 5,7 %, un comportement sexuel compulsif chez 3,5 %, et des accès boulimiques chez 4,3 % [32]. L’un de ces TCI était présent chez 13,6 % des patients, et environ 4 % en avaient au moins deux. Les études sur l’addiction à la lévodopa sont plus rares. Elle concernerait 3 à 4 % des malades. La prévalence cumulée des TCI est probablement plus élevée que ne le laissent supposer les études transversales. Il n’existe pas encore d’études de prévalence réalisées au sein de la population générale.
Facteurs associés [30-32]
Plusieurs études transversales ont permis de dégager trois types de facteurs associés aux TCI. Les facteurs pharmacologiques sont représentés par un traitement par agoniste dopaminergique, surtout à fortes doses, et, plus rarement, l’utilisation de la lévodopa. Ces médicaments peuvent favoriser l’émergence d’un TCI en l’absence d’une MP : des cas ont été rapportés chez des sujets traités pour un syndrome des jambes sans repos. Le second facteur, lié à la maladie, est constitué par un début précoce. Enfin, il existe des facteurs liés au patient : tendance prémorbide à jouer, dépendance au tabac ou autres addictions, sexe masculin (pour l’hypersexualité).
Une histoire familiale de jeu pathologique est aussi associée à un risque accru de TCI.
Physiopathologie
Les TCI sont considérés comme des comportements « hyperdopaminergiques » [27]. Ils résulteraient d’une action du traitement sur les boucles cortico-souscorticales associatives et limbiques impliquées dans la récompense, la motivation, le contrôle des impulsions, et la flexibilité cognitive. L’association des TCI à l’usage des agonistes dopaminergiques récents, non ergotés, pourrait s’expliquer par leur profil pharmacologique : leur affinité particulière pour les récepteurs D3, abondants dans le striatum ventral, une région impliquée dans les troubles addictifs [31, 32].
Traitement
La prévention et le dépistage précoce sont essentiels. Ils reposent avant tout sur une information claire et détaillée fournie au patient, et si possible à l’aidant principal, en veillant à sa traçabilité. Chez les sujets à risque, le rapport bénéfice/risque d’un renforcement du traitement dopaminergique doit être pesé.
Le traitement des TCI associés à la prise d’agonistes dopaminergiques repose d’abord sur la réduction, et si nécessaire l’arrêt de l’agoniste, en rééquilibrant le traitement à l’aide de la lévodopa. Malheureusement, cette mesure n’est pas toujours efficace ou réalisable (le patient continue à prendre des doses excessives de traitement dopaminergique). L’intérêt des IRS dans ce contexte est discuté. L’inté- rêt potentiel du zonisamide, de la naltrexone, ou encore de l’acamprosate doit être confirmé par des études contrôlées. Dans quelques cas d’hypersexualité, un effet bénéfique de la clozapine a été rapporté et, chez l’homme, le cyprotérone, a été proposé. Au cours du jeu ou d’achats pathologiques, des dépenses excessives persistantes peuvent justifier des mesures de protection financière. Dans la plupart des cas, une prise en charge psychiatrique associée est utile pour le traitement de comorbidités psychiatriques (dépression, anxiété) et l’orientation vers des abords non pharmacologiques, tels que les thérapies cognitivo-comportementales.
TROUBLES PSYCHIQUES APRÈS CHIRURGIE FONCTIONNELLE
La stimulation cérébrale profonde, en règle subthalamique bilatérale, peut avoir des conséquences neuro-psychiatriques [33]. Les complications post-opératoires précoces incluent des confusions, plus rarement des hallucinations et des épisodes d’hypomanie. Dans les semaines ou mois suivant l’intervention, une dépression peut survenir dans une minorité des cas, avec pour principal facteur de risque l’existence d’antécédents de dépression sévère. Cependant, les études de l’évolution de groupes de patients opérés montrent soit une stabilité, soit une amélioration des scores moyens de dépression. Il en est de même pour les scores à des échelles d’anxiété [34].
Un taux anormalement élevé de suicides et tentatives de suicide a été rapporté (respectivement 0,45 % et 0,90 % dans une grande étude multicentrique [35]). Si le principal facteur associé au suicide est l’existence d’une dépression post-opératoire, celle-ci peut manquer, suggérant le rôle d’une augmentation de l’impulsivité. Les études consacrées à l’apathie, montrent soit une stabilité, soit une augmentation des scores. L’existence pré-opératoire de fluctuations non-motrices, dans la vie quotidienne ou au cours d’un test à la lévodopa, constitue un facteur prédictif de l’aggravation post-opératoire de l’apathie [36]. L’interprétation des dépressions et de l’apathie post-opératoire est difficile, car ces complications peuvent relever du sevrage relatif en agents dopaminergiques, ou (et) de l’effet direct de la stimulation subthalamique, dont on sait qu’elle modifie l’activité de régions préfrontales et orbito-frontales du cortex [37]. Des facteurs psychologiques peuvent aussi intervenir dans les dépressions lorsqu’il existe une déception par rapport à une attente de résultat non réaliste.
Les effets de la stimulation subthalamique sur les TCI pré-opératoires sont contrastés. L’addiction à la dopa peut être source de difficultés post-opératoires, lorsque les doses doivent être réduites. En revanche, lorsque le TCI est associé à de fortes doses d’agonistes, la stimulation et la réduction de traitement post-opératoire ont souvent un effet bénéfique, mais quelques cas de déclenchement d’un TCI ou une augmentation de l’impulsivité après l’intervention ont aussi été rapportés. Ces données en apparence contradictoires résultent probablement d’interactions complexes entre la stimulation des noyaux subthalamiques et la réduction du traitement dopaminergique [38].
Ces complications soulignent la nécessité d’une sélection rigoureuse des patients candidats à la stimulation cérébrale profonde, prenant en compte les antécédents psychiatriques, et celle de la surveillance attentive de l’état psychologique des patients dans la période post-opératoire.
BIBIOGRAPHIE [1] Nazem S., Siderowf A.D., Duda J.E. et al. — Suicidal and death ideation in Parkisnon’s disease.
Mov. Disord., 2008, 23 , 1573-1579.
[2] Schrag A., Barone P., Brown RG et al. — Depression rating scales in Parkinson’s disease:
critique and recommendations.
Mov. Disord., 2007, 22 , 1077-1092.
[3] Reijnders J.S.A.M., Ehrt U., Weber W.E.J., Aarsland D., Leentjens A.F.G. — A systematic review of prevalence studies of depression in Parkinson’s disease. Mov. Disord., 2008, 23 , 183-189.
[4] Ishihara L., Brayne C. — A systematic review of depression and mental illness preceding Parkinson’s disease. Acta Neurol. Scand., 2006, 113 , 211-220.
[5] Leentjens A.F.G. — Depression in Parkinson’s disease: conceptual issues and clinical challenges. J. Geriatr. Psychiatry Neurol., 2004, 17 , 120-126.
[6] Bejjani B.P., Damier P., Arnulf I. et al. — Transient acute depression induced by highfrequency deep-brain stimulation . New Engl. J Med., 1999, 340 , 1476-1480.
[7] Remy P., Doder M., Lees A.J. et al. — Decrease of dopamine and noradrenaline innervation in the limbic system of depressed Parkinson’s disease patients.
Brain, 2005, 128 , 1314-1322.
[8] Barone P., Poewe W., Albrecht S. et al. — Pramipexole for the treatment of depressive symptoms in patients with Parkinson’s disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol., 2010, 9 , 573-80.
[9] Weintraub D., Morales K.H., Moberg P.J. et al. — Antidepressant studies in Parkinson’s disease: a review and meta-analysis.
Mov. Disord., 2005, 9 , 1161-1169.
[10] Okun M.S., Fernandez H.H. — Will tricyclic antidepressants make a come back for depressed Parkinson disease patients? Neurology, 2009, 72 , 868-869.
[11] Fregni F., Ono C.R., Santos C.M., Bermpohi F. — Effects of antidepressants treatment with rTMS and fluoxetine on brain perfusion in Parkinson’s disease. Neurology, 2006, 66 , 1629- 1637.
[12] Weisskopf M.G., Chen H., Schwarzchild M.A., Kawachi I., Ascherio A. — Prospective study of phobic anxiety and risk of Parkinson’s disease. Mov. Disord., 2003, 18, 646-651.
[13] Pontone G.M., Williams J.R., Anderson K.E. et al . — Prevalence of anxiety disorders and anxiety subtypes in patients with Parkinson’s disease.
Mov. Disord., 2009, 24, 1333-1338.
[14] Leentjens A.F.G., Dujardin K., Marsh L. et al. — Anxiety rating scales in Parkinson’s disease : critique and recommendations.
Mov. Disord., 2008, 23 , 2015-2025.
[15] Arabia G., Grossardt B.R., Geda Y.E. et al . — Increased risk of depressive and anxiety disorders in relatives of patients with Parkinson’s disease.
Arch. Gen. Psychiatry, 2007, 64 , 1385-1392.
[16] Diederich N., Fénelon G., Stebbins G., Goetz C.G. — Hallucinations in Parkinson disease.
Nature Reviews Neurology, 2009, 5, 331-342.
[17] Ravina B., Marder K., Fernandez H.H. et al. — Diagnostic criteria for psychosis in
Parkinson’s disease: report of an NINDS, NIMH work group.
Mov. Disord., 2007, 22 , 1061-1068.
[18] Fernandez H.H., Aarsland D., Fénelon G. et al. — Scales to assess psychosis in Parkinson’s disease : critique and recommendations.
Mov. Disord ., 2008, 23 , 484-500.
[19] Fénelon G., Alves G. — Epidemiology of psychosis in Parkinson’s disease.
J. Neurol. Sci., 2010, 289 , 12-17.
[20] Arnulf I., Bonnet A.M., Damier P. et al. — Hallucinations, REM sleep, and Parkinson’s disease. A medical hypothesis.
Neurology, 2000, 55 , 281-288.
[21] Fénelon G. — Hallucinations and Parkinson’s disease. In Laroi F, Aleman A (eds). Hallucinations: a guide to treatment and management. Oxford: Oxford University Press, 2010.
[22] Robert P., Onyike C.U., Leentjens A.F.G. et al. — Proposed diagnostic criteria for apathy in
Alzheimer’s disease and other neuropsychiatric disorders.
Eur. Psychiatry, 2009, 24 , 98-104.
[23] Leentjens A.F.G., Dujardin K., Marsh L. et al . — Apathy and anhedonia rating scales in
Parkinson’s disease: critique and recommendations.
Mov. Disord., 2008, 23 , 2004-2014.
[24] Dujardin K., Sockeel P., Devos D. et al . — Characteristics of apathy in Parkinson’s disease.
Mov. Disord., 2007, 22 , 778-784.
[25] Isella V., Melzi P., Grimaldi M. et al. — Clinical, neuropsychological, and morphometric correlates of apathy in Parkinson’s disease.
Mov. Disord., 2002, 17 , 366-371.
[26] Dujardin K., Sockeel P., Delliaux M., Destée A., Defebvre L. — Apathy may herald cognitive decline and dementia inParkinson’s disease. Mov. Disord., 2009, 24, 2391-2397.
[27] Ardouin C., Chéreau I., Llorca P.M. et al . — Évaluation des troubles comportementaux hyper- et hypodopaminergiques dans la MP.
Rev. Neurol. (Paris), 2009, 165 , 845-856.
[28] Lévy R., Czernecki V. — Apathy and the basal ganglia.
J. Neurol., 2006, 253 (suppl 7), 54-61.
[29] Czernecki V., Pillon B., Houéto J-L et al . Motivation, reward, and Parkinson’s disease:
influence of dopatherapy.
Neuropsychologia, 2002, 40 , 2257-2267.
[30] Voon V., Fox S.H. — Medication-related impulse control and repetitive behaviors in Parkinson disease. Arch. Neurol., 2007, 64 , 1089-1096.
[31] Evans A.H., Strafella A.P., Weintraub D., Stacy M. — Impulsive and compulsive behaviors in Parkinson’s disease. Mov. Disord., 2009, 24 , 1561-1570.
[32] Weintraub D., Koester J., Potenza M.N. et al. — Impulse control disorders in Parkinson disease. A cross-sectional study of 3090 patients.
Arch. Neurol., 2010, 67 , 589-595.
[33] Deuschl G., Herzog J., Kleiner-Fisman G. et al. — Deep brain stimulation: postoperative issues.
Mov. Disord., 2006, 21 (suppl 14), S219-S237.
[34] Witt K., Daniels C., Reiff J. et al. — Neuropsychological and psychiatric changes after deep brain stimulation for Parkinson’s disease: a randomised, multicentre study.
Lancet Neurol., 2008, 7 , 605-614.
[35] Voon V., Krack P., Lang A.E. et al. — A multicentre study on suicide outcomes following subthalamic stimulation for Parkinson’s disease.
Brain, 2008, 131, 2720-2728.
[36] Thobois S., Ardouin C., Lhommée E et al . — Non-motor dopamine withdrawal syndrome after surgery for Parkinson’s diease: predictors and underlying dopaminergic denervation.
Brain, 2010, 133 , 1111-1127.
[37] Le Jeune F., Péron J., Grandjean D. et al. — Subthalamic nucleus stimulation affects limbic and associative cirduits: a PET study.
Eur. J. Med. Mol. Imaging, 2010, 37 , 1512-1520.
[38] Robert G., Drapier D., Vérin M., Millet B., Azulay J.P., Blin O. — Cognitive impulsivity in Parkinson’s disease patients: assessment and pathophysiology. Mov. Disord. , 2009, 24 , 2316-2327.
DISCUSSION
M. Jacques-Louis BINET
Dans une de vos premières diapositives, vous avez montré trois images peintes par des parkinsoniens. Comment classez-vous ces images ? Comment les classez-vous dans votre analyse ?
Il s’agit de reproductions publiées et non de documents personnels. Deux des images (des personnages entremêlés et un éléphant sous une chaise) ont été peintes par des sujets parkinsoniens afin de donner une idée de leurs hallucinations visuelles. La troisième image est plus intéressante, car elle illustre une illusion visuelle ressentie par une artiste parkinsonienne. Sur une photographie de l’écorce d’un arbre, la patiente a ajouté quelques touches de couleur évoquant la forme d’un visage. Des illusions visuelles (c’est-à-dire la mauvaise interprétation d’un stimulus réel) peuvent toucher jusqu’à un quart des patients, et elles consistent habituellement, comme chez cette malade, à voir un corps, un visage ou un animal à la place d’un élément inanimé.
M. Jean-Jacques HAUW
Comment traite-t-on les hallucinations les plus sévères, les neuroleptiques étant contreindiqués dans la maladie de Parkinson ?
Les hallucinations peuvent être bien supportées et ne pas nécessiter d’intervention thérapeutique. Dès qu’elles deviennent anxiogènes, le premier traitement est l’allégement thérapeutique (réduction ou suppression des médicaments psychotropes et des antiparkinsoniens, en dehors de la L-dopa). Lorsqu’il existe des troubles cognitifs, l’adjonction d’un médicament pro-cholinergique (anti-cholinestérasique) peut avoir un effet favorable sur les hallucinations, mais, à ce jour, cet effet n’est pas confirmé par des études contrôlées. Enfin, dans les cas les plus sévères, les neuroleptiques sont en effet contreindiqués. Le seul anti-psychotique utilisable est la clozapine, qui a démontré un effet anti-hallucinatoire à faibles doses dans des essais contrôlés. Elle n’aggrave pas le syndrome parkinsonien, mais sa prescription nécessite une surveillance hématologique codifiée en raison du risque d’agranulocytose.
Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 7, 1305-1319, séance du 12 octobre 2010