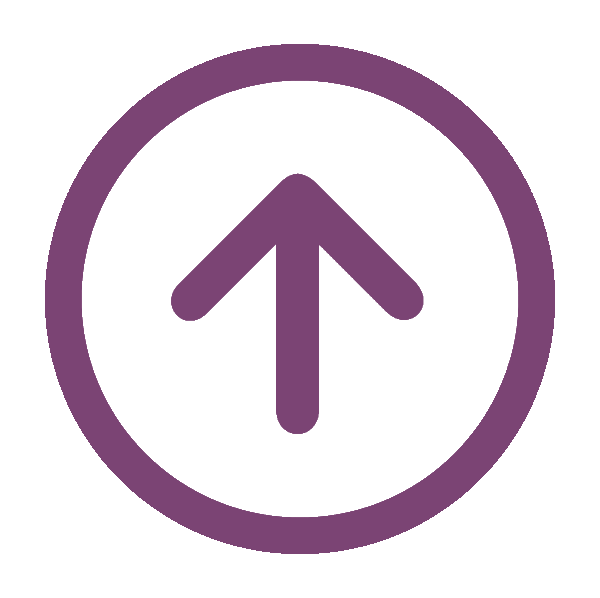Résumé
A priori, l’application des valeurs et des repères qui fondent l’éthique biomédicale semble peu compatible avec des explorations menées sur un cadavre. Du moins, lorsque l’on estime que les notions d’intérêt et de bien ne doivent que concerner la personne elle-même, ce qui, nécessairement, compromettrait toute pratique visant d’autres fins. C’est dire que l’autopsie ne s’avère éthiquement justifiable que lorsque son intérêt est explicitement démontré. Pour autant, certaines formes doivent être respectées, faute de quoi, la réprobation suscitée par des dérives caractérisées, réfute cet intérêt même. Afin de surmonter les équivoques et de déterminer, malgré tout, une modalité morale conciliable avec certaines exigences médicoscientifiques, nous pourrions retenir le principe d’exception d’autopsie. Parce que de telles explorations justifient des conduites absolument irréprochables, il convient que les sociétés savantes et les instances compétentes se dotent des méthodes et des moyens qui garantissent de manière incontestable la pertinence et la qualité des pratiques.
Summary
It does not seem a priori easy to implement the usual values and milestones of biomedicalethics with explorations performed on a corpse. This is true, at least, when it isconsidered that the concepts of welfare and benefit concern only the human being himself. This necessarily precludes any practice conducted with another aim. Thus, autopsy cannot be ethically justified unless its usefulness is expressly demonstrated. Furthermore, some conventions should be respected, otherwise the reprobation induced by characterised deviations would anihilate even this usefulness. To overcome ambiguities, and conceive, despite everything, a moral procedure which would be reconcilable with some medico-scientific necessities, the exemption principle may be proposed for autopsy. Because explorations performed on a corpse impose definitely irreproachable behaviours, learned societies and authorities should build up means and methods to unquestionably guarantee the relevance and soundness of practice.
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Qu’attendons-nous ? Qu’est-ce qui nous attend ?
Ernst Bloch [1] UNE PRATIQUE DE L’EXTRÊME
L’autopsie, en tant que telle, justifie-t-elle une approche spécifiquement éthique ? Je n’en suis pas convaincu. Du reste, le nombre très limité d’études consacrées aux aspects éthiques de l’autopsie, s’avère à bien des égards significatif. Dès lors qu’on la considère comme relevant d’une activité biomédicale pertinente — « L’autopsie est le dernier acte thérapeutique important, y compris pour la famille à laquelle il peut être conseillé ; c’est aussi une façon d’évaluer la bonne qualité des soins (…) [2] » — des règles déontologiques strictes encadrent cette pratique : « La collecte de sang ainsi que les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules ou d’autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi [3] ». Elle se doit d’être respectueuse des principes moraux qui fondent notre morale sociale mais aussi notre vie démocratique : « … la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe de valeur constitutionnelle [4] ».
Il conviendrait donc plutôt d’aborder les conditions susceptibles de préserver, en cas d’autopsie, la dignité de la personne morte et de ses proches, ce qui orienterait notre réflexion vers des thèmes qui concernent le respect du défunt — « … Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après sa mort [5] » — de son intimité, de sa volonté, la préservation de ses droits, le soin et le devenir de son corps, nos attitudes de considération pour ses proches, mais tout autant l’exercice de nos solidarités sociales.
Aux extrêmes de la médecine et aux limites de nos facultés d’acceptation d’un acte qui affecte nos conceptions les plus intimes des devoirs qui nous incombent à l’égard de la personne morte, la nécropsie semble même difficilement conciliable avec les principes du droit. Ainsi, l’article 16-3 du Code civil stipule : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. » On constatera que l’esprit de la loi no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain est en quelque sorte altéré par la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative, en particulier, au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain. En effet, elle détermine les modalités de prélèvements sur une personne
décédée à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sans être en mesure de prendre en compte, ce qui paraît logique, la notion de nécessité thérapeutique pour la personne [6]. Seul le respect des modalités d’expression du consentement présumé (fins thérapeutiques : « … Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement …
[7] ») ou exprès (fins scientifiques : « Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès, ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa famille … [8] »), s’avère de nature à rétablir une forme de règle et d’équilibre dans ce contexte d’équivoque du droit.
L’autopsie n’apparaît pas explicitement dans la loi, comme si, par prudence, le législateur avait souhaité l’assimiler à une procédure strictement médicoscientifique, identique à un acte thérapeutique ou à une expérimentation. Dès lors, se poserait malgré tout la question centrale que formule à juste titre la Convention sur les droits de l’homme et la médecine ou la Déclaration d’Helsinki [9] : « L’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science [10]. » Comment, de surcroît, comprendre et intégrer certains principes consacrés par le Rapport Belmont [11] (bienveillance, respect de la sphère privée et justice), dès lors qu’ils concerneraient la personne morte ?
A priori , l’application des valeurs et des repères qui fondent l’éthique biomédicale semble peu compatible avec des explorations menées sur un cadavre. Du moins, lorsque l’on estime que les notions d’intérêt et de bien ne doivent concerner que la personne elle-même, ce qui, nécessairement, compromettrait toute pratique visant d’autres fins. On l’a compris, la mort renvoie les considérations morales à des perspectives d’une toute autre nature, sans pour autant nous dégager de responsabilités spécifiques à l’égard du mort. Il conviendrait de mieux les identifier afin de les prendre en compte dans la réalité.
En fait, il n’est pas aisé d’appréhender la notion d’intérêt appliquée à l’autopsie, puisqu’elle ne peut jamais concerner directement la personne autopsiée. C’est ce qui explique, pour une bonne part, les difficultés qu’on éprouve à évoquer les pratiques liées à l’utilisation du cadavre, à en expliquer l’importance, voire à les situer à leur juste niveau d’intérêt supérieur. On persiste alors dans le registre de l’allusion ou de l’évitement, sans considérer la signification possible de cette approche du corps, certainement nécessaire car sans alternative, dans des circonstances déterminées.
C’est dire que l’autopsie ne s’avère éthiquement justifiable que lorsque son intérêt est explicitement démontré. Pour autant, certaines formes doivent être respectées, faute de quoi, la réprobation suscitée par des dérives caractérisées, réfute cet intérêt même, avec les conséquences constatées aujourd’hui, du fait des obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de nécropsies médico-scientifiques.
D’un point de vue moral, est-il acceptable de refuser une investigation qui, bien que perçue comme une possible violation du cadavre — « Chacun a droit au respect de
son corps. Le corps humain est inviolable. (…) [12] » — devrait viser, avant toute autre considération, à servir l’intérêt de tous ? La réponse semble directement conditionnée par les conduites en vigueur dans ce champ très particulier de la médecine et de la recherche. Elles se doivent de prémunir le corps des excès d’une indignité, qui tient pour beaucoup à la perception de sa relégation à l’état d’instrument.
La morale Kantienne trouve en ces circonstances une dimension particulière :
« L’impératif pratique sera donc celui-ci : Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais comme un moyen [13]. » Objet d’investigations intrusives, comment est-il possible de réhabiliter la condition d’un cadavre, afin de le considérer autrement qu’un moyen et de l’honorer en tant que fin ? Telle est une interrogation d’ordre éthique que les anatomo-pathologistes se devraient d’assumer.
RÉHABILITER UNE MORALE DE L’AUTOPSIE
Il serait réducteur et contestable, de ne considérer l’autopsie que du point de vue des sentiments et des réactions contrastées qu’elle a suscités à travers les époques. On le sait, les préjugés procèdent pour beaucoup du sens attribué, dans des contextes particuliers, à cette intervention sur le cadavre, voire à son usage pour des fins autres que médicales.
Selon les circonstances et en dépit de son caractère jugé souvent immoral, puisque de nature à affecter l’intégrité de la dépouille mortelle, voire à la désacraliser, l’autopsie a nécessairement imposé un regard différent sur la relation entre la vie et la mort et d’une certaine manière entre les vivants et les morts : « Ouvrez quelque cadavre : vous verrez aussitôt disparaître l’obscurité que la seule observation n’avait su dissiper. La nuit vivante dissipe la clarté de la mort [14] ». Il s’agirait, en quelque sorte, d’un rapport de responsabilités partagées au-delà de l’existence, ce qui, en soit, justifierait des approfondissements de nature à éclairer nos pratiques en matière de prélèvements d’organes et donc d’usage du cadavre.
S’il est une sacralité, elle relève alors de la valeur de l’engagement qui lie des personnes au service du bien de l’humanité.
J’éprouve donc quelques difficultés à concevoir, dans notre environnement spirituel et moral actuel, pour beaucoup influencé par une culture laïque, ce à quoi renvoie la sacralisation du corps mort au regard de la nécropsie. Si ce n’est à l’expression d’un besoin de décence, de mesure et de limites, donc de règles intangibles face aux possibles excès d’une médecine expérimentale, pour reprendre la formule de Claude Bernard.
À vouloir dramatiser les circonstances induites par la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 en termes de réduction du nombre des autopsies désormais réalisables, le discours
tenu par des anatomo-pathologistes n’a pas su pour autant expliciter et justifier de manière appropriée et convaincante. Les positions semblent parfois renvoyer à une médecine d’une époque considérée révolue. Certains propos nous font en effet éprouver la curieuse sensation de nous retrouver en 1856, date de parution de l’ Introduction à l’étude de la médecine expérimentale [15] : « Dans la science, c’est l’idée qui donne aux faits leur valeur et leur signification. Il en est de même dans la morale… Le chirurgien, le physiologiste et Néron se livrent également à des mutilations sur les êtres vivants. Qu’est-ce qui les distingue encore, si ce n’est l’idée ? … Le physiologiste n’est pas un homme du monde, c’est un savant, c’est un homme qui est saisi et absorbé par une idée scientifique qu’il poursuit : il n’entend plus les cris des animaux, il ne voit plus le sang qui coule, il ne voit que son idée et n’aperçoit que des organismes qui lui cachent des problèmes qu’il veut découvrir. » Ne conviendrait-il pas de les repenser, afin de les rendre actuels et, dès lors, socialement recevables ?
Nos perceptions de l’autopsie sont très certainement affectées par une impression d’indistinction, d’ambiguïté, voire de confusion des genres, entre ses fins thérapeutiques et ses fins scientifiques. Le déficit en communication adéquate, ne permet pas toujours de distinguer l’autopsie de la dissection, mais également de singulariser cet acte de ce qui relève des prélèvements en vue de greffes d’organes. La loi no 94-654 du 29 juillet 1994 y contribue à sa manière, dès lors que n’abordant pas franchement l’autopsie, elle privilégie les notions plus valorisantes et apparemment moins contestables de don et de prélèvements d’organes.
Force est d’admettre, en dépit des arguments scientifiques peu contestables présentés par les spécialistes, que les techniques modernes de l’investigation clinique, apparemment moins intrusives, paraissent davantage compatibles avec les mentalités modernes. La nécropsie demeure donc entachée de doutes et de suspicions, ce qu’il conviendrait de ne pas occulter.
Cela est d’autant plus grave qu’il s’avère éthiquement justifié de prendre en compte les avantages de l’autopsie, s’agissant du recueil de données indispensables, et inaccessibles par d’autres méthodes. Ne se prive-t-on pas, de manière inconsidérée, de connaissances qui font défaut aux avancées nécessaires ? Une telle situation contribue à ce que persistent nombre d’incertitudes, de mauvais diagnostics et de thérapeutiques imparfaitement évaluées. Elle s’avère donc préjudiciable à l’intérêt des personnes malades et plus généralement aux bénéfices que la collectivité est en droit d’attendre de la médecine.
Nous ne saurions donc nous satisfaire des positions simplificatrices ou faussement morales, qui conforteraient des approches considérées davantage conformes aux pratiques en vigueur, et réfuteraient, de la sorte, les indications pertinentes de nécropsies. Chaque technique a ses limites et présente des inconvénients à ne pas sous-estimer. À titre d’exemple, est-il justifié de préférer la biopsie cérébrale pour confirmer une présomption de démence, avec ses conséquences possibles qu’il ne faut pas sous-estimer [16] ?
Le débat relatif à l’autopsie concerne donc non seulement l’intérêt des personnes, mais également les enjeux de la médecine et de la recherche biomédicale.
La question est malgré toute posée. L’autopsie est-elle compatible avec nos attitudes sociales à l’égard du champ biomédical, dès lors qu’elles procèdent de considérations individuelles, voire individualistes ? Ces mentalités contestent les décisions et les actes dont les conséquences apparaîtraient disproportionnées au regard de leur intérêt avéré. D’autant plus que l’autorité médico-scientifique ne parvient plus à imposer sans discussion ses prescriptions. Faute d’arguments recevables, les personnes privilégient donc l’autonomie d’une décision qui puisse satisfaire leurs propres considérations et tout autant leurs avantages.
Consécutivement, pour autant que soit admis l’intérêt de l’autopsie, comment parvenir à la rendre acceptable et à la désinvestir du système de représentations, souvent péjoratives, attaché à la mise en pièce du supplicié, au spectacle de la leçon d’anatomie en amphithéâtre, aux obscures manipulations entreprises dans le secret des morgues, souvent à l’insu des familles et de manière subreptice ou aux théorisations scientistes du siècle passé ? « Si je décède hors de France, je souhaite que mon corps ne soit rapporté dans sa patrie qu’après cinquante ans révolus d’une première inhumation, qu’on sauve mes restes d’une sacrilège autopsie, qu’on s’épargne le soin de chercher dans mon cerveau glacé et dans mon cœur éteint le mystère de mon être. La mort ne révèle point les secrets de la vie [17]. » La transparence, la concertation et la pédagogie sociale, constituent, de toute évidence, les principes indispensables à une nécessaire réhabilitation morale de l’autopsie. D’un point de vue éthique, il convient de concevoir une approche susceptible de permettre d’identifier, dans la clarté, les responsabilités qu’elle engage. Ne sommes-nous pas en droit, voire en devoir, d’être assurés de la pertinence, de la rigueur et de la qualité des interventions entreprises sur nos morts ?
L’EXCEPTION D’AUTOPSIE
En 1566, les théologiens de Salamanque sont consultés : « Est-il permis à un chrétien de disséquer un être humain ? » Leur réponse demeure actuelle : « Cela est utile et nécessaire à la médecine, et doit être permis. » On pourrait reprendre les différentes traditions religieuses à ce propos. Lorsque l’existence d’une personne ou d’une collectivité dépend nécessairement de l’observation menée sur une dépouille humaine, les règles peuvent être enfreintes pour autant qu’on s’efforce d’épargner au défunt une indignité ou des préjudices indus.
Toutefois, dans l’Antigone de Sophocle, l’édit de Créon incarne une forme d’arbitraire qui suscite une résistance morale assez proche des considérations présentées par les détracteurs de l’autopsie. Il importe de ne pas les réfuter a priori , sans en comprendre les profondes motivations et y répondre par des mesures adéquates.
Qu’en est-il, en fait, de notre attitude à l’égard du cadavre durant cette période intermédiaire et incertaine qui précède son éventuel ensevelissement ? Comment déterminer et exercer nos responsabilités, alors que vivants, nous sommes les garants des devoirs qui honorent la mémoire du défunt ? La personne morte n’est-elle pas, en fait, réduite à la condition d’une dépendance absolue, qui la rend totalement vulnérable et donc la place impérativement sous notre protection ?
Quelles justifications profondes nous confèreraient ainsi le pouvoir de consentir à des actes qui peuvent représenter une violence démesurée, dont la réparation morale paraît illusoire ? Sommes-nous délivrés de toute obligation, lorsque la personne a fait le choix de remettre son corps à la science ?
Comment apprécier notre faculté de discernement et les modalités de décisions, alors que c’est de la mort qu’il s’agit et que, par nature, elle échappe à nos pouvoirs ? « En tous cas l’ambiguïté de la mort est une ambiguïté d’escamotage, puisque la mort est un passage de quelque part à nulle part, puisque l’existence locale et l’abandon de tout lieu se succèdent [18]. » Il nous faudrait donc l’ignorer, ne serait-ce que provisoirement, afin que, d’une certaine manière, elle serve la vie [19].
Ce serait lui conférer un sens — en quelque sorte au-delà de la mort — plus fort que la mort et que les règles morales dont sont investis les vivants.
Une telle conception est de nature à nous permettre de comprendre les motivations des personnes qui donnent leur corps à des Facultés de médecine, mais aussi les arguments présentés aux familles que l’on sollicite en vue de prélèvements d’organes à des fins thérapeutiques.
Se posent, néanmoins, les questions relatives au devenir du corps après l’autopsie, aux conditions de sa restitution tégumentaire — « Les médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée sont tenus de s’assurer de la restauration décente de son corps [20] » — à ses funérailles.
Ne devrions-nous pas consacrer davantage de réflexions à ces conséquences des interventions sur la dépouille humaine, en nous inspirant, notamment, des dispositifs développés à ce propos en néonatalogie [21] ?
S’agissant d’un don à la science, après avoir été l’objet de recherches, en tant que tel le corps n’existe plus. Comment exprimer la considération que justifie un tel don et ne pas se contenter de consumer les restes comme s’il s’agissait d’abolir la mémoire du défunt, voire notre dette à son égard ? Ne donne-t-on pas ainsi l’impression de le purifier d’un acte immoral auquel nous aurions collectivement consenti ?
Ce sont donc des considérations spécifiques, relevant de l’utilité et de la nécessité de l’autopsie, qui la permettent : « Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies.
Il n’existe pas de méthode alternative à la recherche sur les êtres humains, d’efficacité comparable ; … [22]. » Selon certaines conditions, à défaut de pouvoir agir autrement, voire mieux, comme s’agissant d’un moindre mal : « Le mal moindre comparé au plus grand mal fait
figure de bien, puisque le mal moindre est préférable au mal plus grand ; or ce qui est préférable est un bien, et ce qui est préféré davantage, un plus grand bien [23]. » Ainsi, la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 autorise-t-elle les prélèvements à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Pourtant, il convient de le rappeler, « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie [24]. » C’est dire que l’autopsie caractérise des dilemmes et des tensions qui touchent à sa justification et ainsi à sa légitimité. Il ne s’agit jamais d’une pratique acceptable en tant que telle, dès lors que son intérêt et sa pertinence peuvent être appréciés selon des critères qui relèvent de principes et de registres différents, parfois même contradictoires. Au même titre que les prélèvements en vue de greffes ne constituent jamais une pratique acquise et routinière, il est tenu compte de la multiplicité des enjeux et contraintes spécifiques, à la fois d’ordres moral et technique.
Afin de surmonter les équivoques et de déterminer, malgré tout, une modalité morale conciliable avec certaines exigences médico-scientifiques, nous pourrions retenir le principe d’exception d’autopsie [25].
En effet, il n’est rien d’évident et de naturel dans une intervention menée sur le corps d’un défunt. Je considère même que, parce que rien ne saurait véritablement l’autoriser [26], sa permission est par nature conditionnelle. Elle relève d’une situation d’exception qui impose une transgression. Du reste il en va de même s’agissant de toute intervention chirurgicale — « Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement [27] » — ce qui devrait nous inciter, par analogie, à envisager des procédures à tous égards identiques en matière d’autopsie.
Dès lors, le discours récurrent relatif à l’impérieux besoin de recourir aux nécropsies quasi systématiques, ne peut être perçu que dans sa dimension d’abus et de coercition. Il ne laisse pas son indispensable place à la faculté d’appréciation au cas par cas, et semble réduire le corps d’une personne morte à un organisme indifférencié, soumis aux logiques de procédures banalisées, irrespectueuses à l’égard de ce que, pour certains, il représente encore. À tout moment, il convient d’être en mesure de pouvoir justifier ce recours à l’exception d’autopsie, ne serait-ce que pour nous prémunir des mentalités et des effets de ce qui apparaîtrait comme un « acharnement nécropsique. » C’est là où le principe de consentement prend une telle importance, qu’il soit présumé ou exprès. Il réinstaure une nécessaire dimension d’humanité et de relation, dans un contexte qui s’avère à cet égard peu favorable. Cette forme de contractualisation inscrit l’acte de nécropsie dans un cadre prescrit, ce qui conditionne sa légitimité au strict respect de ce que représente un engagement réciproque.
Ainsi, l’enjeu éthique viserait à favoriser l’émergence d’une approche qui se refuse aux dogmatismes comme aux fantasmes, afin de privilégier une attitude digne de circonstances dont on comprend les multiples significations. La décence, la retenue
et la prudence ne peuvent que confirmer la valeur et la portée du principe d’exception d’autopsie.
UN PACTE MORAL
L’exception d’autopsie devrait nous permettre de définir à la fois ses indications, ses modalités, ses limites et donc les règles qui s’imposent à tous, afin d’en atténuer les conséquences morales et de contribuer à la rendre plus acceptable.
Afin de ne pas circonscrire notre réflexion à des considérations par trop générales, ne convient-il pas d’évaluer ses véritables enjeux, ce qu’elle représente et signifie concrètement dans le contexte des pratiques biomédicales ?
Il ne me semble pas négligeable, à ce propos, de mieux comprendre la démarche d’un médecin souhaitant que soit pratiquée la nécropsie de la personne accompagnée durant sa maladie. Cette nécessité de savoir, relève de la continuité et de la qualité du soin, dès lors qu’elle est susceptible de bénéficier à d’autres, du fait des irremplaçables informations qu’elle permet d’acquérir : « L’objectif essentiel de la recherche médicale sur des sujets humains doit être l’amélioration des méthodes diagnostiques, thérapeutiques et de prévention, ainsi que la compréhension des causes et des mécanismes des maladies. Les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et de pré- vention, même les plus éprouvées, doivent constamment être remises en question par des recherches portant sur leur efficacité, leur efficience et leur accessibilité [28]. » On peut même la considérer, à certains égards, comme procédant d’une véritable dette morale envers le défunt, ne serait-ce que pour que sa mort ne soit pas réduite à la seule dimension d’un échec.
Un même sentiment est, du reste, partagé par les personnes revendiquant la possibilité de mettre leur corps à la disposition de l’équipe qui aura tenté de les guérir, afin de contribuer personnellement aux avancées de la recherche. On sait les difficultés de toutes natures qui restreignent l’exercice de ce droit. Ne conviendrait-il pas, ne serait-ce que par respect à l’égard de ces personnes, de ne pas rendre à ce point compliquée une démarche déjà infiniment délicate ?
Il s’agit là d’une solidarité d’une inestimable valeur. Elle engage réciproquement soignants et personnes malades dans un projet qui leur est commun.
Une autre générosité s’exprime, lorsque des personnes décident de « léguer » leur corps à une Faculté de médecine. Leur résolution, pleinement assumée, est bien souvent inspirée par une conception éminemment respectable de la responsabilité inter-humaine. Elles attestent, de la sorte, d’un souci témoigné au bien de l’Autre, de nature à contribuer aux évolutions médico-scientifiques nécessaires.
Dans ces deux derniers cas, il s’agit de décisions volontaires et motivées, exprimées du vivant de la personne, et que rien ne saurait contester, à l’exception de considé- rations d’ordre médico-légal ou de santé publique.
Les proches se doivent alors de respecter un choix qui ne les engage pas de manière personnelle, même s’ils en éprouvent une plus grande difficulté à pouvoir véritablement envisager le deuil du défunt. D’autant plus, lorsque l’enveloppe charnelle ne leur est pas restituée et n’a pas de sépulture, comme c’est souvent le cas s’agissant de dissections à des fins d’enseignement ou de recherche.
Dans ces circonstances, les équipes médicales et para-médicales, tout comme les étudiants qui s’exercent à disséquer des cadavres, sont tenus par un engagement qui fonde et caractérise leurs obligations. Ne s’agit-il pas d’un pacte moral, d’autant plus strict et intangible qu’il intervient dans le cadre d’une pratique qui concerne une personne morte ? Toute mise en cause de cet accord contractuel est susceptible d’affecter la moralité et la légitimité même de l’intervention, ce qui impose l’absolu respect d’attitudes dignes et la justification des protocoles entrepris : « L’expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société, impossibles à obtenir par d’autres moyens : elle ne doit pas être pratiquée au hasard, et sans nécessité. Les fondements de l’expérience doivent résider dans les résultats d’expériences antérieures faites sur des animaux, et dans la connaissance de la genèse de la maladie ou des questions à l’étude, de façon à justifier par les résultats attendus l’exécution de l’expérience [29]. » Nous pouvons regretter qu’aucune instance ne soit constituée pour assurer le contrôle des bonnes pratiques, dans une perspective spécifiquement éthique. Il n’est pas de bonne pratique sans bonne conduite. Les recommandations en termes de procédures et de protocoles ne sauraient satisfaire, à elles seules, les exigences d’ordre moral. De telle sorte que demeure une suspicion, parfois confirmée par certains professionnels eux-mêmes qui réprouvent les dérives constatées et s’inquiè- tent d’un déficit de dignité, voire de sens moral.
Anonyme, car sans identité préservée, ce corps pourtant confié selon des conditions déterminées et à des fins précises aux médecins engagés dans une démarche expérimentale, est trop souvent considéré comme un ensemble de pièces anatomiques dépourvu de la moindre dignité. Ne s’agit-il pas d’un véritable abus de confiance, voire d’une profanation, de nature précisément à affecter la signification scientifique et la valeur sociale de l’autopsie ?
Qu’en est-il, dans un autre domaine, de l’exercice de certaines nécropsies médicolégales qui semblent parfois inciter les praticiens à se considérer dégagés de la moindre considération, ne serait-ce qu’à l’égard de la déontologie médicale ? Au nom d’un intérêt supérieur — l’expertise et la recherche par tous les moyens de la vérité — dans bien des cas, les intervenants ont à ce point privilégié l’acquisition de compétences et le niveau de technicité, qu’ils peuvent en devenir indifférents à la portée de leurs actes.
L’exception d’autopsie ne saurait en aucun cas légitimer une autopsie d’exception.
On ne peut que contester les arbitraires et les excès qui accentuent le discrédit et renforcent les positions de refus. De telles attitudes provoquent des résistances fondées sur des valeurs éthiques, inspirées par les principes de notre démocratie.
Parce que les explorations menées sur le cadavre justifient des conduites absolument irréprochables, il convient que les sociétés savantes et les instances compétentes se dotent des méthodes et des moyens qui garantissent de manière incontestable la pertinence et la qualité des pratiques.
Un effort de sensibilisation des professionnels et des étudiants en médecine aux enjeux éthiques de la nécropsie, ainsi qu’un souci d’ouverture, de concertation et de transparence, seraient de nature à réhabiliter cette activité médico-scientifique fortement affectée par la perception qu’on peut en avoir. De ce point de vue, le remarquable travail réalisé par l’Établissement français des greffes constitue un modèle qui pourrait inspirer des initiatives désormais attendues [30].
Dans un contexte de santé publique fortement préjudiciable à la représentation sociale des pratiques médico-scientifiques, il importe de restaurer le rapport de confiance indispensable à une médecine de qualité. Les situations limites justifient tout particulièrement un effort de réflexion, de nature à favoriser l’acceptation de circonstances souvent éprouvantes. Dès lors, on ne comprend que plus difficilement encore les réticences des anatomo-pathologistes à intervenir explicitement dans l’espace public, afin de faire valoir les considérations susceptibles de modifier favorablement nos conceptions et nos comportements au regard de l’autopsie.
En quoi cette démarche médico-scientifique serait-elle moins éthique que certaines prouesses chirurgicales pourtant célébrées ? Pourquoi suscite-t-elle inquiétude et réprobation, alors que ses indications et ses méthodologies peuvent être argumentées ? N’est-elle différente du prélèvement d’organes en vue d’une greffe que parce qu’elle ne semble pas susceptible de sauver directement une vie humaine ? Ce qui peut s’avérer inexact s’agissant, par exemple, d’une autopsie sanitaire. Son rapport, par nature ambigu et considéré transgressif avec un cadavre explique-t-il sa contestation, voire sa mort annoncée ?
Il manque actuellement à l’autopsie une expressivité éthique, alors que, paradoxalement, son histoire même pourrait être comprise comme relevant d’une exigence de moralité. Le courage des médecins qui ont défié les règles sociales et les lois de la nature afin de servir la vie humaine, constitue un engagement d’une dignité remarquable.
Il me paraît donc désormais urgent que les professionnels impliqués dans ce champ médico-scientifique s’investissent dans un débat public susceptible de leur conférer cette légitimité qu’on leur conteste.
Dès lors, la notion d’exception d’autopsie peut être comprise comme la marque tangible d’une nouvelle approche des pratiques qui concernent le corps de la personne morte. Elle est de nature à reconstituer, si nécessaire, un cadre éthique qui permette de concilier les principes de respect et de dignité avec les impératifs et les contraintes de la recherche, donc d’une médecine à tous égards pertinente.
BIBLIOGRAPHIE [1] BLOCH E. — Le principe espérance (T. 1.). Paris : Gallimard, 1976.
[2] MATTEI J.F. — Débats parlementaires relatifs à la loi du 29 juillet 1994, Assemblée nationale, 15 juin 1994.
[3] Code de déontologie médicale. — Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995, article 16.
[4] Conseil constitutionnel. — Décision no 94-343-344, à propos du projet de lois dites de bioéthique, 27 juillet 1994.
[5] Code de déontologie médicale. — Article 2.
[6] Loi no 94-564 du 29 juillet 1994. — Article 671-7.
[7] Code de la santé publique. — Article 671-7.
[8] Code de la santé publique. — Article 671-9.
[9] Déclaration d’Helsinki. — Association médicale mondiale. Principes éthiques applicables aux recherches médicales sur des sujets humains, 52e Assemblée générale, Édimbourg, octobre 2000, article 4.
[10] Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine), Conseil de l’Europe, 1996, article 2, Primauté de l’être humain.
[11] Rapport Belmont, Commission nationale américaine pour la protection des sujets humains de la recherche biomédicale et comportementale, 1978.
[12] Code civil. — Article 16-1.
[13] KANT E. — Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. V. Delbos. Paris : Delagrave, 1971.
[14] FOUCAULT M. — Naissance de la clinique. Paris : PUF, 1963.
[15] BERNARD C. — Introduction à l’étude de la médecine expérimentale. Paris : Nouvel office d’édition, 1963.
[16] HAUW J.J., FORETTE F. — « La maladie d’Alzheimer : quelques réflexions éthiques », in La maladie d’Alzheimer : prédiction, prévention, prise en charge, (Coll.). Paris : Fondation nationale de gérontologie, 2000.
[17] CHATEAUBRIAND (DE) F.-R. — Mémoires d’outre-tombe. Paris : GF Flammarion, 2000.
[18] JANKÉLÉVITCH V. — La mort. Paris : Flammarion, 1977.
[19] Sur la carte de donateur remise par l’École de chirurgie des hôpitaux de Paris aux personnes qui « lèguent » leur corps à la science, figure l’inscription : « La mort au service de la vie. » [20] Code de la santé publique. — Article 671-11.
[21] DUMOULIN M. — « La mort périnatale : accompagnement à l’hôpital des familles endeuillées », in Éthique et soins hospitaliers. Espace éthique, travaux 1997-1999. Paris : AP-HP/Doin, 2001.
[22] Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, Conseil de l’Europe, 1996, article 16, Protection des personnes se prêtant à une recherche.
[23] ARISTOTE — Éthique à Nicomaque, trad. J. Tricot. Paris : Vrin, 1967.
[24] Code civil. — Article 16.
[25] En référence à l’avis no 63 du CCNE, 27 janvier 2000 — « Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie » — qui propose une « exception d’euthanasie. »
[26] La loi condamne sévèrement « toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit (…) », Code pénal, article 225-17.
[27] Code de déontologie médicale. — Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995, article 41.
[28] Déclaration d’Helsinki. — Association médicale mondiale. Principes éthiques applicables aux recherches médicales sur des sujets humains, 52e Assemblée générale, Édimbourg, octobre 2000, article 6.
[29] À ce propos et même s’il concerne l’expérimentation menée sur la personne vivante, le Code de Nuremberg (extrait du jugement rendu par le tribunal américain, 1947) détermine des principes intangibles.
[30] Rapport d’activité et bilan des activités de prélèvement et de greffe en France. — Établissement français des greffes, 1999.
DISCUSSION
M. Claude SUREAU
Vous avez judicieusement cité l’article 16 du code civil et en particulier le 16.3, dans sa version du 29 juillet 1994 (loi 659) : « intérêt thérapeutique pour la personne » or le terme « thérapeutique » a été remplacé par celui de « médical » par l’article 70 de la loi du 27 juillet 1999 sur la couverture maladie universelle. C’est là un progrès qui peut concerner l’autopsie. Malheureusement, le terme de personne a pour l’instant été conservé. C’est bien entendu dommage et nous observons ici une raison supplémentaire d’obtenir une modification totale de la rédaction de cet article 16.3.
Il est vrai qu’à elle seule la notion d’intérêt direct de la personne s’avère peu satisfaisante, tant on peut la considérer imprécise et parfois de nature à compromettre des valeurs qui pourraient s’imposer, dans certaines circonstances, comme supérieures. J’estime que nous bénéficions bien souvent des acquis d’une recherche médico-scientifique menée sur d’autres. Il s’agit là d’une véritable solidarité humaine. Dès lors que l’arbitraire ne livre pas la personne aux excès d’expérimentations injustifiées ou préjudiciables, je comprends mal certaines résistances ou réticences qui incitent à ce que prévalent les mentalités de l’individualisme et de l’indifférence. Qu’il s’agisse par exemple de l’autopsie ou des prélèvements d’organes, nous gagnerions à acquérir cette maturité morale, ce sens de la responsabilité qui ne peuvent que nous inciter à dépasser nos peurs et nos fantasmes. Une pédagogie de la responsabilité me semble aussi importante qu’une pédagogie du respect et de la dignité. Il y va du devenir même du lien social. C’est là où, à lui seul, le principe de consentement ne constitue pas la valeur supérieure. Certes, cette forme de contractualisation inscrit l’acte de nécropsie dans un cadre prescrit, ce qui conditionne sa légitimité au strict respect de ce que représente un engagement réciproque compris dans ses intimes et ses ultimes significations. Toutefois, je considère que notre approche de l’autopsie doit également s’inscrire dans une perspective de solidarité. Dès lors, il s’avère nécessaire d’être attentif au sens et à la portée socio-politique des refus que l’on constate aujourd’hui.
M. Émile ARON
L’intégralité du corps humain qui semble dominer nos débats sur l’autopsie est une croyance qui s’amenuise dans notre société occidentale. A l’appui de cette opinion, je cite le nombre croissant de crémations que vous pouvez découvrir dans les faire-part nécrologiques.
Je pense que ce n’est pas tant l’intégrité du corps que sa dignité et son respect qui suscitent certaines controverses philosophiques pleinement assumées par la personne quant au devenir de sa dépouille. A la décomposition naturelle lui semble parfois préférable la symbolique d’une dispersion de ses cendres. On sait quel type de rituel accompagne cette cérémonie qui présente des possibilités non limitées à l’enterrement dans un cimetière.
C’est dire qu’il n’est pas évident que les personnes souhaitant la crémation soient pour autant hostiles à une autopsie justifiée. Le contraire me semblerait du reste plus logique, dans la mesure où certaines conceptions de l’autopsie témoignent d’un souci d’honorer des valeurs profondément fondées d’humanisme et de responsabilité.
* Directeur de l’Espace éthique de l’Assistance Publique — Hôpitaux de Paris, professeur d’éthique médicale à la Faculté de médecine Paris-Sud. Tirés-à-part : M. Emmanuel HIRSCH, Espace éthique, CHU Saint-Louis — 75475 Paris cedex 10. Article reçu le 19 mars 2001, accepté le 27 mars 2001.
Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 5, 891-904, séance du 22 mai 2001