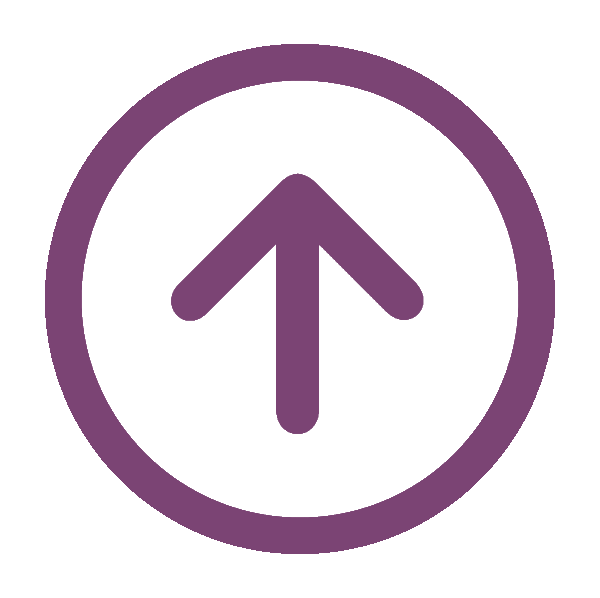Résumé
Les études biochimiques ou génétiques portent sur des extraits tissulaires. Les études in situ, qui leur sont complémentaires, sont de plus en plus nécessaires. La biologie moléculaire a en effet permis l’identification de nouvelles protéines dont il faut aujourd’hui étudier la fonction, la répartition et le rôle à l’état normal et au cours de la maladie. Mais, en France, les chercheurs n’ont plus accès aux prélèvements tissulaires. Plusieurs raisons ont conduit à cette situation de pénurie. Le médecin est plus assuré de son diagnostic aujourd’hui qu’hier. Il n’éprouve plus la curiosité de le vérifier post mortem . Les familles sont de plus en plus opposées à l’autopsie, surtout si les raisons qui la justifient ne peuvent être expliquées qu’au moment du décès. La nécessité du consentement explicite du patient est un autre facteur limitant. Cette nouvelle obligation limite en pratique la recherche aux échantillons provenant de patients qui ont fait « don de leur corps à la recherche ». Ce don, global, soulève des difficultés d’ordre éthique. Enfin, il n’existe pas encore en France d’organisation qui puisse gérer les prélèvements tissulaires sur tout le pays. Les associations de malades, qui ont pris conscience des carences du système actuel, sont prêtes, à l’avenir, à jouer un rôle primordial. Ce sont elles qui, aujourd’hui, tentent de mettre sur pied les Banques de Tissus en sensibilisant leurs adhérents à l’importance des prélèvements à visée de recherches.
Summary
Research dealing with tissue is more important to day than ever. Techniques of molecular genetics have indeed permitted the identification of a large number of new proteins that have now to be localised in the tissue and in the cell, in health and disease. This step has to be made in order to elaborate the adequate animal models in which new therapeutics can be tested. In France, however, human tissue samples have become difficult to obtain. Many factors contributed to this situation. Autopsies are now exceptionally performed. Doctors feel confident in their diagnosis and express rarely the need to control it. Families are opposed to
post mortem more strongly than before, especially when the reasons for performing it can not be explained before the death of the patient. French law now makes the explicit consent of the patient mandatory before any research. This practically limits all post mortem investigations to those that had been planned before death. The possibility of giving tissue post mortem to allow research has to be publicised, particularly by associations of patients.
The organisation that should manage to collect and store the samples at a large scale and over the whole country is lacking. Its structure is still discussed : should it be supported by the state itself, by private funding, possibly by the associations of patients themselves ? Patients Associations are ready to play a crucial role : they realised that the present system was inefficient, they are presently trying to organise tissue banks ; they will finally have to explain to their members why they should care for research, how they could help and how they will have to accept the absence of immediate spectacular results.
INTRODUCTION
Observer et agir
Le savant observe et classe : c’est Linné ou Mendeleiev. Le savant expérimente et agit : c’est Faraday ou Oppenheimer. Observer ou agir sont les deux extrémités d’une ligne qui traverse la Science et donc la Médecine. L’anatomopathologiste est à l’antipode du chirurgien. Il est curieux de constater que cette dichotomie, un peu artificielle, est retrouvée dans la biologie moderne. Le séquençage du génome humain relève de l’observation, la thérapie génique de l’action. Mais on aurait tort, évidemment, d’y voir une opposition. L’action et l’observation pures sont stériles ;
associées, elles se fertilisent : qu’on pense à Pasteur ou à Fleming, parmi tant d’autres.
Prélèvements précieux et données riches
On peut, aujourd’hui encore, sacrifier des souris pour élucider une question scientifique. Les prélèvements peuvent être répétés au besoin ; ils sont abondants et, en ce sens, « bon marché ». En médecine, les données concernent des hommes, euxmêmes libres d’aller et venir, de se plier à l’investigation ou de la refuser. La collecte
est donc aléatoire et lente. L’exemple d’une biopsie cérébrale est particulièrement révélateur. C’est un événement rare. Il ne peut pas être dupliqué mais c’est peut être lui qui permettra, dans un avenir proche ou lointain, d’élucider un mécanisme pathogénique. Le prélèvement humain est, dans ce sens, précieux. Il ne peut pas être jeté une fois le diagnostic fait.
Les données que le médecin collecte ne sont pas toutes de la même nature. Certaines sont « pauvres » : l’épidémiologiste qui prend la pression artérielle et la compare à l’incidence de la démence n’enregistre que deux valeurs, celle que lui donne le tensiomètre et celle qui conclut le test cognitif. Elles permettront de répondre à une seule question ou à un petit nombre d’entre elles. L’analyse terminée, les données sont à remiser au magasin des accessoires. Sauf imprévu, personne n’ira jamais les y rechercher. Il s’agit de « données pauvres ». Au contraire, une seule expérience n’épuise pas les « données riches ». Sur les collections d’ADN, la recherche de mutations peut être renouvelée aussi souvent qu’il y a de paires de bases… Des milliers d’anticorps peuvent être utilisés pour détecter les protéines qui se trouvent dans un prélèvement tissulaire. ADN et, plus encore, tissus sont des « données riches ». Lorsqu’elles proviennent de patients elles sont à la fois « riches » (une expérience ne les épuise pas) et précieuses (on ne peut pas les dupliquer).
La collecte de prélèvements post mortem , qui permet l’accumulation de données riches et précieuses, est à la base des « banques » destinés à durer des décennies [3].
A l’heure de la biologie moléculaire, leur intérêt est encore plus grand qu’autrefois.
La protéine dont le généticien décode le gène, doit être identifiée, isolée du tissu, détectée dans la cellule et ses compartiments. Ces études peuvent faire appel aux biopsies : elles sont de petite taille. De plus certains organes ne sont pas aisément accessibles du vivant du malade, notamment pour des raisons éthiques. C’est donc à l’étude post mortem qu’il faut, le plus souvent, avoir recours.
Les « Banques » ou « Thèques »
Le terme de banque est sans doute malheureux car il est associé à celui de finance, étranger à notre propos. On a tenté de lui substituer celui de -thèque (tissuthèque, sérothèque, cérébrothèque). Quel que soit le terme utilisé, il s’agit d’accumuler au fil du temps des « données riches » que les chercheurs pourront utiliser aujourd’hui, demain ou dans 10 ans. La « thèque » n’est pas faite pour répondre à un projet de recherche : elle est destinée à alimenter un grand nombre d’entre eux au gré des découvertes scientifiques. Elle servira, un jour, à identifier la huntingtine, un autre à tester les mitochondries, plus tard à rechercher des protéines partenaires…
Les États-Unis, la Grande Bretagne, l’Allemagne, la Hollande ont mis sur pied des « Banques de Cerveaux », financées tantôt par l’état, tantôt par les associations de malades (une liste des banques de cerveaux dans le monde peut être trouvée sur le site http : // www.brainbanks.org/brain-ba.htm). La France est à la traîne dans ce domaine et indécise sur les modalités pratiques d’organisation. Les « données riches », précieuses comme le sont les prélèvements humains, doivent être gardées
longtemps. Il faut donc qu’elles soient conservées dans des endroits qui jouissent d’un financement continu, différent de celui, discontinu, qui permet de réaliser un projet de recherche. Il faut y insister : une banque d’ADN ou de tissu humain est un service commun. Elle n’est pas conçue pour répondre à une seule question scientifique.
COMMENT CONSTITUER UNE BANQUE ?
La loi
On n’étudie pas les prélèvements humains comme ceux des animaux d’expérience.
Aucune recherche scientifique ne peut avoir lieu sans l’accord éclairé et explicite du donneur, même si l’on peut réaliser une autopsie à visée diagnostique quand seule l’absence d’opposition est assurée (« Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa famille », article L 671-9 du Code de la Santé Publique ). Il est certainement des circonstances où l’on peut regretter les termes de la loi mais il y a tout lieu de penser qu’ils ne seront pas notablement modifiés à l’avenir car il est évidemment souhaitable qu’un homme puisse disposer de sa liberté pour permettre ou interdire la recherche sur son propre corps. La loi a une conséquence immédiate : les études à visée de recherche effectuées post mortem doivent avoir été exposées au patient pre mortem et acceptées par lui. Il n’y a, en pratique, qu’un seul moyen pour parvenir à ce but. Il faut mettre sur pied des registres de « don du corps pour la recherche scientifique » qui soient le pendant du « registre national des refus » déjà en place, et complémentaires du don du corps à la science (destiné à pourvoir les pavillons d’anatomie) et du don d’organe à visée de greffe. Il faut donc informer la population et prévoir des cartes de don et des réseaux de collecte des prélèvements. Les médecins ne sont pas toujours bien placés pour demander la mise en place de ces dons : on les soupçonne de plaidoyer pro domo. Mais ils peuvent être efficacement relayés par les associations de malades qui réclament de nouvelles thérapeutiques, c’est-à-dire de nouvelles recherches.
Le don du corps pour la recherche
Le don généreux d’une partie de soi-même, qu’un grand nombre de patients sont prêts à faire, soulève plusieurs difficultés.
Quel organisme le consigne ?
Lorsqu’un patient fait don de son corps à la recherche, seuls les proches en sont aujourd’hui avertis. Ce sont eux qui devront, le cas échéant, accomplir les nombreuses démarches qui permettront in fine la collecte des échantillons. Aucun organisme n’est actuellement capable d’enregistrer les consentements ou d’aider les familles le
moment venu. L’exemple du « don du corps pour la science », organisé par les facultés de médecine de façon particulièrement efficace, doit, évidemment, être suivi.
Le consentement éclairé et la mort
Pour être éclairé, le consentement ne peut être donné que pour un projet déterminé.
Or les tissus sont le type même des « données riches », qui pourraient servir à alimenter de nombreux laboratoires. Le patient décédé ne pouvant évidemment plus recevoir un complément d’information, le consentement devrait donc envisager une utilisation large des tissus prélevés et pouvoir se passer d’une information précise sur les recherches futures dont les orientations et les possibilités ne peuvent être prédites.
Le consentement éclairé et la démence
Le patient dément ne peut évidemment être qu’imparfaitement éclairé. Les situations dans lesquelles le malade, encore suffisamment conscient, sait que ses fonctions intellectuelles vont se dégrader, et consent à prévoir son autopsie sont exceptionnelles. Une fois le consentement consigné, il est difficile à révoquer par un patient qui perd ses capacités cognitives. Le problème soulevé par la recherche dans la démence est donc mal résolu. En pratique, ce sont souvent les familles qui se portent garantes de l’accord du patient.
Les modalités pratiques
Publicité
La possibilité de consentir à un don d’organes ou de tissus post mortem doit être connue du public. Les associations de malades peuvent largement contribuer à cette information. Il n’est évidemment pas question de « forcer la main » mais de donner à chacun la possibilité de prendre activement position. Une telle campagne de publicité est particulièrement délicate : elle ne doit pas heurter la sensibilité des familles et risquer ainsi d’hypothéquer toute possibilité de prélèvement, même chez des sujets consentants. Plusieurs exemples retentissants d’erreur d’appréciation en France ou en Angleterre [8] ont jeté inutilement le discrédit sur la recherche médicale, dont les buts authentiques sont évidemment louables.
Carte de donneurs
Une carte de donneur permettrait à chacun d’afficher son choix. La personne qui la porterait sur elle témoignerait, en effet, de l’actualité de son vœu de « donner son corps à la recherche », ce qui éviterait les résistances manifestées au moment du décès par les proches qui n’auraient pas été mis au courant. Il arrive souvent, en effet, qu’un parent, tourmenté par la décision, applique une sorte de « principe de précaution » qui conduit à l’abstention plutôt qu’à l’activisme. Le nom des donneurs pourrait être inscrit sur un registre permettant une vérification rapide de la volonté du patient.
Permissions administratives
Même avec l’accord explicite du patient, l’obtention des permissions nécessaires au transport du corps vers le CHU, où l’autopsie est réalisée, constitue une véritable course d’obstacles qui rebute à la fois les médecins et les familles les mieux intentionnées. Les règlements actuels ne l’autorisent que dans les 24 heures. Il est souhaitable que ces démarches puissent être facilitées à l’avenir lorsque le principe des tissuthèques sera mieux accepté qu’aujourd’hui et qu’elles pourront être réglementées de façon plus efficace. Ici encore les associations de malades s’avéreront utiles : ce sont elles qui disposeront de tous les renseignements nécessaires pour obtenir rapidement les autorisations et orienter les familles vers les services adé- quats.
Collecte et préservation des prélèvements
Le prélèvement sera nécessairement effectué dans la ville de CHU la plus proche selon les modalités techniques adéquates, prévues par les anatomo-pathologistes ou les chercheurs [2, 3]. Faut-il ensuite réclamer que les prélèvements soient acheminés dans une unité de stockage centralisée ou est-il préférable de les garder dans les établissements où ils ont été faits ? Les deux organisations ont été tentées : à titre d’exemple, au Royaume Uni les prélèvements provenant de patients parkinsoniens sont concentrés à Londres. En Allemagne, c’est un réseau qui a été mis en place. Les associations de malades trouveraient certes leur intérêt dans un organisme centralisé qui constituerait aussi un interlocuteur unique. Les anatomo-pathologistes qui effectuent le travail de prélèvement et de conditionnement préfèrent au contraire garder dans leurs laboratoires les spécimens qu’ils espèrent pouvoir un jour étudier eux-mêmes.
Difficultés de la documentation clinique des prélèvements
Les prélèvements conservés dans les tissuthèques doivent être accompagnés d’une documentation clinique qui en augmente la valeur, permet une recherche intelligente et confirme le diagnostic. Il serait donc souhaitable que des dossiers cliniques (ou de données biomédicales) puissent accompagner les prélèvements mais il faut éviter que les banques de tissus disposent de leurs propres médecins cliniciens qui effectueraient eux-mêmes la collecte des informations médicales. Une telle procé- dure, mal interprétée, pourrait être perçue comme un détournement de clientèle.
Plusieurs solutions alternatives existent (contact direct avec le médecin traitant qui remplit les rubriques d’un examen standardisé, par exemple). Elles doivent évidemment rester compatibles avec l’anonymat indispensable lorsqu’il s’agit de recherches [7].
L’anonymat, la médecine et la recherche scientifique
Les patients, souffrant d’une maladie génétique, peuvent, à juste titre, être inquiets de voir figurer leur nom en regard du diagnostic d’une affection familiale. Les
assureurs ou les employeurs, qui en prendraient connaissance, pourraient, sans donner d’explication, refuser à la descendance un prêt, une assurance vie ou un emploi. Pour éviter ce risque, les prélèvements pourraient être rendus immédiatement anonymes. Mais une telle pratique irait à l’encontre de la démarche du médecin qui porte un diagnostic sur une personne et non sur un numéro d’anonymat. Elle entraverait l’information de la famille, peut-être utile pour la prise en charge ultérieure. Jusqu’au diagnostic, l’examen des tissus doit donc être considéré comme un acte médical, c’est-à-dire nominatif. A ce titre, il est répertorié dans des registres mis sous clef et, si possible, ne faisant pas appel à l’informatique. Mais, une fois le diagnostic porté, toutes les recherches sont effectuées sur des prélèvements dont l’anonymat ne doit pouvoir être levé qu’en cas de nécessité impérieuse et seulement par un médecin astreint au secret médical.
La distribution des prélèvements
Le médecin qui effectue les prélèvements ou qui organise leur gestion éprouve une tendance naturelle à se comporter comme un propriétaire. Une telle attitude est évidemment opposée à l’esprit même des tissuthèques. Mais qui décide de la destination des prélèvements ? Qui écarte les recherches irréalistes ou mal programmées, celles qui gaspillent le matériel précieux en restant stériles ? Un conseil scientifique doit veiller à la bonne utilisation des dons. Il doit comporter des observateurs extérieurs, utiles pour juger, à leur juste valeur, les querelles de personnes ou les péripéties qui ne relèvent pas de la science.
Les obstacles
Les réticences à l’autopsie [5, 6]
Envisager sa propre mort est une opération intellectuelle que tous les individus ne peuvent probablement pas réaliser avec la même sérénité. L’évocation par le médecin de la mort de son patient peut être mal interprétée. La science et la médecine sont parfois perçues comme « totalitaires » ou inhumaines. L’autopsie est ressentie comme une effraction dans les derniers retranchements de l’individu. Les familles, parfois le personnel soignant, s’exclament : « Il a déjà tant souffert. Il est temps maintenant de le laisser tranquille ». Les obstacles religieux, moins infranchissables aujourd’hui qu’hier, ne doivent évidemment pas être négligés. Mais la réticence est aussi médicale. L’anatomo-pathologiste est souvent surpris des remarques de ses collègues qui tantôt manifestent une ignorance profonde de l’intérêt de l’autopsie, tantôt font preuve d’une sensibilité exacerbée devant la mort : tel chef de clinique s’excuse de n’avoir pas pu éviter la « vérification », tel chirurgien de ne pouvoir supporter la vision d’un cerveau, tel autre ne sait pas qu’une autopsie peut être demandée, tel chef de service soutient la fermeture de la salle d’autopsie. L’éducation médicale ne comprend plus l’examen post mortem . L’ignorance d’aujourd’hui en est la conséquence.
Les difficultés de recrutement des témoins
L’étude des tissus pathologiques est impossible si elle ne s’accompagne pas d’une comparaison avec les tissus normaux. Il faut donc recruter non seulement des patients mais aussi des cas de contrôle. Les associations de malades peuvent sensibiliser à la recherche des membres de la famille des patients. Mais il faut prévoir une information à un plus large public signalant que le don de tissus, même en l’absence de maladie, est utile à la recherche.
Les difficultés du financement
On ne peut pas acheter le corps humain ou ses parties : c’est l’attitude éthique adoptée en France. C’est aussi la législation. Il est donc difficile, en pratique, de s’appuyer sur des financements privés pour mettre sur pied les banques de tissus.
L’étude par l’industrie pharmaceutique de prélèvements humains peut donc soulever des difficultés si elle conduit à des découvertes non partagées ou à des bénéfices [1, 4 ]. Qui donc pourrait assurer le financement ? Les associations de malades ont, les premières, compris le risque que faisait encourir à la recherche française l’arrêt de la pratique des autopsies. Ce sont elles qui réclament des banques de tissus destinés à étudier leur maladie. Dans certains cas, ce sont elles aussi qui ont mis sur pied et financé les tissuthèques. C’est ainsi qu’à Londres, la Parkinson Society Brain Bank collecte les prélèvements provenant de patients souffrant de syndromes parkinsoniens (site Internet : http : // www.ion.ucl.ac.uk/brainbank/homepage.htm). Mais les financements engagés risquent de ne pas être pérennes. Qui prendra soin des prélèvements, lorsque les fonds viendront à manquer ? Le financement étatique, par les organismes de recherche par exemple, se justifierait donc pleinement. Il s’agit, en effet, d’une aide à la recherche, elle-même souvent financée par l’état, et une action qui vise le bien commun. C’est la voie choisie en Allemagne pour constituer un réseau de « Banques de Cerveaux », intitulé BrainNet. La diversité des formes possibles de stockage, la souplesse nécessaire dans les changements éventuels de stratégie, les sanctions qu’il faut pouvoir rapidement apporter aux organismes inefficaces font cependant craindre à certains l’engagement direct de l’état.
Les réticences scientifiques aux banques
Ce sont probablement les plus complexes à démêler et aussi les plus importantes à lever car elles constituent un obstacle sérieux au financement des banques par les organismes de recherche. Il arrive que les scientifiques ne tiennent pas compte des difficultés rencontrées à la collecte des prélèvements humains et surtout du temps qu’elle nécessite, des années souvent des décennies. Ils appliquent le paradigme scientifique le plus commun, celui du projet pour répondre à une question, et s’étonnent que la collecte des tissus puisse se faire en dehors de celui-ci : pas de question scientifique, pas de projet, … pas de financement. Comme nous avons tenté de l’expliquer plus haut, il n’est pas judicieux de construire une banque de tissus pour ne répondre qu’à une seule question. Nous l’avons dit, le prélèvement tissulaire humain est à la fois précieux (rare, impossible à dupliquer) et riche (une expérience
ne l’épuise pas). Le financement des tissuthèques sera toujours précaire tant que ces notions n’auront pas été assimilées par la communauté scientifique. La précarité, c’est aussi le risque de perdre de précieux prélèvements humains collectés sur des dizaines d’année. Le chercheur sera le premier à s’étonner de ne plus trouver la plaque de sclérose ou le muscle de myopathe sur lequel appliquer la technique qu’il vient de mettre au point.
CONCLUSION
La recherche médicale française a un besoin aigu de prélèvements tissulaires humains, normaux et pathologiques. Pour y subvenir, il est nécessaire de mettre en place un réseau qui prendra en charge les dons d’organes et de tissus post mortem .
De nombreux partenaires doivent y participer. Les associations de malades figurent en première place. C’est en effet pour les patients que la recherche thérapeutique est développée. C’est par leurs dons que sont alimentées les tissuthèques. Certaines associations, conscientes des difficultés, se sont récemment fédérées dans un groupe de réflexion qui cherche à mettre en place les réseaux de prélèvements et de préservation. Elles sont énumérées au début de cet article, l’un des coauteurs en est, en effet, le porte-parole. Les médecins traitants jouent un rôle important : ce sont eux qui peuvent à la fois comprendre le point de vue des patients, et celui des chercheurs. Les anatomo-pathologistes doivent réaliser les autopsies et souvent conditionner les prélèvements, même quand les tissus obtenus ne serviront pas leurs propres recherches. Les chercheurs doivent accepter les règles de distribution et d’utilisation de tissus trop précieux pour être gaspillés. Enfin, les tissuthèques doivent être gérées par du personnel à plein temps qui constituera et sécurisera les collections, distribuera les prélèvements de façon adéquate et en assurera le suivi scientifique. Il faut aussi souligner le rôle de l’administration, hospitalière mais aussi municipale, qui doit comprendre et faciliter les démarches des familles en deuil.
L’État, enfin, doit prendre position sur les nombreuses questions juridiques que soulèvent les banques de tissus, éventuellement organiser, contrôler et financer le réseau des dons d’organes et de tissus pour la recherche. La recherche, les tissuthè- ques n’en sont que le préliminaire mais elles en sont le préliminaire indispensable et il est fort à craindre que leur rareté actuelle, en France, n’hypothèque les recherches de demain. Nous vivons aujourd’hui sur les réserves d’hier. Les conséquences de la désuétude des autopsies ne se feront sentir que dans quelques années.
BIBLIOGRAPHIE [1] BEYLEVELD D., BROWNSWORD R. — My body, my body parts, my property ?
Health Care Anal ., 2000, 8 , 87-99.
[2] DUYCKAERTS C., HENIN D., SAZDOVITCH V., HAUW J.J. — L’examen anatomopathologique de l’encéphale. Ann Pathol ., 2000, 20 , 514-26.
[3] DUYCKAERTS C., SAZDOVITCH V., SEILHEAN D., DELAÈRE P., HAUW J.J. — A brain bank in a neuropathology laboratory (with some emphasis on diagnostic criteria ). J. Neural Transmission , 1993, (suppl) 39 , 107-118.
[4] GRAY N., WOMACK C., JACK S.J. — Supplying commercial biomedical companies from a human tissue bank in an NHS hospital-a view from personal experience . J Clin Pathol ., 1999, 52 , 254-6.
[5] HAUW J.J. — L’autopsie.
Rev Prat ., 1999, 49 , 1141-1143.
[6] HAUW J.J. — Autopsies : les prélèvements à des fins scientifiques.
Espace Ethique AP-HP ., 1999, 7-8 , 62-63.
[7] STROBL J., CAVE E., WALLEY T. — Data protection legislation : interpretation and barriers to research. Bmj , 2000, 321 , 890-2.
[8] WOODMAN R. — Storage of human organs prompts three inquiries.
Bmj , 2000, 320 , 77.
* Laboratoire de Neuropathologie R. Escourolle, Hôpital de La Salpêtrière. ** Association Française contre les Myopathies (AFM), BTR, Bâtiment Babinski, Hôpital de La Salpêtrière, 47 Bld de l’Hôpital - 75651 Paris cedex 13. *** Au nom du Comité de Réflexion pour le Don de tissus post mortem pour la Recherche : AFM, Huntington France, France Parkinson, France Alzheimer, Association Française de l’Ataxie de Friedreich, Association de Recherche sur la Sclérose en Plaques, Association pour la Recherche sur la SLA, Connaître les Syndromes Cérébelleux. Tirés-à-part : Madame Jeanne-Hélène DI DONATO, AFM, à l’adresse ci-dessus. Article reçu le 20 mars 2001, accepté le 27 mars 2001.
Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 5, 857-866, séance du 22 mai 2001