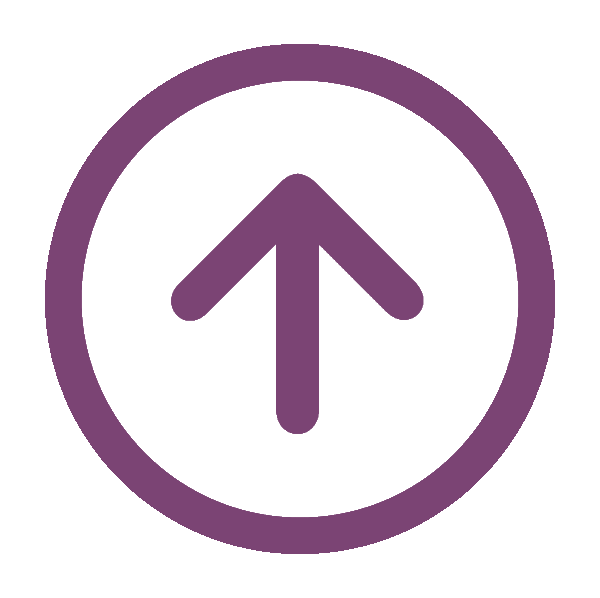Résumé
La transition épidémiologique en cours est caractérisée par la prépondérance des maladies dégénératives. Cela impose de renouveler la réponse sanitaire et de réorganiser la prise en charge des maladies, aussi bien les soins curatifs que les stratégies préventives. Celles-ci doivent mieux cibler les facteurs de risque des maladies dégénératives pour en améliorer la prévention primaire. Et pour les maladies dont les facteurs de risque sont inconnus ou non modifiables, il faut se tourner vers le dépistage (ou prévention secondaire) : le diagnostic et le traitement précoces des formes précliniques de la maladie peuvent, sous certaines conditions, améliorer le pronostic des maladies dépistées. Bien qu’il soit en général bien perçu par les professionnels de la santé, le dépistage est un geste complexe en santé publique qui se heurte à beaucoup de difficultés lors de sa mise en œuvre. Cet article rappelle les principaux obstacles théoriques et pratiques du dépistage des maladies. Si le dépistage veut réaliser les promesses dont il est porteur dans un monde dominé par les maladies chroniques et dégénératives, la première étape à franchir est d’augmenter les compétences de tous les professionnels des soins dans ce domaine de la médecine de santé publique.
Summary
The ongoing epidemiological transition is characterized by the increasing predominance of degenerative diseases. New responses from the health system are thus needed, reorganizing curative services as well as preventive strategies. The latter have to target risk factors for degenerative disease in order to improve primary prevention. And for all other diseases with unknown or non-modifiable risk factors, screening (or secondary prevention) is an option to be considered as a public health response. Early diagnosis and early treatment can improve the prognosis of patients screened in defined conditions. Although medical screening is generally well accepted by health professionals, screening is rather sophisticated and encounters substantial difficulties when implemented in the real world. This article briefly presents the main theoretical and practical drawbacks of early diagnosis. Screening will substantially improve health if the knowledge and skills of healthcare professionals are substantially increased.
La médecine préventive est cette partie de la médecine qui développe et applique les interventions collectives ou individuelles précédant la maladie cliniquement apparente (Figure).
La prévention primaire a pour but d’empêcher l’apparition de la maladie en intervenant sur les facteurs de risque ou les facteurs de protection qui la déterminent. Elle est sans doute le geste le plus utile (au sens économique et au sens banal) de la médecine, tant il est vrai, dans les termes de Geoffrey Rose, qu’« Il est préférable d’être en bonne santé que malade ou mort. C’est le début et la fin du seul bon argument en faveur de la médecine préventive. Il est suffisant. » [1].
La prévention primaire n’est cependant que rarement possible. C’est qu’elle impose une compréhension fine de la maladie, mettant en évidence ses mécanismes étiopathogéniques et les facteurs susceptibles de les modifier. Il faut, de plus, que les facteurs de risque ou de protection de la maladie soient modifiables dans la vie réelle.
Ainsi l’âge de la personne, qui est de loin le principal facteur de risque des maladies dégénératives, n’est bien entendu en rien modifiable.
C’est parce que ces conditions ne sont pas remplies dans la plupart des maladies dégénératives (comme les maladies neuropsychiatriques et arthrosiques) qu’elles sont inaccessibles à la prévention primaire : leur histoire naturelle est mal connue, ainsi que les facteurs qui en déterminent l’apparition et la progression.
Une alternative à la prévention primaire est le dépistage des maladies (ou diagnostic précoce, ou encore la prévention secondaire). Cette stratégie a pour but d’améliorer le pronostic de la maladie. Pour ce faire elle cherche à intervenir le plus tôt possible dans l’histoire naturelle de la maladie avec un diagnostic et un traitement précoces.
Le concept et la pratique du dépistage ont pour avantage d’être facilement compris et acceptés par les soignants. Contrairement à la prévention primaire, le dépistage est une partie de leur métier, faisant accomplir des gestes diagnostiques et thérapeutiques qui leur sont familiers.
Cet avantage, qui est important, comporte toutefois de nombreux inconvénients [2].
L’une des caractéristiques peu favorables du dépistage est que l’intervention est toujours coûteuse, car le test de dépistage doit réaliser à très grande échelle un geste professionnel souvent complexe (comme la réalisation et la lecture d’une mammo-
FIGURE 1. Interventions préventives et histoire naturelle de la maladie.
graphie ou le prélèvement de villosités choriales) ou reposant sur une technique élaborée (comme la recherche de sang occulte dans les selles).
D’autre part, les caractéristiques épidémiologiques des tests de dépistage identifient de nombreux faux positifs (en général plus nombreux que les vrais positifs), qui seront adressés pour subir des tests diagnostiques onéreux, souvent compliqués, voire dangereux (comme par exemple une amniocentèse après un triple test sanguin de dépistage de la trisomie fœtale).
Enfin, le dépistage suppose la promotion de filières d’activités professionnelles (celles concernant les gestes de diagnostics précoces et de confirmation) et, parfois, industrielles (lorsque le dépistage suppose la fabrication et le maintien d’appareils et de produits). Si bien que se créent souvent, autour de la prévention secondaire, d’importants groupes de pression qui interviennent dans la décision de politique sanitaire, au point que le débat est souvent alourdi par des arguments sans rapport avec les besoins de santé de la population.
Avenir du dépistage
Quelle que soient les limites de la prévention secondaire, elle est promise à un bel avenir dans une population marquée par les maladies dégénératives, dont la prévalence augmentera avec la poursuite du vieillissement.
Ce succès prévisible du dépistage tient à une triple circonstance. D’une part, il est peu probable que la prévention primaire offre, à court ou moyen terme, des straté- gies satisfaisantes pour combattre la plupart des maladies dégénératives (en particulier les maladies neuropsychiatriques et arthrosiques). C’est pourquoi on devra longtemps encore viser une amélioration du pronostic plutôt que la diminution de l’incidence des maladies dégénératives. Le diagnostic précoce est dès lors une technique qui s’impose naturellement, tentant de faire bénéficier du traitement efficace le plus grand nombre de cas, y compris ceux en début d’évolution.
D’autre part, la longue période d’incubation de la plupart des maladies dégénératives crée une large fenêtre d’opportunités durant laquelle on peut espérer en identifier les signes précoces. La possibilité d’identifier ces signes dépend du génie propre de la maladie, mais aussi de l’évolution technique. Cette dernière a progressé considérablement. Une avancée spectaculaire concerne le diagnostic génétique, dont certains tests sont déjà disponibles sur le marché (avant même d’ailleurs
qu’on sache exactement quoi en faire en termes de prévention secondaire). D’autres avancées impressionnantes concernent les progrès de l’imagerie (permettant par exemple l’identification des plaques athéromateuses intra-artérielles ou les anévrismes de l’aorte) ou les progrès des techniques de filtrage cellulaire (avec la recherche de cellules fœtales circulant dans le sang maternel, par exemple).
Enfin, la transformation de la vieillesse elle-même change le comportement à l’égard de la prévention. Alors que l’attitude générale est encore réservée, autant chez les personnes âgées que chez les professionnels de santé, la perspective d’une vieillesse longue favorise la prévention primaire et secondaire. La forte croissance du nombre de personnes âgées en bonne santé [3, 4] maintient (et parfois crée) des besoins de mobilité et de loisirs, en bref des besoins de qualité de vie : certains déficits fonctionnels considérés aujourd’hui comme légers ou « normaux pour l’âge » pourraient demain sembler intolérables à des personnes en bonne santé et se sachant vivre encore longtemps. On peut prévoir une augmentation de la demande de dépistages d’affections susceptibles de diminuer la pleine jouissance de la vie. Cela impose aussi d’entreprendre des travaux cliniques et épidémiologiques établissant lesquelles de ces interventions préventives sont efficaces à un âge avancé [5].
Ces travaux devront aussi constamment réévaluer les limites supérieures de l’âge éligible pour les dépistages. Les âges auxquels s’interrompent actuellement les programmes de dépistage systématique du cancer (entre 65 et 75 ans) sont déterminés par l’espérance de vie générale et le gain de survie attribuable au dépistage [6], et aussi par le coût du dépistage. Tous ces déterminants évoluent et doivent être pris en compte spécifiquement à chaque époque.
Ce sont les maladies cardiovasculaires qui connaissent et connaîtront les développements les plus nombreux, en raison de leur fréquence élevée, de leur longue incubation et de l’abondance des signes précurseurs (anatomopathologiques, physiopathologiques, biochimiques, etc.) [7, 8]. L’un des défis spécifiques aux maladies cardiovasculaires sera de mettre au point des stratégies tenant compte du fait que presque toute la population présente un risque cardiovasculaire modéré ou élevé, si bien que le dépistage pourrait être une étape superflue : après un certain âge, toute la population pourrait être prise en charge par voie médicamenteuse ou par des modifications de style de vie [9-12].
Le dépistage comme problème de santé publique
L’organisation du dépistage est une entreprise majeure de santé publique, une intervention lourde dans la population qui nécessite la mise au point d’interactions compliquées entre acteurs, opérations et institutions. Inviter les participants, organiser l’examen, réaliser le test de dépistage en garantissant sa qualité, assurer le suivi diagnostique des tests positifs et le suivi thérapeutique des diagnostics positifs :
toutes ces opérations nécessitent une reconfiguration du système de soin, surtout si le nombre de maladies dépistables augmente.
L’expérience montre que la réussite de ces reconfigurations est loin d’être la règle.
Un éditorial célèbre [13] avait mis en évidence l’échec du dépistage du cancer du col de l’utérus au Royaume-Uni. Aujourd’hui encore, on sait que le dépistage de l’hypertension dans les pays développés reste en dessous de son impact potentiel.
Une récente étude de la population lausannoise montre que 37 % des personnes examinées sont hypertendues, dont un quart bénéficient d’un traitement adéquat, la moitié ne savent pas qu’elles sont hypertendues, et un quart sont traitées sans succès [14].
C’est pourquoi une attitude active des instances de santé publique est indispensable.
Elles doivent d’abord garantir qu’un dépistage n’est introduit qu’après l’examen soigneux de l’efficacité, de l’efficience et de la faisabilité du programme. Les autorités de santé publique doivent également assurer que l’organisation du dépistage garantit un niveau de qualité optimal, y compris une participation équitable de la population cible et une efficacité réelle sur le terrain.
L’un des problèmes d’organisation du dépistage porte sur le type d’implantation. Il faut savoir si une structure ad hoc est nécessaire pour réaliser un dépistage systématique, maîtrisant toutes les opérations depuis l’envoi des invitations, l’organisation du dépistage, le contrôle des reconvocations, etc.. L’expérience suggère que l’efficacité de cette organisation est supérieure à l’alternative, à savoir le dépistage opportuniste. Ce dernier insère le test de dépistage dans la pratique usuelle des soins, typiquement au sein de la consultation du médecin généraliste. La prise en charge de l’hypertension suit typiquement une logique de dépistage opportuniste, dans la mesure où la prise de la pression artérielle fait partie des gestes de routine qui se font « en passant » au cabinet. Le dépistage opportuniste est envisageable dans la mesure où la plupart des personnes se rendent au moins une fois par an chez le médecin (dans les pays les plus riches de l’OCDE, près de 80 % des personnes de la population générale déclare avoir été chez le médecin durant les 12 mois précédents).
L’inefficacité du dépistage opportuniste provient de la faible standardisation des tests, le peu de robustesse des procédés, et le suivi plus lâche des personnes [15].
En tout état de cause, il est probable que les dépistages de l’avenir, en particulier ceux des maladies cardiovasculaires et métaboliques, ne puissent se réaliser autrement que dans une perspective opportuniste. Il faut donc que les spécialistes de santé publique travaillent sur des prototypes d’organisation de ce type de dépistage pour en augmenter l’efficacité et la faisabilité.
Un danger évident du dépistage est de contribuer à produire des « pseudomaladies », dans ce mouvement général que les anglo-saxons désignent par « disease mongering » [16] . En l’occurrence, cela signifie la mise en évidence d’un signe compatible avec la présence d’une maladie (par exemple un taux de PSA élevé) chez une personne qui ne développera pas cette maladie (par exemple dont le cancer de la prostate restera strictement local). Le dépistage est alors à l’origine d’un « surdiagnostic », mettant en évidence une maladie inconnue sans dépistage et suscitant un traitement inefficace et dangereux.
Cette difficulté correspond à un problème général connu dans la théorie du dépistage sous le nom de « length bias », qui est une erreur de sélection pronostique. Ce concept repose sur le fait que la durée d’évolution des maladies dégénératives est variable ; l’erreur du dépistage est de sélectionner les cas à évolution lente (voire sans aucune évolution) parce que ceux-ci présentent la prévalence la plus élevée. Et ces cas à évolution lente sont également ceux dont le pronostic est le meilleur, gonflant ainsi fallacieusement le bénéfice du dépistage.
Il n’y a aucune façon d’éviter cette erreur, sinon en étudiant rigoureusement les résultats des programmes de dépistage après plusieurs années de fonctionnement et en raisonnant sur les modifications de l’histoire naturelle de la maladie introduites par le dépistage. Un tel exercice a été fait pour le dépistage du cancer du sein par Zahl et al. en Norvège et en Suède [17] : en analysant la forte augmentation de l’incidence du cancer du sein entre 50 et 69 ans et la diminution, nettement moins forte, après 69 ans, ces auteurs estiment qu’un tiers des cancers du sein traités ne seraient jamais apparus en dehors du dépistage durant la vie des femmes dépistées. Des estimations allant dans le même sens ont été faites par d’autres auteurs [18]. Dans le cas du cancer du sein, cette proportion élevée de pseudocancers pourrait être attribuée à la forte proportion de régressions spontanées du cancer du sein [19].
Cet exemple permet de comprendre que le dépistage est une intervention qui doit être non seulement rigoureusement évaluée avant son introduction, mais aussi soigneusement monitorée : certains effets ne deviennent apparents que longtemps après l’implantation du programme dans la population cible. D’autre part, lancer un programme de dépistage suppose la mise en place d’un système d’information sanitaire capable de récolter les informations sur les bénéfices et les inconvénients du dépistage.
Un autre aspect de santé publique du dépistage est la quantité et la nature des informations mises à disposition de la population. Il s’agit en particulier de savoir de quelle façon une personne de la population cible du dépistage prend une décision bien informée, sans donc être fortement influencée par les intérêts du promoteur. Le dépistage pose un problème particulier en termes de décision médicale en ce que la personne n’est pas malade : son appréciation du risque pris, en refusant ou en acceptant le dépistage, est a priori différente que celle d’une personne malade [20].
De ce point de vue, le dépistage pourrait inaugurer une ère nouvelle dans le partage des tâches et des responsabilités entre la population (personnes saines et malades) et les professionnels des soins [21, 22], ce qui impose de repenser l’information à la population [23].
Le dépistage reformule également la question de la confidentialité de l’information ou, plus exactement, de la propriété des décisions qui découlent des dépistages. Le problème se pose immédiatement pour les compagnies d’assurance qui peuvent souhaiter disposer des informations leur permettant d’ajuster les primes au risque individuel. Le problème peut aussi se poser lorsque le test de dépistage est payé par
un organisme d’intérêt public et qui pourrait vouloir imposer la décision qui découle du test, qu’il s’agisse de l’adoption d’un style de vie susceptible de corriger un vice génétique, ou d’avorter un fœtus porteur d’une aberration numérique des chromosomes. Pour l’instant, nos sociétés sont loin de telles pratiques contraignantes, mais nul doute que la multiplication des dépistages (et des coûts liés à cette multiplication) encouragera un débat intense. Ce débat doit se faire avec une participation active de la médecine de santé publique qui gère depuis longtemps les conflits entre les perspectives populationnelle et individuelle.
Enfin, un aspect particulièrement important du dépistage en tant qu’intervention de santé publique est l’évaluation. Il faut d’abord noter qu’évaluer une intervention à visée diagnostique (comme le dépistage) pose des problèmes différents, et globalement plus compliqués, que l’évaluation d’une intervention thérapeutique. La principale difficulté est que le résultat immédiat du dépistage (identifier une lésion préclinique) ne mesure pas le succès de l’intervention : on préfère mesurer la baisse de la mortalité dans le groupe dépisté pour éviter de biaiser la réponse (en particulier le biais du « lead time », l’erreur du temps de devancement). Mais ce faisant, on prend en compte non seulement l’efficacité du dépistage, mais également l’efficacité du diagnostic de confirmation, la rapidité de prise en charge des maladies avérées, la qualité des interventions thérapeutiques, de rééducation, de prévention des récidives, etc.
C’est dire que l’évaluation de l’efficacité du dépistage doit s’interpréter avec soin et précaution, et qu’elle nécessite une excellente formation en épidémiologie et en médecine préventive, ainsi qu’une excellente connaissance du fonctionnement local des services de santé.
Cette exigence dans l’évaluation du bénéfice se retrouve dans l’évaluation des effets indésirables. L’un d’eux, âprement discuté, est l’évaluation de l’anxiété induite par le dépistage dans la population cible, chez les femmes positives au dépistage et dans la population générale. Cet argument est vivement débattu entre partisans et adversaires de tel ou tel dépistage, mais reste largement fondé sur des impressions plutôt que sur des études épidémiologiques bien faites [24].
CONCLUSION
Le dépistage des maladies est une stratégie préventive qui va connaître une forte progression dans les 50 ans à venir. Ce mouvement est dû au vieillissement démographique, à la transition épidémiologique, aux progrès des traitements médicaux et aux progrès des techniques diagnostiques.
Le dépistage est un geste complexe si l’on veut en garantir le succès. Pour ce faire, il faut d’abord s’assurer de son efficacité a priori via des études expérimentales, puis constamment vérifier la qualité des opérations sur le terrain à l’aide d’un monitorage soigneux avec un système d’information adéquat.
Le premier pas dans cette direction est d’augmenter le niveau de formation des professionnels des soins dans le dépistage, en sachant que chaque domaine de la médecine sera concerné par des propositions de dépistage. Il faut aussi augmenter l’intérêt de la santé publique pour la prévention secondaire comme forme d’organisation de la réponse sanitaire, à la fois en approfondissant la formation des spécialistes et en augmentant les travaux de recherche et de développement.
BIBLIOGRAPHIE [1] ROSE G. —
The strategy of preventive medicine . Oxford, Oxford University Press, 1992.
[2] MORRISON A.S. —
Screening in chronic disease . New York, Oxford University Press, 1985.
[3] FREEDMAN V.A., MARTIN L.G., SCHOENI R.F. — Recent trends in disability and functioning among older adults in the United States : a systematic review. JAMA, 2002, 288 , 3137-3146.
[4] ROBINE J.M., MICHEL J.P. — Looking forward to a general theory on population aging.
J.
Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci., 2004, 59 , M590-M597.
[5] BREKKE M., HUNSKAAR S., STRAAND J. — Antihypertensive and lipid lowering treatment in 70-74 year old individuals — predictors for treatment and blood-pressure control : a population based survey. The Hordaland Health Study (HUSK). BMC, Geriatrics, 2006, 6 , 16.
[6] SUTTON G.C. — Will you still need me, will you still screen me, when I’m past 64 ?
BMJ, 1997, 315 , 1032-1033.
[7] DE BACKER G., AMBROSIONI E., BORCH-JOHNSEN K., BROTONS C., CIFKOVA R., DALLONGEVILLE J. et al . — European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice : Third
Joint Task Force of European and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of eight societies and by invited experts). Eur.
Heart J., 2003, 24 , 1601-1610.
[8] CORNUZ J., GUESSOUS I., RODONDI N. — [Primary prevention and screening in adults : update 2006]. Rev. Med. Suisse, 2006, 2 , 262-273.
[9] GETZ L., KIRKENGEN A.L., HETLEVIK I., ROMUNDSTAD S., SIGURDSSON J.A. — Ethical dilemmas arising from implementation of the European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Scand. J. Prim. Health Care, 2004, 22 , 202-208.
[10] GETZ L., SIGURDSSON J.A., HETLEVIK I., KIRKENGEN A.L., ROMUNDSTAD S., HOLMEN J. — Estimating the high risk group for cardiovascular disease in the Norwegian HUNT 2 population according to the 2003 European guidelines : modelling study. BMJ, 2005, 331 , 551.
[11] WALD N.J., LAW M.R. — A strategy to reduce cardiovascular disease by more than 80 %.
BMJ , 2003, 326, 1419.
[12] FRANCO O.H., BONNEUX L., DE LAET C., PEETERS A., STEYERBERG E.W., MACKENBACH J.P. — The Polymeal : More Natural, Safer, and Probably Tastier (Than the Polypill) Strategy to Reduce Cardiovascular Disease by More Than 75 %. BMJ, 2004, 329 , 1447-1450.
[13] Cancer of the Cervix : Death by Incompetence.
The Lancet, 1985, 326 , 363-364.
[14] APPEL L.J. — Nonpharmacologic therapies that reduce blood pressure : a fresh perspective.
Clin. Cardiol., 1999, 22 , III1-III5.
[15] LAWRENCE J.M., BENNETT P., YOUNG A., ROBINSON A.M. — Screening for diabetes in general practice : cross sectional population study. BMJ, 2001, 323 , 548-551.
[16] HEATH I. — Combating disease mongering : daunting but nonetheless essential.
PLoS Med., 2006, 3 , e146.
[17] ZAHL P.H., ANDERSEN J.M., MAEHLEN J. — Spontaneous regression of cancerous tumors detected by mammography screening. JAMA, 2004, 292, 2579-2580.
[18] ZACKRISSON S., ANDERSSON I., JANZON L., MANJET J., GARNE J.P. — Rate of over-diagnosis of breast cancer 15 years after end of Malmo mammographic screening trial : follow-up study.
BMJ, 2006, 332 , 689-692.
[19] ZAHL P.H., ANDERSEN J.M., MAEHLEN J. — Spontaneous Regression of Cancerous Tumors Detected by Mammography Screening. JAMA, 2004, 292 , 2579-2580.
[20] EDWARDS A.G., EVANS R., DUNDON J., HAIGH S., HOOD K., ELWYN G.J. — Personalised risk communication for informed decision making about taking screening tests. Cochrane Database Syst. Rev., 2006, CD001865.
[21] CHAMOT E., CHARVET A., PERNEGER T.V. — Women’s preferences for doctor’s involvement in decisions about mammography screening. Med. Decis. Making, 2004, 24 , 379-385.
[22] CHAMOT E., CHARVET A.I., PERNEGER T.V. — Variability in women’s desire for information about mammography screening : implications for informed consent. Eur. J. Cancer. Prev., 2005, 14 , 413-418.
[23] DAVEY C., WHITE V., GATTELLARI M., WARD J.E. — Reconciling population benefits and women’s individual autonomy in mammographic screening : in-depth interviews to explore women’s views about ‘informed choice’. Aust. N. Z. J. Public Health, 2005, 29 , 69-77.
[24] MEYSTRE-AGUSTONI G., PACCAUD F., JEANNIN A., DUBOIS-ARBER F. — Anxiety in a cohort of Swiss women participating in a mammographic screening programme. J. Med. Screen, 2001, 8 , 213-219.
DISCUSSION
M. Georges DAVID
Vous avez, à juste titre, souligné les contraintes du dépistage et la nécessité d’une évaluation rigoureuse avant la mise en œuvre d’une telle démarche. Mais un bilan après application est certainement aussi nécessaire. Connaissez-vous des exemples concrets d’une telle évaluation comportant le rapport coût/efficacité ?
La complexité des interventions préventives et l’ampleur des effets (positifs et négatifs) attendus dans la population imposent en effet une double évaluation, a priori (basée sur la littérature, ou sur des études pilotes) et a posteriori (résultant d’un monitorage de l’intervention réalisée). Dans les pays développés et durant les vingt dernières années, c’est certainement la prévention de l’infection à vih qui a fait l’objet des évaluations les plus nombreuses. Mais d’autres domaines ont connu le même développement : on peut citer comme exemples les stratégies de vaccination contre l’hépatite B, ou la prévention primaire des cardiopathies ischémiques, ou encore le dépistage du cancer du sein (ce dernier illustrant bien l’apport des évaluations a posteriori qui complètent les résultats des évaluations a priori). L’évaluation coût-efficacité a naturellement sa place dans ces évaluations, même si elle pose à la prévention quelques problèmes spécifiques. Parmi ceux-là, mentionnons le temps nécessaire au déploiement des effets de l’intervention préventive, difficile à valoriser, ou l’existence d’« externalités » (par exemple la diminu-
tion du tabagisme passif comme bénéfice supplémentaire au bénéfice propre du fumeur), ou encore l’attribution des coûts et des avantages entre les instances qui payent et celles qui en retirent les avantages.
M. Roger NORDMANN
Vous avez souligné l’impérieuse nécessité d’améliorer la prévention primaire des maladies.
Je note cependant que vous indiquez qu’elle est et sera dominée par la prévention des maladies neuro-dégénératives. Sans négliger son importance, ne pensez-vous pas que la priorité devrait être donnée à la prévention primaire des addictions, lesquelles sont responsables de plus de 100 000 décès par an en France (alcool et tabac) ainsi que d’importantes conséquences psychiques et sociales (cannabis) ?
Mon intervention était consacrée à la prévention primaire et secondaire des maladies dégénératives (maladies neuropsychiatriques, mais aussi cardiovasculaires, cancéreuses, et de l’appareil locomoteur). L’actualité de la prévention de ces maladies tient à leur augmentation, forte et inéluctable, liée au vieillissement de la population. Cette prépondérance n’implique pas qu’il faille négliger d’autres champs de la médecine préventive, dont les addictions. Au contraire : un argument immédiat, dans la perspective de mon exposé, est que certaines de ces addictions (le tabac et l’alcool en particulier) sont des facteurs de risque pour plusieurs de ces maladies dégénératives. De toute façon, les addictions sont et resteront un problème majeur de la médecine préventive. Il y a à cela au moins deux raisons. La première est que le marché des addictions se diversifie, non seulement en termes de produits (dont une bonne partie sont apparus récemment dans nos sociétés), mais aussi de conduites (le jeu ou l’alimentation sont deux exemples). Cette diversification n’a rien de spontané, mais répond à des stratégies explicites de la part des producteurs concernés. La deuxième raison est que la notion même d’addiction suscite une certaine perplexité chez les professionnels de la santé, dont témoigne par exemple la forte variabilité entre pays des attitudes à l’égard de la prise en charge thérapeutique et préventive. Cette perplexité, ou ce désarroi, doit inciter les professionnels de la prévention à accroître nos connaissances disponibles et, dans un deuxième temps, à dessiner un consensus professionnel et social.
* Épidémiologie et Santé publique. Directeur Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP). Faculté de biologie et de médecine. Centre hospitalier universitaire vaudois — Lausanne. Tirés à part : Professeur Fred PACCAUD, même adresse Article reçu le 15 janvier 2007, accepté le 22 janvier 2007
Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 2, 351-360, séance du 20 février 2007