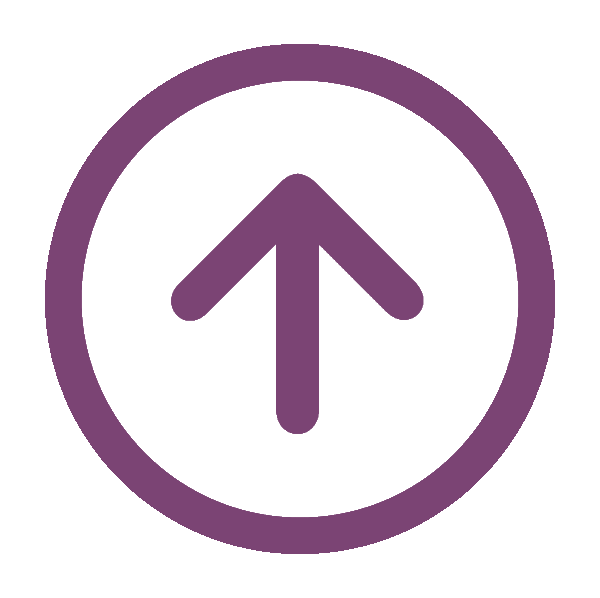Séance thématique « Le diabète sucré à l’aube du troisième millénaire »
Diabetes mellitus at the dawn of the third millenium
Introduction La situation actuelle de la maladie diabétique
Maurice GUENIOT*
Le diabète sucré, maladie chronique, est bien connu et défini depuis le début du siècle passé. Nous nous devons de rappeler, puisque cette journée se déroule à l’Académie nationale de médecine, que ce fut Lancereaux, devenu ensuite notre président en 1903, qui choisit cette tribune pour présenter le 13 novembre 1877, le mémoire où il démontrait l’origine pancréatique du diabète. Ce travail clinique intervenait dix ans avant la spectaculaire démonstration expérimentale par Von Mering et Minkowki en 1889, puis pendant tout le siècle qui vient de se terminer on a vu se développer, surtout pendant ses dernières décades, une augmentation considérable de nos connaissances et de nos moyens y compris diagnostiques et thérapeutiques ; et ces progrès ne cessent actuellement de se poursuivre. Cette journée a simplement pour but, sans traiter l’historique, de faire le point sur les aspects récents. Sur un plan général un premier problème se pose, c’est celui de la fréquence du diabète. Il est manifeste que celle-ci a augmenté de façon particulièrement importante. L’opinion publique elle-même en a été frappée au point que les médias emploient volontiers l’expression d’« épidémie du diabète », terme évidemment tout à fait impropre pour ce genre de pathologie.
Qu’en est-il exactement et quelles sont les données chiffrées que nous possédons ?
Disons tout de suite que nous disposons d’une surabondance de documentation à l’échelon international avec une avalanche de chiffres recueillis par d’innombrables enquêtes faites dans les pays les plus variés.
Bien entendu ce sont les Américains qui ont mené les premières enquêtes et ceci il y a déjà un demi-siècle ; elles avaient été effectuées en général dans des villes, principalement dans l’Ohio ; les chiffres obtenus étaient très discordants en raison notamment de la forme très diverse de la pyramide des âges dans les collectivités étudiées ;
c’était évidemment un biais considérable car le diabète est, comme on le sait depuis longtemps, une maladie prédominante selon l’expression classique dans la seconde moitié de la vie. Puis, quelques années plus tard après s’être occupés des blancs, les
Américains se sont intéressés aux Indiens ; le départ a été donné par les Adventistes du 7ème jour, qui ont créé un hôpital à Gouldings en Arizona à l’entrée de Monument Valley pour les Navajos qui sont une des tribus les plus nombreuses du Far-West. La constatation d’un pourcentage élevé de diabétiques a incité à enquêter dans d’autres tribus. L’une est devenue célèbre et est citée partout dans les études de démographie du diabète : c’est celle des Pimas qui vivent dans le désert soñorien au sud de l’Arizona, le long de la frontière mexicaine ; ce sont actuellement les recordmen du monde de la fréquence du diabète avec grosso modo le taux ahurissant de 40 % de diabétiques dans la fraction de population de plus de 40 ans. Il faut cependant ajouter, ce qui est rarement mentionné, que les Pimas forment un groupe humain très spécial au point de vue physiopathologique : la même tranche d’âge présente 20 % de cas de pelvispondylite ankylosante et ils ont une répartition des groupes HLA tout-à-fait particulière. Leur mode de vie actuel est très remarquable car, alors qu’ils étaient sans ressources naturelles et faméliques, ils ont bénéficié de la politique dite de « grande société » du président Johnson avec distribution géné- reuse par les services fédéraux de bons d’alimentation gratuits accordés en quantité d’où une suralimentation massive survenue presque subitement. J’y ai été il y a quinze ans et j’ai pu constater que cette population était devenue remarquablement obèse à l’inverse de leurs apparentés résidant plus au sud, en territoire mexicain, et toujours faméliques.
Depuis, des études épidémiologiques effectuées dans d’autres parties du monde ont fourni des exemples analogues. Ils sont encore plus probants quand ils portent sur des collectivités très nombreuses. C’est le cas des hindous d’Inde du Sud que le colonisateur anglais a transporté, à la fin du 19ème siècle, comme main d’œuvre dans la région côtière de l’Afrique du Sud, au Natal. Ces gens venaient d’une région où la population avait dans l’ensemble un niveau alimentaire médiocre, une faible longé- vité et une fréquence réduite de diabète. Depuis, les descendants de ces pauvres coolies immigrés sont devenus en majorité des commerçants et de petits entrepreneurs prospères avec une nourriture abondante contrastant avec celle de leurs ancêtres : et ils présentent un taux de diabète élevé.
Les Anglais se sont intéressés à ce phénomène car ils ont un nombre considérable d’immigrés venant de l’Inde. Un auteur anglais, Simmons a procédé à Coventry à un dépistage glycémique sur une population de 10.000 habitants comptant 4.500 indiens et 5.500 anglais autotochnes : au total la prévalence du diabète a été à peu près trois fois supérieure chez les indiens vivant au Royaume-Uni par rapport aux anglo-saxons.
De cette masse d’enquêtes il résulte trois constatations :
— l’élément génétique joue un rôle important dans l’apparition du diabète et sa fréquence est répartie très inégalement suivant les populations.
— la suralimentation avec sa conséquence la plus habituelle l’obésité est un élément très important dans la genèse du diabète.
— Enfin, l’accroissement de la longévité aboutit inévitablement à l’apparition progressive de nouveaux cas de diabète. Cet élément joue dans les populations européennes qui ont une médecine très développée et assume un rôle plus important encore que les deux précédents.
Il reste à connaître quelle a pu être l’évolution de cette augmentation de fré- quence du diabète au cours du dernier quart de siècle écoulé. Hélas, malgré l’abondance des statistiques de dépistage pratiquées un peu partout sur la planète nous ne possédons que très peu d’études de ce genre. La plus intéressante que nous connaissions, car elle porte sur un espace de temps de 20 ans est due à un diabé- tologue italien Devoti, qui l’a publiée en 1998. Elle est d’autant plus importante, pour nous français, qu’elle a été effectuée sur une population aux caractéristiques très voisines de la nôtre, celle de la petite république de Saint-Marin. La prévalence du diabète dans cet espace de temps est passée de 1,4 % à 1,8 %. La nôtre n’atteignait pas 2 % à cette époque, puis comme partout elle a nettement augmenté depuis.
Combien en ce début de 3ème millénaire y a-t-il de diabétiques en France ? Poser la question suscite de nombreuses réponses qui ont l’inconvénient d’être peu utilisables faute d’études comparatives dans le temps.
Heureusement, depuis 1998 des organismes officiels ont fait l’effort de s’attaquer à cet aspect du problème. En 1998, le Haut Comité de la Santé Publique publiait le rapport de son groupe de travail « Diabète » qui faisait état d’un nombre de diabétiques compris entre 1,2 et 1,5 millions dont 8 % de diabète du type 1, c’est-à-dire insulinodépendant . Puis la Caisse Nationale d’Assurance maladie des salariés (CNAM) a réalisé des enquêtes successives : en fin 1999 elle recensait environ 1.800.000 diabétiques à savoir 3,06 % de la population métropolitaine (cette dernière précision est de trop car la CNAM ne couvre pas toute cette population) puis en mai 2002 l’Institut de Veille Sanitaire qui s’était associé à la CNAM faisait état de 2 millions de diabétiques traités en France métropolitaine soit une prévalence de 3 %.
Nous pouvons ainsi mesurer grosso modo l’importance que la maladie diabétique a acquise actuellement dans notre pays. Certes, cela est dû à l’initiative des ouvriers de la 11ème heure que sont les grands organismes nationaux qui ont entrepris de la calculer. Mais sans chercher à les critiquer il faut bien remarquer qu’il reste encore dans les chiffres publiés des incertitudes de l’ordre de la centaine de milliers de malades. Pour répondre aux nécessités budgétaires il sera nécessaire d’affiner un peu plus le recueil des données.
Qui plus est, il convient de savoir exactement quelle est la réalité médicale que recouvrent tous ces chiffres ? Ceci nous amène à envisager un problème que nous avons étudié depuis de longues années avec mon équipe de la faculté de médecine de Necker, c’est celui de la demande en matière de santé. Dans le diabète il revêt une importance exceptionnelle.
Schématiquement nous avons montré par des exemples chiffrés qu’il faut distinguer deux catégories numériquement très différentes : celles de la « demande potentielle » et de la « demande réelle ».
La notion de demande potentielle repose sur le nombre total de cas d’une maladie existant dans une population : si tous étaient diagnostiqués et traités ce sont eux qui formeraient cette demande. C’est évidemment une notion théorique sauf dans quelques circonstances où tous les patients sont enregistrés et suivis comme par exemple les accidents du travail. C’est généralement elle seule qui est recensée dans la majorité des innombrables enquêtes de dépistage effectuées un peu partout depuis un quart de siècle, dans les maladies les plus variées. Elle recouvre une notion théorique de « besoins de soins » qui n’aboutissent pas forcément à des réalisations effectives.
La demande réelle est celle qui se concrétise médicalement : elle se mesure par le nombre de patients qui, le diagnostic posé, se soumettent à un traitement effectif.
C’est leur phalange qui intéresse principalement l’économie de la santé ; ce nombre est même le seul qui concerne l’assurance-maladie et sur laquelle elle peut baser ses prévisions.
Or, pendant de longues années très peu des campagnes de dépistage du diabète se sont souciées de ce problème. Citons une enquête effectuée en Angleterre à Bedford sur 25.000 sujets de plus de 21 ans ; une enquête de contrôle faite 7 ans après ne retrouvait que 108 diabétiques soit seulement les deux tiers de ceux précédemment dépistés ; et seulement 24 d’entre eux étaient traités pour leur diabète.
En réalité en plus de cette division schématique il existe une catégorie intermédiaire :
c’est celle des patients chez qui le diagnostic a été posé mais qui ne font peser sur l’assurance-maladie qu’une demande réduite et insuffisante. La chose est fréquente dans les maladies chroniques et l’exemple du diabète est caractéristique à cet égard.
Si la majorité des diabétiques se soumettent à un traitement efficace et sont suivis régulièrement, il existe chez les diabétiques non insulino-dépendants une minorité importante qui se traite insuffisamment avec des doses trop faibles d’hypoglycé- miants de synthèse et une surveillance chimique et biologique beaucoup trop clairsemée ; d’autres, par lassitude, abandonnent tout traitement au bout de quelques années ou ne se soignent que de façon intermittente. Certains même se refusent à tout traitement et ne suivent aucun régime se bornant au maximum à remplacer le sucre par un édulcorant de synthèse dans leur café matinal. Cette « sous médicalisation » qui est du seul fait des malades aboutit à une demande réellement basse non seulement par rapport à la demande potentielle mais aussi par comparaison à ce qu’est la demande réelle dans beaucoup d’autres maladies.
Cette « sous-médication » des diabétiques a préoccupé depuis très longtemps les diabétologues. Déjà en 1955 Raoul Boulin et moi-même avions donné ce sujet de thèse à Michel Dursent ; celui-ci grâce à l’aide de Charles Berlioz avait pu enquêter sur les dossiers des 3 années précédentes de la Sécurité Sociale de Paris. Les résultats étaient consternants avec une surveillance biologique dérisoire, certains diabétiques
n’ayant qu’une seule glycémie à jeun dans l’année et la surveillance ophtalmologique étant nulle chez une majorité de malades. Or, il s’agissait de la population parisienne qui avait pourtant plus de facilité que la majorité des assurés sociaux et l’on pouvait avoir les plus vives inquiétudes sur ce qui se passait dans les populations rurales.
Ceci m’avait incité 25 ans après à refaire avec Claude Rossignol et notre équipe de la faculté de médecine de Necker et de la CANAM une enquête plus étendue en prenant une population répartie sur tout le territoire national, celle des commerçants et artisans. Nous avions recueilli 2.100 diabétiques repérés parce qu’ils béné- ficiaient du remboursement à 100 %. La situation s’était spectaculairement améliorée mais il persistait une insuffisance nette de la fréquence et parfois même de l’existence de la surveillance ophtalmologique.
25 ans plus tard, dans les trois dernières années du 20ème siècle la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) appuyée par l’Institut de Veille Sanitaire a lancé de grandes enquêtes à l’échelon national sur ce sujet. Bien heureusement la situation française s’était encore améliorée mais il persistait toujours des carences non négligeables. Ainsi dans l’étude de 1999 sur 650.000 diabétiques de type 2 ayant un traitement oral, 50 % seulement avaient eu un dosage d’hémoglobine glyquée au cours des six derniers mois. Le taux des mêmes diabétiques ayant été remboursés d’au moins un acte d’ophtalmologiste libéral sur une période d’un an n’était que de 41,5 %. Il persistait donc encore un net décalage entre la réalité des pratiques et les recommandations de bonnes pratiques. Et pourtant de gros efforts de propagande ont été faits auprès des omnipraticiens et aussi des assurés. Il est probable qu’il faudrait faire un effort supplémentaire auprès de l’opinion publique essentiellement par la télévision. Aux Etats-Unis les diverses chaînes accordent souvent des minutes gratuites aux associations de malades. Ce serait semble-t-il les associations de diabétiques et aussi les réseaux de santé qui se développent actuellement qui sont les mieux placés pour obtenir par de telles aides un complément d’amélioration de la situation que nous venons de présenter.
Tout ceci nous amène à envisager un autre aspect de la diabétologie. Quelle est la place du diabétique dans la société ?
Les diabétiques comme nous venons de le voir forment non seulement une catégorie beaucoup plus nombreuse que celle d’autres affections chroniques mais présentent un aspect très différent de celles-ci. Certes, il faut différencier nettement les diabé- tiques du type « insulino-dépendant » de ceux du type 2 équilibrés par un traitement beaucoup plus simple basé uniquement sur l’association d’un régime alimentaire et de la prise orale de médicaments hypoglycémiants ; mais hormis le cas de complications dégénératives ce ne sont pas des handicapés. L’immense majorité est maintenue en activité et en santé normale par le traitement : c’est ce que mon maître Raoul Boulin appelait il y a un demi-siècle « la santé insulinienne » du diabétique : on transposerait actuellement cette formule en disant « la santé médicamenteuse ».
Or, nous venons de voir que leur nombre est actuellement très considérable sans commune équivalence avec aucune autre maladie chronique ayant une individualité strictement définie. Du fait de ce nombre, la population des diabétiques représente chez nous, comme dans la plupart des pays occidentaux un véritable « marché », au sens économique du terme. Certains pays voisins l’ont déjà compris : citons un seul exemple celui de l’Angleterre où est diffusée une liste des restaurants dont la carte comporte des « menus pour diabétiques ». On s’étonne que rien d’analogue n’ait pu être obtenu des compagnies aériennes pour les repas servis sur les longs courriers.
Mais la notion la plus importante est qu’à la différence de la plupart des malades chroniques le diabétique est un individu très particulier : c’est un « malade actif ».
En effet on possède des thérapies très efficaces et les patients peuvent se soigner et éviter longtemps la plupart des complications qui jadis les rendaient trop souvent plus ou moins invalides : cécité, amputations des membres inférieurs etc. Dans l’immense majorité des cas les diabétiques peuvent mener une vie professionnelle sociale et familiale normale, mais outre cet élément personnel, sur le plan de la collectivité cela comporte un aspect économique très important que nous avons souligné dans des travaux antérieurs. :
— d’une part, le diabétique qui travaille est un citoyen productif dont l’existence est bénéfique pour la collectivité tant par son travail que par les impôts qu’il paie, — qui plus est, il rapporte aussi des cotisations à la sécurité sociale ce qui le différencie profondément de la plupart des autres malades chroniques qui ne fournissent aucun effort mais représentent seulement une charge financière.
Certes on peut objecter que le diabétique actif fait supporter aussi à la collectivité le coût de son traitement ambulatoire. Mais précisément une enquête nationale que nous avons faite, il y a quelques années avec Claude Rossignol et notre équipe de Necker et de la CNAM, a montré que le traitement ambulatoire du diabète, surtout pour le type 2, est peu coûteux quelles qu’en soient les modalités. Aussi la collectivité se trouve largement bénéficiaire. C’est un argument que les associations de diabétiques n’ont à mon sens pas fait valoir auprès des pouvoirs publics pour en obtenir des contreparties.
La situation économique que nous venons de décrire a servi aux diabétiques allemands pour obtenir un avantage fiscal du gouvernement fédéral. Ils ont argué que le régime alimentaire qui fait partie intégrante du traitement, et ceci de façon permanente, leur imposait une dépense importante par comparaison avec l’alimentation de l’ensemble des citoyens : en effet il supprime ou rationne des aliments bon marché : sucre, plats à base de farine, pâtes alimentaires, féculents etc. et les oblige par contre à acheter une plus grande quantité d’aliments coûteux : légumes verts, poissons, viande etc. Ceci a abouti à une décision fixant chaque année par décret du Ministre des Finances une somme forfaitaire que le diabétique allemand officiellement reconnu par l’autorité sanitaire peut déduire du total de ses revenus soumis à l’impôt. Quelques diabétiques français ayant appris la chose ont élaboré un dossier
recensant très précisément les prix et les quantités des denrées concernées.
S’appuyant sur ce dossier qui était fort bien fait ils ont fait une demande au Ministère des Finances. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que cette démarche a été un échec complet.
Je viens de dire un mot du coût du diabète. Plusieurs publications récentes ont donné sur ce point des chiffres absurdement élevés. En fait, il faut faire une distinction complète entre le diabète insulino-dépendant dont certaines thérapeutiques récentes sont effectivement très coûteuses pour l’assurance-maladie et le diabète type 2 traité par le régime et des médicaments oraux. Avec Claude Rossignol et notre équipe de la CNAM, nous avons été les premiers en France il y a 15 ans à faire une étude de ce type sur les dossiers de 2.097 diabétiques. Donnons en brièvement quelques résultats :
Le diabète étant une maladie ambulatoire, le coût de la surveillance (consultations, actes de biologie et médicaments etc.) était très modeste pour les diabétiques de type 2 à savoir 264 Francs par malade et par mois.
Par contre pour ces diabétiques de type 2 le total des dépenses d’hospitalisation était considérable. Or, en analysant les dossiers on constatait que seule une minorité d’hospitalisations était indispensable : un diabétique peut présenter une appendicite, une fracture du fémur, une infection aiguë, ceci n’est nullement dû à sa maladie et ne doit pas être comptabilisé pêle-mêle avec des causes dues au diabète notamment circulatoires ou oculaires. Ces deux types d’affection doivent être recensés séparément. Mais surtout on constatait que beaucoup d’hospitalisations concernaient des patients ingambes qui faisaient des séjours pas toujours brefs pour mise en observation, équilibration, bilans, etc. Ce troisième chapître augmentait massivement les dépenses d’hospitalisation de diabétiques pour la Sécurité Sociale. Au moment où l’on s’inquiète justement du déficit de celle-ci ce phénomène très coûteux mérite d’être connu mais les récentes enquêtes de la CNAM n’ont pas cherché à le calculer.
Qui plus est il dépasse de beaucoup le domaine du diabète et on peut le retrouver dans bien d’autres secteurs. Ainsi dans une enquête analogue sur la pelvispondylite ankylosante que nous avions faite toujours avec Claude Rossignol à la demande et sous l’égide de Stanislas de Sèze, sur 156 malades 12 avaient été hospitalisés pour des bilans qui auraient pu être effectués à bien moindre frais à l’extérieur. Ces 12 hospitalisations avaient provoqué 52,2 % des dépenses ; autrement dit ces 12 malades avaient à eux seuls coûté plus cher que les 144 autres de l’enquête.
Avec le problème du coût du diabète, je viens d’effleurer le domaine du traitement et je me garde de m’y engager car il va être traité amplement par les orateurs qui vont me succéder. Je me bornerai à attirer l’attention sur un phénomène étrange qui singularise la diabétologie.
Un médecin qui serait tombé il y a un demi-siècle dans un coma exceptionnellement prolongé et se réveillerait ces jours-ci ne reconnaîtrait rien dans la pharmacopée actuelle de la plupart des maladies notamment la psychiatrie, l’hypertension arté-
rielle, des secteurs entiers de la chirurgie et tant d’autres.Par contre, en ce qui concerne la pharmacopée du diabète il ne se sentirait pas trop dépaysé. L’insuline garde un rôle majeur depuis plus de trois quarts de siècle (rappelons que le prix Nobel de Banting et Mac Leod simultané à une introduction immédiate en thérapeutique date de 1923). Certes sa molécule a fait l’objet de travaux remarquables de nombreuses équipes de chimistes mais sous des formes multiples et avec des maté- riels d’administration variés, y compris les greffes et les cultures d’îlots mais c’est toujours l’insuline qui est la base du traitement du diabète de type 1 ; et parmi ces variétés la NPH de Hagedorn basée sur l’association avec la protéine de truite est sortie à la veille de la seconde guerre mondiale et est toujours utilisée massivement.
La seule nouveauté importante a été la découverte de l’action hypoglycémiante de certains sulfamides. Encore a-t-elle été due au pur hasard constaté par des cliniciens auxquels les fabricants les avaient confiés pour essais contre le bacille d’Eberth et le staphylocoque contre lesquels les premiers sulfamides découverts avant guerre étaient totalement inactifs.Mais là aussi depuis la sortie des premières molécules suivie de l’apparition de nombreuses autres le mécanisme d’action et les indications restent les mêmes. Ainsi le premier sulfamide qui avait été diffusé le carbutamide continue toujours sa carrière. Qui n’a que peu changé depuis l’époque, à la veille de Noël 1954, quand Jacques Servier l’avait apporté pour essai aux deux experts désignés par le Ministre de la Santé, mon Maître Raoul Boulin et moi-même. A peu près à la même période sortaient les biguanides : là aussi la metformine mise a poursuivi sa carrière sans modifications.
Depuis cette époque une seule catégorie de médicament hypoglycémiant de mécanisme original est sortie : c’est celle des inhibiteurs des alpha-glucosidases. Mes ces produits intéressants et d’action modérée ont une diffusion limitée du fait de leurs effets secondaires intestinaux. Plus récemment les Glinides d’action modérée elles aussi ne constituent pas une véritable nouveauté car leur formule chimique a été inspirée de celles des sulfamides hypoglycéniants.Tout récemment on a eu l’espoir de posséder une famille qui pourrait renouveler le traitement du diabète de type 2, mais les Glitazones ont rapidement buté sur l’obstacle d’une toxicité secondaire, hépatique pour la première et l’épée de Damoclès d’inconvénients secondaires pend au dessus des deux suivantes.
Notre médecin imaginaire se réveillant au bout de son sommeil ne serait donc pas trop dépaysé ; seul le secteur des médicaments indispensables comme les hypolipé- miants ou le traitement des complications cardio-vasculaires lui demanderait un gros effort de mise au point de ses connaissances.Mais la découverte de produits à la fois maniables et ayant un fort pouvoir hypoglycémiant relève encore de l’espoir et de l’attente.
* Membre de l’Académie nationale de médecine.
Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, no 7, 1277-1284, séance du 14 octobre 2003