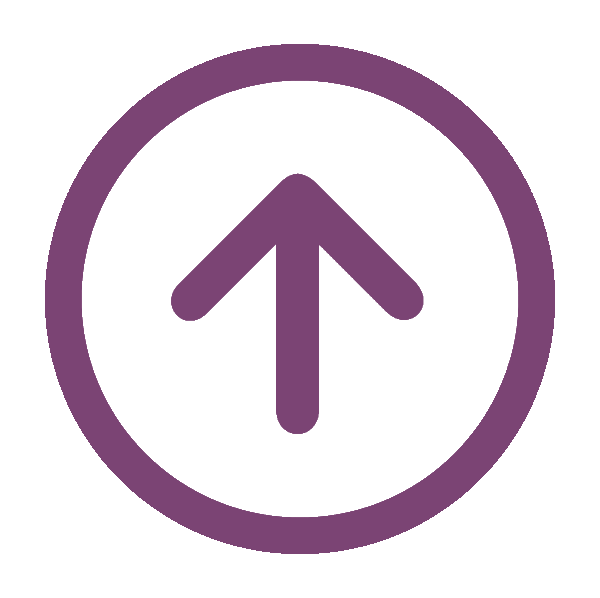Résumé
À la fin de l’Ancien Régime, Fourcroy fait le lien entre Vicq d’Azyr et Colombier qui usent leur santé à tenter de réformer la médecine tombée en pleine confusion. Mais tous deux meurent. Tout désormais passe par Fourcroy qui, le 10 mars 1803 (19 Ventôse an XI), fait voter une loi réorganisant l’ensemble de la profession. Cette loi, dont c’est le bicentenaire, demeure d’actualité pour l’essentiel : nul ne peut désormais exercer la médecine ou la chirurgie sans avoir été reçu docteur. Sauf dans les campagnes déshéritées où les « officiers de santé » créés comme palliatif pratiquent avec un bonheur inégal jusqu’en 1892.
Summary
During the last years of the Ancien Régime, Fourcroy establishes the link between Vicq d’Azyr and Colombier who both wore themselves out in order to reform the medical profession, fallen into a state of turmoil. But both died and henceforth everything was handled by Fourcroy. On 10 March 1803 (19 Ventose an XI) he arranged for the passage of a fundamental law — today bi-centennial — reorganising the profession. Henceforth no one could exercise that profession without having been receiving as a doctor, except in underdeveloped regions where « health officers » (less qualified practitioners) would take.
INTRODUCTION « La mode est aux commémorations » observait en 1995 Jean-Charles Sournia, brossant à cette tribune le portrait de Vicq d’Azyr à l’occasion du bicentenaire de sa mort, faisant également allusion au colloque consacré à la loi du 14 Frimaire an III (4 décembre 1795) qui avait bénéficié du label des Célébrations Nationales. La mode est-elle aujourd’hui un peu passée ? Sur le plan général, il ne semble pas ; cependant, les commémorations médicales paraissent moins fréquentes et, ainsi, votre compagnie aura été la seule institution à évoquer le bicentenaire de la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) dont celle du 14 Frimaire an III (4 décembre 1794) sur la recréation de l’enseignement médical ne constituait que le préalable. La loi de Ventôse aura pourtant conféré à la médecine française son mode d’exercice, pour l’essentiel toujours en vigueur de nos jours. Ajoutons incidemment qu’avec « Madame Bovary », le xixe lui devra un des plus beaux édifices de ce qu’Alain
Besançon nomme « le chantier de la littérature mondiale » 1.
Les dates fixant les règles de la pratique médicale ont été peu nombreuses au cours des temps et, en remontant jusqu’à Louis XIV, on peut même les compter sur les doigts d’une main : l’édit de Marly (1707) maintenant le corps médical sous l’autorité du moins morale de l’Église, la loi de Ventôse (1803) liant l’exercice au doctorat tout en créant les officiers de santé, la loi de 1892 les supprimant. À ces trois textes, peuvent s’en ajouter deux autres propres à la formation du praticien : le décret du 14 Frimaire an III (4 décembre 1794) introduisant la clinique dans l’enseignement médical et l’ordonnance du 30 décembre 1958, mariant la clinique avec la recherche, et faisant de l’étudiant un acteur « effectif » 2 de l’activité hospitalière.
Ce qui fait tout de même assez peu.
ENTRE VICQ D’AZYR ET COLOMBIER
La loi de Ventôse an XI n’est pas plus tombée du ciel que son préalable de Frimaire.
Toutes deux sont l’œuvre d’Antoine-François Fourcroy, classé comme chimiste dans la mémoire collective, mais qui, durant près de trente ans, aura été le plus étroitement mêlé à tout ce qui touche à la médecine [14]. Sans doute beaucoup le savent dans cette enceinte, tout particulièrement grâce au Professeur Gabriel Richet, mais il y a néanmoins des aspects de sa vie durant l’Ancien Régime qui ne remontent pas spontanément à l’esprit, alors qu’ils éclairent bien des choses. Certes, la plus grande part de ses journées est, durant cette période, consacrée à la chimie qu’il oriente vers la médecine, s’agissant du rôle des organes ou de l’action des médicaments. Aussi 1. Besançon A. — « Dostoievski » comm. Ac. sc. mor. et pol. Institut de France, 10 mars 2003.
2. Ordonnance no 58-1373 (30 déc. 1958), art. 3 : « Les études médicales théoriques et pratiques (…) doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière » ( J.O . 31.12.58, p. 12 070).
s’étonne-t-on qu’il puisse trouver encore du temps à consacrer à la Société royale de Médecine, que Vicq d’Azyr, dont il devient le plus proche collaborateur, vient de créer dans la mouvance de Turgot afin de faire progresser les connaissances, mais également de formuler des propositions relatives à la formation du praticien ou à l’exercice même de la profession [23]. À ces titres, cette société incarne la modernité et viendra vite le moment où elle sera le fer de lance contre « les antiques facultés » qui, Révolution ou pas, ont bien du mal à survivre. Mais Vicq d’Azyr n’est pas le seul à rêver de réformes. Non loin de lui, réfléchit le chirurgien Jean Colombier qui, proche de Necker, se voit nommé par le ministre inspecteur général des hôpitaux du royaume. Or il se trouve que Colombier a été, dans un contexte assez houleux, le vigilant et imaginatif directeur de thèse de Fourcroy. Tout s’éclaire : à celui-ci d’inventer encore du temps pour créer et entretenir le contact entre ces deux hommes de bonne volonté qu’aucune difficulté ne décourage, qu’aucun obstacle ne rebute. Et ainsi, non loin de cornues où chauffe une analyse de chimie médicale vont s’empiler sur sa table des mémoires relatifs aux hôpitaux destinés par Colombier à Vicq d’Azyr et d’autres sur le désert médical des campagnes rédigés par Vicq d’Azyr pour Colombier.
Mais pour voir la concrétisation de leurs idées, les visionnaires doivent vivre au moins jusqu’au moment où leurs contemporains se rallient à celles-ci ou s’en emparent. Ce qui ne sera le cas d’aucun des deux. Colombier, épuisé par le travail, meurt en 1789 et Vicq d’Azyr en 1794 sans que la Terreur, du moins directement, y soit pour quelque chose. Qu’il s’agisse de la pratique rurale, du remodelage de l’enseignement ou de la mutation de l’hospice en hôpital, Fourcroy est désormais le français qui, non seulement connaît le mieux la situation de la médecine en France, mais qui, ayant d’autre part tenu un rôle de premier plan dans le glissement de la Convention terroriste à la Convention thermidorienne, est dès lors le mieux placé pour bâtir cette loi de Frimaire an III dont l’article 4 consacré aux études contient cette disposition essentielle : « (…) les élèves pratiqueront les opérations anatomiques, chirurgicales et cliniques ; ils observeront la nature des maladies au lit des malades (…) » [2, 6].
« Clinique », « lit du malade », les mots sont lâchés. Commentant en 1967 l’épisode, l’historien de la médecine E. Ackerknecht observera judicieusement : « Si ce n’est pas encore la médecine moderne, c’est déjà une médecine moderne » [1].
CONTENU DE LA LOI
Le passage du rétablissement de l’enseignement médical à la réorganisation de l’exercice de la profession ne prendra pas moins de sept ans [15, 17, 18]. Dans la mesure où Fourcroy est le personnage-clé tant au début qu’à la fin du processus, ce délai peut paraître long. En fait, il ne l’est pas, car les dossiers auxquels, sous son autorité, se seront attaqués les réformateurs thermidoriens, puis brumairiens auront été multiples. De plus, la nomination, en novembre 1800, de Chaptal au ministère de
l’Intérieur aura permis d’accélérer la mise en route de ceux qui avaient trait à la mutation hospitalière. À peine deux mois plus tard, les sœurs de la Charité retrouvent leurs services, dont beaucoup d’entre elles ne s’étaient pas vraiment éloignées, puis, l’année suivante, en 1802, c’est, à la fois, la mise en place de l’administration des Hospices à Paris et à Lyon, le retour des legs et fondations, la création du bureau central d’admission, le premier concours de l’internat de Paris et celui de l’externat, l’installation de l’école des sages-femmes [15, 18].
Un décret encore, celui-là dans le cadre de l’Instruction publique, portant sur le recrutement des professeurs des écoles de médecine, et voilà Fourcroy à même de se mesurer à ce qui est à la fois la France profonde et la France d’en-bas. Flanqué opportunément du ministre de l’Intérieur, le moment est venu de débarrasser le territoire de la République de la foule des charlatans, « conjureurs », sorciers, magiciens ou autres escrocs que la loi du 2 mars 1791, donnant à quiconque le droit de mener l’activité que bon lui semble, puis la suppression, le 15 septembre 1793, des facultés de médecine, avaient laissé en toute impunité se répandre dans les campagnes [5, 11]. En ville, le danger était plus pernicieux, représenté à la devanture des librairies par une multitude d’ouvrages d’automédication, souvent rédigés par des auteurs animés des meilleures intentions, mais qui, à en croire Portal, étaient à peine moins redoutables que les charlatans les plus effrontés. « Rien n’est plus dangereux que ces demi-connaissances répandues dans le vulgaire ; (personne n’aura) fait autant de mal que les « Avis au peuple » de Tissot et, en général, que tous les livres de médecine populaire » écrit dans le Journal de l’Empire (16 novembre 1806) le futur fondateur de l’Académie de médecine.
Désormais, soit à partir du début de l’an XII (24 septembre 1803), le droit d’exercer se trouvait lié à l’obtention de deux diplômes, soit celui de docteur en médecine ou en chirurgie, de portée nationale et décerné par l’une des six écoles de médecine, soit celui d’officier de santé, obtenu à moindre coût mais à stricte limite départementale [6]. Voilà qui est clair pour l’avenir, mais dans ce retour à la légalité, au légalisme même, de quel corps médical va sur le champ disposer la société ? La loi fait-elle un tri ou une sélection parmi les praticiens qui avaient acquis le droit de sous l’Ancien Régime, qu’ils aient été reçus par les facultés d’alors, les collèges de chirurgie, les communautés de chirurgiens, voire les universités étrangères ?
UN CORPS MÉDICAL DE QUATORZE ORIGINES
L’essentiel, pour Fourcroy, Chaptal, mais aussi le Premier consul qui suit l’affaire de près, est que la renaissance du corps médical se fasse sans tapage, quitte à ne pas se montrer trop regardant sur la compétence de certains des « débris » — le terme n’a pas alors la connotation péjorative qu’il a acquis depuis — de l’Ancien Régime.
Pour eux il ne s’agira pas de « passe-droit » mais plutôt de ce qu’on a appelé depuis les « avantages acquis ».
La meilleure façon de se faire une idée du nombre des bénéficiaires est d’analyser, au travers de l’Annuaire médical publié par Maygrier en 1810, soit sept ans après la mise en application de la loi de Ventôse, le classement par origines des 548 praticiens composant, cette année-là, le corps médical parisien [19] : « Anciens docteursrégents, 66 ; diplômés des facultés de France, autres que celle de Paris, 97 ; docteurs en médecine reçus dans les nouvelles écoles, 114 ; médecins ayant exercé par charges, 6 ; chirurgiens diplômés par le collège de chirurgie de Paris, 77 ; anciens chirurgiens reçus par d’autres collèges que celui de Paris, 8 ; anciens chirurgiens reçus par les communautés, 2 ; anciens chirurgiens ayant exercé par charges, 14 ; anciens chirurgiens reçus par le lieutenant du premier chirurgien du roi, 90 ; anciens chirurgiens exerçant par baux de privilèges, 16 ; anciens chirurgiens herniaires, 7 ; anciens chirurgiens dentistes, 11 ; docteurs en chirurgie (école de médecine), 24 ; officiers de santé reçus suivant les nouvelles formes, 11.
Une liste qui appelle quelques commentaires :
— sur les quelques 160 docteurs-régents de la faculté de Paris en activité en 1785, un peu plus du tiers exercera encore vingt-cinq ans plus tard, dont Bourru, leur dernier doyen qui, toujours en vie en 1820, sera de façon quasi-institutionnelle nommé à l’Académie royale de médecine à seule fin d’établir un pont entre l’établissement que Fourcroy nommait tantôt « l’antique faculté », tantôt « l’arrogante faculté » du temps passé et le nouveau régime ;
— placer au même niveau les anciens docteurs-régents et certains chirurgiens reçus au fond des provinces par les lieutenants locaux des premiers chirurgiens du roi, n’est pas très cohérent. Les premiers constituaient l’élite de la profession, les seconds, qualifiés le plus souvent de « léger savoir » ou de « légère expérience » n’étaient certainement guère plus compétents que les officiers de santé que la loi installe en les distinguant très nettement des docteurs auxquels, eux, — divine surprise — se trouvent assimilés ;
— les anciens chirurgiens reçus par les communautés principalement les frères de la Charité, sont ainsi assimilés par la loi aux docteurs en médecine ou en chirurgie.
Et ici les critiques, généralement sarcastiques 3, visant le père Elysée, premier chirurgien de Louis XVIII, que l’on rencontre sous des plumes généralement mieux inspirées, perdent leur principal support. Son ambition et divers traits de sa personnalité peuvent faire sourire, voire irriter, mais son droit à exercer était tout à fait légal ; ce n’était pas plus un charlatan qu’il n’était un homme d’église ;
— le quart de l’ensemble, soit 138, sont des docteurs du nouveau régime. Moins de 20 % d’entre eux ont choisi le doctorat en chirurgie dont on mesure d’emblée l’éphémérité.
3. « [le père Elysée], un moine ignorant que Louis XVIII (…) avait fait premier chirurgien parce que cet infirmier ignare pouvait présenter un clystère et manier quelques instruments de pédicurie ».
Mondor H. — Dupuytren, Paris : Gallimard, 1946.
Demeurent enfin ceux qui se sont établis durant les turbulences révolutionnaires, alors que les facultés avaient fermé leurs portes et dont aucune thèse n’a, de ce fait, sanctionné les études. À eux de régulariser, car la loi est formelle : « Ils continuent leur profession en se faisant recevoir docteurs ou officiers de santé » [6]. Parmi les praticiens placés dans cette situation ambiguë, certains avaient déjà accédé à la notoriété, voire bien au-delà, tels Boyer, premier chirurgien du Premier consul, ou Larrey, chirurgien en chef de la garde des consuls qui, aux accents de l’épopée, sera bientôt la Garde tout court. Tous deux se devaient de montrer l’exemple ; ils ne se dérobèrent pas et lorsque la loi devint exécutoire le 24 septembre 1803, le premier s’était déjà présenté devant son jury le 3 septembre et le second dès le 13 mai.
Ajoutons que s’il n’était pas mort en juillet 1802, Bichat lui-même se serait trouvé dans le même cas de figure.
Le rétablissement du doctorat, désormais incontournable pour qui voulait exercer, était attendu par tous, de même la distinction dans l’égalité entre médecins et chirurgiens qu’il était encore un peu tôt pour fondre dans un corps unique. Sur ces deux points, il n’y avait pas lieu de s’appesantir, pas davantage sur le refus d’admettre l’existence des spécialités, qu’il s’agisse des maladies des yeux ou même de l’art dentaire. La loi ne s’encombre pas de nuances : le médecin traite toutes les maladies et nul n’a de comptes à lui demander sur le choix de sa thérapeutique ; le chirurgien opère de la racine des cheveux à la plante du pied et, lui aussi, est libre du choix de ses gestes. Le cas de Dupuytren donne une bonne image de la vastitude de son champ d’action : un tableau conservé au Musée Carnavalet, d’auteur malheureusement anonyme, montre le chirurgien présentant à Charles X une religieuse qu’il a peu auparavant opérée de la cataracte ; lorsque le duc de Berry est frappé d’un coup de couteau dans la région du cœur, c’est lui qu’on va chercher jusqu’au fond de son lit ; au membre supérieur, son nom est attaché au traitement de la rétraction de l’aponévrose palmaire et, au membre inférieur, à celui des fractures bi-malléollaires ; enfin, quand il est question d’honoraires, il est classique que soient cités ceux qu’il demanda au comte de la Tour du Pin, qu’il était venu en 1809 opérer à Bruxelles où ce dernier était préfet « d’un ganglion sous le pied ».
LES OFFICIERS DE SANTÉ
Dans les premiers temps, la création des officiers de santé put paraître une bonne idée, plus d’ailleurs qu’une idée neuve, dans la mesure où ils se calquaient plus ou moins sur les chirurgiens « de léger savoir » de l’Ancien Régime. Le grand avantage est qu’exerçant dans les limites du département, ils se trouvaient nécessairement être du cru, comprenant et même parlant le patois de leur clientèle. « L’interrogatoire », moment essentiel de la médecine clinique qui s’installe, en sera grandement facilité.
De plus, alors qu’en ville les docteurs s’essayaient à devenir des « messieurs », eux étaient honorés par une volaille, un ressemelage ou une bride pas forcément neuve, mais moins usagée, pour le cheval.
En revanche, leur création supposant deux niveaux de compétence et, par là même, deux modes d’exercice, remettant ainsi en cause les principes d’égalité qui demeurent officiellement la base du régime, pouvait prêter à des protestations. D’autant que parmi les réformateurs, certains, et non des moindres, ne cachaient pas leur hostilité au projet. Ainsi Cabanis qui, lors d’une séance au Conseil des Cinq-Cents, avait vivement contesté l’utilité de ces demi-médecins alors en gestation, s’écriant « m’objectera-t-on que les campagnes manqueront de secours, si l’on exige de trop fortes études de la part des officiers de santé ? Je réponds qu’il vaut mieux que les campagnes manquent de médecins que d’en recevoir de funestes. » [4] Pour sa part, le tout-Paris s’esclaffait : comment s’assurer que ces demi-médecins ne traiteront que des demi-malades auxquels ils ne donneront que des demi-remèdes ?
D’où la nécessité de préparer l’opinion et c’est à Thouret, gendre de Colombier et directeur de l’école de santé de Paris, que Fourcroy confia la tâche de présenter le projet au Tribunat, minimisant le rôle des officiers de santé et, par là même, les risques qu’ils pouvaient générer [16].
« Les officiers de santé se borneront aux soins les plus ordinaires, aux procédés les plus simples de l’art, ils porteront les premiers secours aux malades, aux blessés, traiteront les affections les moins graves, s’occuperont des pansements communs et journaliers ». Et au terme de cette description qui est plutôt celle d’un infirmier, voire d’un garde-malade, que d’un sous-médecin, Thouret met en avant un argument dont, Gustave Flaubert aidant, l’époque réalisera bientôt la fragilité : « Leur science principale [devra] consister à reconnaître les cas où ils ne doivent pas agir. » Et l’orateur de conclure : « Ils formeront sans doute une classe moins relevée dans la hiérarchie médicale. Mais pour être moins distingués, ils n’en seront pas moins utiles ».
Utiles certes, d’autant qu’on attend d’eux d’être en première ligne contre l’ennemi.
Celui-ci étant, non pas la maladie, mais… le charlatan et l’empirique. C’est toute la contradiction de la loi de Ventôse de bloquer l’intervention de ces nouveaux praticiens aux « affections les moins graves et aux pansements communs et journaliers » tout en considérant qu’ils vont, par leur seule présence, faire fuir « la tourbe nombreuse et ignorante qui, dans ces dernières années, s’est répandue dans les départements (…) ces hordes d’empiriques (qui) assiègent les places dans les cités, se répandent dans les bourgs, dans les campagnes et portent partout la désolation et l’effroi » [9].
Pour se protéger de « cette calamité publique, et mettre un terme au brigandage qui règne », la parade n’était-elle pas un peu courte ? Les tribuns crurent — ou affectè- rent de croire — que non et à l’unanimité envoyèrent, le 19 Ventôse, le projet devant le Corps législatif. Aux côtés de Fourcroy à qui revenait de s’exprimer au titre « d’orateur du gouvernement », deux tribuns issus du corps médical — JarsPonvilliers, médecin à Niort sous l’Ancien Régime, et Carret, à la même époque chirurgien à Lyon — avaient été désignés pour détailler la loi et éventuellement la défendre. Ils rempliront consciencieusement leur tâche, mais pour justifier l’aban-
don par les docteurs des régions défavorisés aux officiers de santé, tous deux vont employer une argumentation sonnante et trébuchante, qui, chuchotée, n’aurait pas vraiment étonné, mais qu’on est davantage surpris d’entendre proclamée à la tribune. À lire leurs propos, ce n’est pas Napoléon, mais déjà Louis-Philippe, qui, lors de cette séance, perçait sous Bonaparte…
Jars-Ponvilliers, pour sa part, met en valeur « les larges travaux, les dépenses considérables, les sacrifices imposés aux familles, qui constituent le prix auquel la société peut obtenir des hommes instruits dans l’art de guérir. La réputation, la gloire, la fortune sont les récompenses auxquelles aspire celui qui s’est déterminé à ces sacrifices. Le fera-t-il pour exercer son art dans une commune peu populeuse au milieu d’un petit nombre de familles sans aisance ». Carret rejoint son prédécesseur pour stigmatiser l’injustice qu’il y aurait à obliger « ceux qui ont acquis une connaissance profonde de la médecine (…) à enfouir leurs talents dans la campagne. » « D’autant, ajoute-t-il, que les habitants (de celles-ci) ayant des mœurs plus pures que celles des habitants des villes ont des maladies plus simples qui exigent par cette raison moins d’instruction et moins d’apprêts. » [16, 18] Un propos que la postérité ne manquera pas de faire figurer au bêtisier international et que nombre d’historiens attribuent à tord à Fourcroy. Pour être moins tentée de rousseauisme, l’argumentation reprise par « l’orateur du gouvernement » dans sa conclusion n’en est pas moins critiquable. De quoi a-t-on besoin dans les campagnes ? « d’officiers de santé plus exercés à la pratique que savants et profonds dans la théorie, destinés à traiter des maladies légères, à remédier aux accidents primitifs, aux légères indispositions. » Sans doute, mais comment Fourcroy peut-il dans l’instant oublier que, sans soins appropriés, le propre des « maladies légères, accidents primitifs ou légères indispositions » est bien souvent de s’aggraver ?
Comme les tribuns, les députés ne demandaient qu’à être convaincus, et, par 210 voix contre 6, adoptèrent le texte qui leur était proposé.
L’AVENIR DE LA LOI
Pour les docteurs, la loi de Ventôse demeure encore aujourd’hui la clé de voûte de l’exercice professionnel, mais au niveau des officiers de santé, la situation ne tarda pas à se compliquer. Dès 1826, soit une vingtaine d’années à peine après leur création, de vives discussions débutèrent, tant à la Chambre des députés qu’à celle des pairs, leur reprochant de gagner progressivement le cœur des villes et, loin de se contenter d’y faire des pansements, d’y pratiquer la « vraie » médecine, et plus encore, la « vraie » chirurgie. La mésaventure de Charles Bovary en est la brillante et surtout fidèle illustration. Mais, bien davantage que les arrière-pensées du pharmacien Homais ou l’incompétence de Charles, c’est l’attitude du Dr Canivet qui est ici intéressante. Bovary ayant opéré sans son accord et loin de son regard, il avait, plus encore que le malheureux Hippolyte, la possibilité de le traîner devant les tribunaux [20]. Mais, se bornant à des rodomontades devant tout le bourg, il s’en gardera bien.
Son raisonnement est clair : Bovary et ses pairs des environs ne pourront que lui savoir gré de sa mansuétude. C’est ainsi que s’élargissent les clientèles.
L’extinction des officiers de santé se fit par le haut. Plutôt que mener une « gué- guerre » aux épisodes incertains, ils profitèrent de leur relative aisance pour faire de leurs fils des docteurs. Alors qu’ils glissaient ainsi que Flaubert à Labiche, la partie de la loi de Ventôse les concernant devenait sans objet alors que se développait celle qui, pour le législateur, était essentielle : avant la fin du Second Empire, les docteurs couvraient le territoire.
La loi du 30 novembre 1892 n’avait plus qu’à leur en donner acte. L’expédient provisoire que constituait l’officiat de santé dans l’esprit même de ceux qui le créèrent aura sans doute duré plus longtemps que prévu, mais il n’avait plus de raison d’être. De la loi de Ventôse demeurait l’essentiel : elle avait fondé l’incontournable doctorat en médecine qui avait vu rapidement se fondre en lui l’éphémère et inutile doctorat en chirurgie, cet autre expédient provisoire.
BIBLIOGRAPHIE [1] Ackerknecht E.H. — La médecine hospitalière à Paris, 1794-1848 (Baltimore 1967) Trad., Paris : Payot, 1986.
[2] Bernard J., Lemaire J.F., Larcan A. — L’acte de naissance de la médecine moderne, Paris : Les empêcheurs de penser en rond, 1995.
[3] Brockliss L. — The medical world of Early Modern France. Oxford : Clarendon Press, 1997.
[4] Cabanis G. — Coups d’œil sur les révolutions de la médecine et sur la réforme de la médecine, Paris, an XIII (1804).
[5] Delaunay P. — D’une révolution à l’autre, 1789-1848. L’évolution des théories et de la pratique médicale. Paris : Hippocrate, 1949.
[6] Duvergier J.B. — Collection complète des lois, décrets (…), Décret du 14 Frimaire an III, loi du 19 Ventôse an XI, Paris, 1834.
[7] Fodere F.-E. — Les lois éclairées par les sciences ou traité de médecine légale et d’hygiène publique, t. III, An VII (1799).
[8] Foucault M. — Naissance de la clinique : une archéologie du regard médical. Paris : PUF, 1963.
[9] Fourcroy A.F. — Discours sur le projet de loi relatif à l’exercice de la médecine 19 Ventôse an XI. Paris, an XI (1803).
[10] Goubert J.P. et autres — Historical reflections, la médicalisation de la Société Française 1770-1830, vol. 9, Waterloo (USA) Spring et Sommer, 1982.
[11] Huard P. — Sciences, Médecine et Pharmacie de la Révolution à l’Empire 1789-1815. Paris :
Dacosta, 70.
[12] Imbault-Huart M.J. — L’institution médicale à l’époque de Bourneville In Poirier J. et
Signoret J.L. De Bourneville à la sclérose en plaques. Paris : Flammarion, 1991.
[13] Keel O. — L’avènement de la médecine clinique moderne en Europe 1750-1815 (Montréal 2001) Trad. fr. Georg, Genève, 2002.
[14] Kersaint G. — Antoine-François de Fourcroy, 1755-1809. Sa vie, son œuvre. Muséum d’Histoire Naturelle, 1966.
[15] Lemaire J.F. — La médecine napoléonienne. Nouveau Monde édition — Fondation Napoléon, Paris, 2003.
[16] Le Moniteur , An XI, séances du 16, 19 Ventôse et 21 Germinal, vol. 1.
[17] Leonard J. — Les médecins de l’Ouest au xixe siècle t. I, Lille III, 1973.
[18] Leonard J. — La médecine entre les pouvoirs et les savoirs. Paris : Aubier, 1981.
[19] Maygrier J.P. — Annuaire médical., Paris, 1810.
[20] Ollivier, Velpeau, Adelon. — Quelles sont les grandes opérations chirurgicales que les officiers de santé ne peuvent pratiquer sans la surveillance et l’inspection d’un docteur ? In Annales d’hyg. et de médec-légale, 1841, t. XXV.
[21] Poinsot P.G. — L’ami des malades de la campagne. Paris, 1806 (pour ne citer que cet ouvrage).
[22] Sournia J.-C. — La médecine révolutionnaire, 1789-1799. Paris : Payot, 1989.
[23] Tulard J. — L’héritage révolutionnaire sous Napoléon In Imbert J. et autres, la protection sociale sous la Révolution française , Association pour l’étude de l’histoire de la Sécurité sociale.
Paris, 1990.
[24] Vicq d’Azyr F. — Nouveau plan de constitution pour la médecine en France, Ass. Nat., Paris, 1790.
[25] Waquet J. (avec Antoine M.E.). — La médecine civile à l’époque napoléonienne et le legs du xviiie siècle. Revue de l’Institut Napoléon . Paris, 1976, no 132.
[26] Weiner D.B. — The citizen-patient in Revolutionary and Imperial. Paris : Baltimore, The John’s Hopkins In. Pr. 1993.
Pour ‘‘
Madame Bovary ’’, les éditions présentant un bon appareil critique sont multiples. En revanche, l’on peut relire avec fruit la thèse de René Dumesnil : Flaubert et la médecine, Paris, 1905.
DISCUSSION ET COMMENTAIRES
M. Jean TULARD *
Pour donner encore plus d’ampleur à cette remarquable communication, il faudrait rappeler l’héritage révolutionnaire. Inspirée par les physiocrates la Révolution était hostile à toute réglementation, obstacle au progrès, et à tout privilège dont celui d’exercer la médecine. Elle a donc détruit les corporations, les académies, les facultés. Du coup on a vu se multiplier les guérisseurs, les rebouteux, les charlatans.
Il faut donc en revenir, dès le Consulat, à la réglementation. On débat même sur un rétablissement des corporations. À côté des médecins, il faut rappeler que sont réorganisées les professions d’avocat, notaire ou architecte.
L’Empire a eu un souci constant de la santé des Parisiens et de la salubrité de sa capitale, créant le conseil général des hospices et le conseil de salubrité.
Pourtant Napoléon ne croyait ni aux médecins ni aux médicaments. À Sainte-Hélène, il vante le système de Babylone. À cette époque, la famille exposait le malade dans la rue et * Membre de l’Institut, titulaire de la chaire d’histoire du 1er Empire à Paris IV-Sorbonne.
demandait aux passants si ils avaient été frappés par ce mal et comment ils en avaient été guéris. On était alors sûr du remède, ajoutait Napoléon dans un demi-sourire, puisque seuls ceux qui lui avaient survécu étaient en état d’en parler.
M. Claude SUREAU
Quelle interprétation pouvez-vous donner de l’article 29 de la loi de Ventôse dans le cadre de la définition de la responsabilité professionnelle des docteurs en médecine ? Est-ce un argument en faveur de l’irresponsabilité civile et pénale des docteurs ou au contraire, en faveur de l’application universelle, y compris aux docteurs, de l’article 1382 du Code Civil ?
L’article 29 de la loi de Ventôse, plaçant l’officier de santé sous la responsabilité du docteur en médecine est effectivement ambigu. Suffisait-il qu’un docteur soit présent pour qu’il n’y ait pas de faute, l’officier de santé se trouvant alors couvert par le docteur et celui-ci étant irresponsable par nature ? On put le croire un bref moment, lorsqu’en 1827 et 1829, dans les méandres de l’affaire Hélie que M. Sureau connaît si bien, l’Académie de médecine, siégeant en séance plénière, mit en avant à deux reprises le principe de l’irresponsabilité absolue du médecin, pensant couper ainsi court à toute interprétation contraire. Mais le modeste tribunal de Domfront, galvanisé par la révolution de 1830 survenue avant que l’affaire n’ait reparu devant lui, substituait à la loi de Ventôse les articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil. La jurisprudence emboîta définitivement le pas, élargissant même, de procès en procès, le domaine de la responsabilité médicale et, par voie de conséquence, les officiers de santé ne retrouvèrent jamais leur parapluie.
M. Alain LARCAN
La loi de Ventôse n’est-elle pas une loi d’application de la loi du 14 Frimaire an III, précisant les modalités d’exercice ? La loi de Ventôse formule de nombreux points qui demeurent d’actualité pour les études médicales : durée des études, répartition des matières théoriques et de l’enseignement clinique au chevet du malade ou dans les consultations, universalité du titre de docteur en médecine. En ce qui concerne les officiers de santé que Fouché voulait dès 1809 contrôler, ils pouvaient effectivement exercer dans un département suivant plusieurs formules. En fait, on a cherché avant tout à créer une médecine de proximité dans des campagnes qui représentaient 80 % de la population. Ils n’apparaissent pas chez Balzac.
N’est-ce pas parce que les médecins nés de sa plume appartenaient encore à l’Ancien Régime ou aux habilitations de la période de transition ? Observons enfin que la démocratie médicale et la qualité vont s’améliorer à partir de 1808, passant de un praticien pour 2 000 habitants en 1792 à un pour 680 en 1822.
Frimaire et Ventôse, même nées à sept ans d’intervalle, sont sœurs, siamoises même.
Toutes deux ont Fourcroy pour père et c’est à celui-ci que revient d’avoir choisi par laquelle débuter. D’une part, il fallait remettre de l’ordre en médecine, comme dans bien d’autres domaines, et, d’autre part, assurer l’avenir en relançant les études. Fourcroy a commencé par les études, puis a remodelé la pratique. Il a eu raison. Pour les études le pouvoir des Directeurs suffisait, mais pour ce qui est du ménage, il n’était pas mauvais que l’ombre du Premier consul couvre déjà la France et que Chaptal soit le ministre de l’Intérieur. Les officiers de santé n’appartiennent pas, c’est vrai, au monde médical de la Comédie Humaine que M. Jean Bernard a si heureusement approfondi, ne serait-ce qu’au travers de Desplein-Dupuytren. Beaucoup des médecins tombés de sa plume
relèvent déjà de nouvelles écoles. Souvenons-nous, dans
Le Cousin Pons, du Dr Poulain portant fièrement son titre d’ancien interne des hôpitaux de Paris et « qui court le Marais pour une consultation à quarante sous. »
M. Philippe VICHARD
La loi de Ventôse a eu le mérite de refaire ce qui a été défait par la Révolution. Elle a procédé à l’unification du Corps médical, mais l’unité était déjà pratiquement acquise à la veille de la Révolution. Par ailleurs, l’officier de santé était sans doute une nécessité, compte tenu de la crise engendrée par la fermeture des facultés de médecine. L’officiat de santé aurait eu une existence moins longue, sans la Révolution de 1848, qui l’a sauvé. Les gros reproches que méritent cette loi ne sont-ils pas les suivants : la loi du 19 Ventôse an XI aura été génératrice d’une centralisation universitaire, très préjudiciable à l’enseignement médical ; l’internat des hôpitaux, institution hétérogène et semi-privée, a comblé pendant 150 ans le vide de l’enseignement chirurgical lié à cette disposition dérisoire que fut la thèse de chirurgie, seul critère de l’aptitude chirurgicale.
Il ne faut pas s’étonner que la loi de Ventôse soit aussi centralisatrice. Rarement une époque de notre histoire n’aura autant revendiqué ce caractère, la centralisation napoléonienne s’inscrivant dans le droit-fil de la centralisation jacobine. L’empereur aurait volontiers fait soutenir toutes les thèses de médecine à Paris, mais il buta sur le fait que dans ces départements qu’il ne cessait d’additionner, les étudiants ne parlaient pas forcément le français. Pour le doctorat en chirurgie, M. Vichard a raison d’employer l’expression de « disposition dérisoire ». En fait, dès le début de la remise en ordre de la médecine, le double doctorat était condamné, mais, ne serait-ce qu’en souvenir des lettres homériques qui avaient opposé médecins et chirurgiens, il fallait laisser aux esprits le temps de l’admettre ; de là mon expression « d’expédient provisoire » et la priorité donnée aux concours.
M. Maurice GUÉNIOT
La loi de Ventôse emploie une formule curieuse : « Nul ne peut exercer la médecine si il n’est pas possesseur du diplôme de docteur en médecine ». Cette rédaction a provoqué une polémique qui a connu un écho dans le grand public quand, un siècle après la promulgation de la loi, des jeunes femmes ont voulu s’inscrire dans les facultés de médecine qui leur étaient fermées jusqu’alors sur la base du terme de la loi « nul ne peut », nul n’étant considéré jusque là comme masculin ce qui entraînait le monopole de la médecine pour les hommes. Une partie de l’opinion s’est ralliée à la proposition de rejeter cette interprétation déjà séculaire de la loi en considérant que « nul » n’était pas masculin mais neutre. Les opposants récusaient cette possibilité en déclarant que la langue française contrairement au latin ne connaissait que le masculin et le féminin à l’exclusion du neutre. Comme on le sait, l’interprétation du caractère neutre du « nul » a fini par l’emporter, ce qui a ouvert les facultés de médecine aux étudiantes. Mais il était indispensable que cela résulte d’une décision officielle. Pouvez-vous nous dire quel en a été le mécanisme juridique ? Il n’y a pas eu de vote du parlement modifiant la rédaction de la loi. Y a-t-il eu un simple décret ministériel ou une circulaire d’application prise après demande d’un avis au Conseil d’Etat ?
ou encore une autre procédure ?
Il semble que l’interprétation de la loi de Ventôse ait, sur ce point-là du moins, suivi la sagesse populaire. Le « nul ne peut exercer (…) » est de la même aune que le « nul n’est
censé ignorer la loi », adage juridique dont l’origine et le sexe se perdent dans la nuit des temps. «
Nul », dans les deux formules est neutre et correspond à « personne ». Dans les débats qui ont suivi le moment où, sous le Second Empire et l’impératrice aidant, la porte de la pratique médicale a été entrebâillée devant les femmes, la référence à la masculinité du terme employé par les juristes brumairiens a fait rapidement long feu. Il n’y eut de ce fait aucune modification de la loi, aucune circulaire, aucun avis du Conseil d’Etat, mais des autorisations données au coup par coup et qui, plus ou moins vite, se fondirent dans la jurisprudence.
* Docteur en médecine, docteur en histoire, 97 rue du Bac — 75007 Paris. Tirés-à-part : M. Jean François Lemaire, à l’adresse ci-dessus. Article reçu le 18 février 2003, accepté le 24 février 2003.
Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, n° 3, 577-589, séance du 18 mars 2003