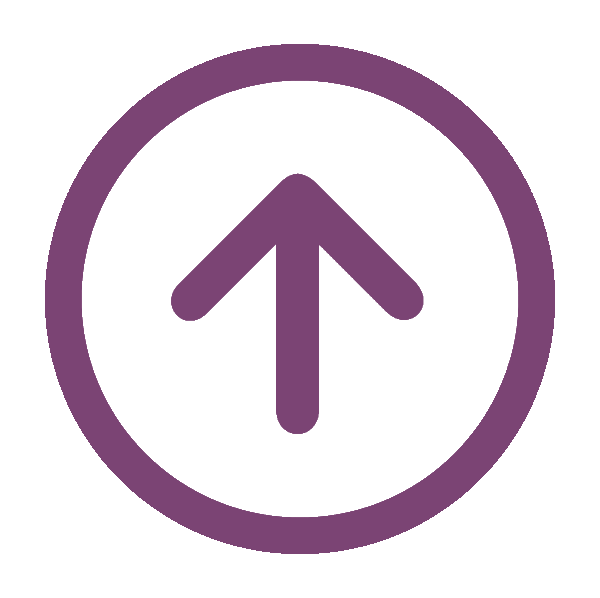Summary

Éloge de Jean-François CIER (1915-2008)
René MORNEX *
Monsieur le Président, Je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait en me confiant cet hommage qui fait remonter en moi de très lointains souvenirs.
La première image qui me vient à l’esprit date de novembre 1945. Un groupe d’étudiants frais émoulus du PCB pénètre avec respect dans la salle de travaux pratiques de physiologie dans laquelle des gradins ont été installés afin que tous puissent voir au centre, brillamment éclairée, une table chirurgicale sur laquelle un chien endormi est surveillé par un jeune étudiant. Entre dans la pièce un personnage, sosie mêlé de Gary Cooper et du Duc d’Edimbourg, élégant, beau, les manches du sarrau relevées. D’un trait vif, il dégage la carotide et dissèque le nerf pneumogastrique, connecte l’artère au tambour de Marey qui inscrit sur le cylindre garni de noir de fumée, le niveau de pression de l’artère et les oscillations correspondant aux battements du cœur. Une stimulation du pneumogastrique, le cœur se ralentit, la tension baisse.
Le commentaire rapide, concis est clairement exposé : « Messieurs, nous venons de reproduire l’expérience des frères Weber datant de 1850, et de confirmer la théorie inhibitrice de Brown-Sequard énoncée en 1865. Tout ceci vous sera détaillé dans la prochaine leçon consacrée à l’innervation extracardiaque ».
Nous étions tous sidérés et nous devions rester éblouis dans les années suivantes, par cet enseignant formidable dont vous avez deviné qu’il s’agissait de Jean-François Cier, depuis quelques jours chef de travaux de physiologie à Lyon.
Au cours des quelques soixante ans qui ont suivi, nos trajectoires, à des titres divers, se sont constamment croisées, ce qui peut excuser la tonalité personnelle de cet exposé qui va me permettre de retracer la vie de cet homme d’exception qui fut, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes Chères Consœurs et mes Chers Confrères, un des plus éminents membres de notre Académie nationale de médecine dans ces toutes dernières décennies.
Il fut, chères Françoise et Pascale, un père admiré et aimé et pour Thomas, bien connu dans cette enceinte, Cédric et Aurélie, un grand-père affectueux.
Enfin, vous tous ici présents, élèves et collaborateurs qui m’avez apporté votre analyse personnelle pour enrichir ce texte, vous avez vu en lui un ami, un collègue, un maître et je vous salue tous.
Deux éléments sont importants à mes yeux pour comprendre la personnalité de Jean-François Cier.
Le premier concerne ses racines. Son père, médecin de campagne, était habité par son métier, par la poésie et par des passions telle la chasse. Il était surtout gascon et c’est de là que Jean-François tirait tout son comportement et son tempérament.
C’est le mot panache qui peut le mieux le définir.
Du côté de sa mère, les racines sont à Nice, dans ce Comté rattaché à la France en 1860 et fier de ses traditions. Sa grand-mère maternelle était dotée d’un tempérament bien marqué. C’est ainsi que le mariage de ses parents ne fut admis qu’à condition que son père quittât son poste de médecin dans le Gers pour venir s’installer au bord de la Méditerranée. Jean-François est donc né à Nice le 21 mars 1915 et y a accompli ses études secondaires au Lycée Carnot avant de rejoindre Lyon, après son baccalauréat en 1932.
Le deuxième tournant significatif de son cursus, se situe à ce moment. Il voulait être médecin. Il aurait pu le devenir par des voies civiles, mais il a intégré l’Ecole du Service de Santé des Armées après un concours brillant. Quelle était sa motivation profonde ? Plus que l’appel de l’uniforme, je pense qu’elle était due à un certain scrupule économique. En effet, Jean-François avait un frère, André, son cadet de peu, qui se dirigeait lui aussi vers les études universitaires et leur souci à tous deux était probablement de ne pas trop peser sur les finances familiales qui, du côté paternel, étaient assez modestes.
En tout cas, je pense que ce passage dans le monde militaire lui convenait parfaitement. Il s’harmonisait en effet avec son goût des analyses rapides, des décisions promptes, même si quelquefois la fougue et la fermeté l’emportaient sur les nuances.
Plus je réfléchis, plus sa figure m’évoque l’épopée napoléonienne. En réalité, j’hésite entre deux types de personnages auxquels il aurait pu correspondre. Il aurait pu être un colonel de cavalerie, chargeant sabre au clair les troupes adverses. Je le vois aussi très bien en chirurgien, vêtu de blanc, couvert de sang, amputant à tour de bras sur le champ de bataille à la manière d’un Larrey..
Mais quittons ces fantasmes pour revenir à l’arrivée de Jean-François Cier à Lyon.
Dès la deuxième année, il s’oriente vers le laboratoire de Physiologie alors dirigé par le Professeur Hermann. Ce choix était un peu inhabituel car la physiologie à Lyon était alors en ruine après une période qui aurait pu être brillante. Le Professeur Morat ancien interne voulait réunir les sciences cliniques et biologiques, mais il n’a rien fait pour cela. Son successeur, Maurice Doyon qui a failli découvrir avec Joanny Vial l’héparine, n’a pu poursuivre malheureusement pour des raisons de santé. C’est ainsi que la faculté a fait appel à un grand physiologiste venant d’Alger, le Professeur Henri Hermann.
Ce dernier, arrivé en 1933, a redressé en quelques années et d’une main de fer, la situation et redonné un lustre tout particulier à l’école de physiologie lyonnaise qui s’engagea principalement dans l’étude de la circulation et de la tension artérielle ainsi que du système sympathique sur un modèle original dit du « chien sans moelle ».
C’est dans ce laboratoire que Jean-François Cier, qui avait été nommé externe en 1934, prépare une thèse hâtivement soutenue en 1938, car les nuages s’accumulaient sur la frontière est. Il est évident qu’à cette date un jeune « santard » se devait d’être rapidement formé et diplômé et c’est ainsi que cinq ans après son arrivée, il quitte Lyon pour rejoindre le Val de Grâce comme médecin-lieutenant. C’est alors la guerre.
Fait prisonnier pendant la campagne de 1940, il est affecté à l’hôpital des prisonniers de guerre organisé à Nancy, l’hôpital Saint-Julien. Sous la direction d’une autorité allemande, cet hôpital est chargé de dispenser les soins aux militaires français des troupes coloniales. Ce jeune lieutenant de vingt-cinq ans, est nommé « médecin traitant » et se trouve projeté comme chef d’un hôpital avec une totale responsabilité médicale et chirurgicale. Il ne dispose alors que d’un bagage relativement modeste (trois ans d’externat et une année d’assistanat au Val de Grâce). J’ai souvent discuté avec lui de cet épisode et il ne m’a jamais fait état d’une quelconque hésitation ou d‘un quelconque doute. C’est bien là un de ses traits de caractère.
La guerre terminée, quand il revient à Lyon en 1945, affecté à l’hôpital Desgenettes, il est nommé médecin capitaine et retrouve en même temps le laboratoire de physiologie. Un choix s’ouvrait, difficile d’ailleurs, entre une carrière militaire dans une discipline chirurgicale, ou un cursus universitaire en physiologie. Le prestige d’Henri Hermann, devenu entre-temps doyen, l’a emporté. C’est ainsi que ma promotion fut la première à être prise en charge sur le plan physiologique par l’exceptionnel enseignant qu’était Jean-François Cier.
En effet, les qualités pédagogiques caractérisent son personnage. Au fil des années, elles se sont peu à peu confirmées et affinées. Il est nommé premier à l’agrégation de physiologie en 1952, concours qu’il avait abordé avec beaucoup de décontraction, fort d’une charge d’enseignement qu’il avait assumée à Dijon. Il devient très vite l’adjoint privilégié d’Henri Hermann. Cette complicité va se traduire par la suite dans la rédaction des traités qui ont constitué la base des connaissances en physiologie de plusieurs générations, non seulement nationales mais également au-delà de nos frontières. Réédités à quatre reprises, les quatre tomes du Précis de Physiologie, l’Hermann et Cier, constituent une véritable référence, certes un peu dépassée maintenant, mais qui a beaucoup marqué son époque. Si on voulait résumer son style, on dirait qu’il était directement issu de celui de Montesquieu : « pour écrire bien, il faut sauter les idées intermédiaires, assez pour ne pas être ennuyeux, mais pas trop pour ne pas être mal entendu ».
A partir de 1950, Jean-François Cier devient de facto , le patron indiscuté de cet ensemble, en raison des missions administratives qui retenaient loin du laboratoire le Doyen Hermann. Il choisit de garder l’orientation générale des recherches qui y sont menées avec la physiologie cardiaque, respiratoire et de l’exercice physique. Il dirige alors les thèses des élèves de l’Ecole du Service de Santé des Armées dont certains ont fait par la suite une carrière brillante, comme Roland Flandrois, entre autres professeurs de physiologie, ou dans l’armée comme René Henane.
Jean-François Cier accueille en outre de nombreux internes venant développer des travaux de chirurgie ou de médecine expérimentale dans les domaines de l’homéostasie du milieu intérieur, de la physiologie des vaisseaux ou du cœur. Il s’y ajoutait des expérimentations préliminaires sur les greffes d’organes et la conservation de ceux-ci après leur prélèvement. C’est ainsi que dans ce laboratoire, autour de lui, est née l’école lyonnaise de transplantation dont on connaît le brillant développement avec, entres autres, Jean-Michel Dubernard, Alain Sisteron, Philippe Mikaeloff, Georges Dureau.
Son intérêt personnel était orienté vers l’endocrinologie avec comme axe la mise au point de méthodes de dosages indispensables, à la fois pour l’expérimentation animale, mais aussi pour un transfert au diagnostic en clinique. Il ne faut pas oublier qu’en ce milieu du XXe siècle, on ne connaissait la structure que de deux hormones seulement (thyroxine et adrénaline) et que l’on ne disposait que de deux dosages biologiques : Ascheim-Zondek pour la grossesse et von Euler pour les catécholamines.
Nous avons ainsi vécu une période de quinze ans environ où s’affinaient les dosages biologiques peu sensibles certes, mais ayant une spécificité indiscutable. Dans le même temps, différentes collaborations avec des physico-chimistes, des immunologistes, faisaient naître des méthodes de haute sensibilité, mais dont la spécificité était, au moins au départ, entachée d’artifices. Ainsi, des équipes pluridisciplinaires ont travaillé avec succès, la main dans la main, sur les catécholamines avec Liliane Peyrin, sur les hormones antidiurétiques avec Claude Gharib, sur le système rénineangiotensine avec Jean Sassard. Mon équipe était plus engagée dans le domaine de la thyroïde avec les dosages de TSH, de TRH, du facteur LATS. De plus, l’activité clinique, de la plupart des collaborateurs leur permettait d’évaluer simultanément la valeur séméiologique des différents résultats et c’était un magnifique exemple de recherche clinique et d’intégration des sciences fondamentales à l’activité hospitalière quotidienne.
Ce sont ces stratégies généralistes qui valurent à Jean-François Cier son élection en 1964 à la présidence du conseil scientifique de l’INSERM, et sa présence dans les instances de la Fondation pour la Recherche Médicale.
Lorsqu’en 1963, le Doyen Hermann quitte ses fonctions décanales, Jean-François Cier est élu à son fauteuil. La campagne, fait inhabituel, a été menée par son patron et lui-même est resté en retrait. Ceci m’amène à conclure que Jean-François Cier, contrairement à ce que certains ont pensé, n’aimait pas le pouvoir en tant que tel. Il aimait diriger pour agir et une fois en fonction il le faisait très bien. Par contre, je puis témoigner que par la suite d’autres occasions se sont présentées et que, soucieux de préserver sa vie de famille et sa liberté, il n’a jamais voulu s’engager à nouveau dans cette voie.
En revanche, s’il n’aimait pas le pouvoir, il respectait l’autorité. La sienne était forte, sans besoin d’artéfacts. Elle était à la fois souriante, ferme et charismatique.
Cette mise en avant du respect de l’autorité, explique combien il a pu être traumatisé par le printemps 1968. Il ne tolérait pas que celui qui avait été élu par ses pairs, puisse être mis en cause par de tous jeunes étudiants qui abordaient à peine la carrière médicale et a fortiori universitaire. Permettez-moi une anecdote que je crois assez significative. Au milieu de l’agitation dans chacune des facultés, les réunions à Paris se multipliaient. Un matin, au moment de partir, le doyen Cier apprend que deux factions se disputaient physiquement l’accès au local réservé aux étudiants. Il descend, convoque le technicien, fait sous ses yeux murer la porte avant de sauter dans le train. J’hésite entre Salomon et Jules César, mais privilégie le général car :
V eni, vidi, vici est ce qui me paraît le plus illustratif.
Son passage au décanat fut court, mais malgré tout il fut suffisamment significatif pour que, par la suite, on parlât toujours du Doyen Cier et que ses prises de position, notamment au CNU, dont il présidait la 38e section, soient toujours écoutées avec beaucoup d’attention.
L’action la plus importante qu’il a menée pendant son décanat fut la mise en place du temps plein hospitalier et universitaire. C’est avec beaucoup de hauteur de vue, qu’avec Louis Veyret, directeur général des Hospices Civils de Lyon, il réduisit tous les obstacles qui pouvaient surgir. Ainsi, l’intégration hospitalo-universitaire s’est faite rapidement à Lyon et est devenue un véritable exemple de réussite au plan national. C’est aussi à ce moment que son activité administrative, forte et efficace, s’est engagée dans des missions d’expertise, diligentées soit par le ministère, soit par l’OMS. Que ce soit au Maghreb, au Liban, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, il en a rapporté toujours des analyses concises, précises et efficaces.
Selon la tradition lyonnaise, il a assumé en outre la responsabilité du Conseil d’Administration de l’École Rockefeller, d’infirmières et d’assistantes sociales et a dû faire face à de nombreuses difficultés.
En 1979, le Doyen Cier a été élu sans peine à un poste de titulaire de notre Compagnie. Tout au long des années de sa présence qui a cessé il n’y a que peu de temps, Jean-François Cier a été toujours très actif, incisif et motivé.
Membre du conseil d’administration à deux reprises, il a fermement bataillé, non sans réveiller quelques antagonismes vigoureux, pour accroître la présence des provinciaux au sein de l’Académie. Ceci s’est fait peu à peu, avec le glissement d’un certain nombre de postes parisiens vers la section des membres non résidents dans laquelle il pilotait d’ailleurs le « club des lyonnais ». De la même façon, il a insisté sur la nécessité absolue de compenser les charges financières des déplacements. Là encore, tout n’a pas été simple, et le reste…mais bis repetita non placent .
En commissions, le Doyen Cier était présent et avec une dialectique élégante et habile, il défendait avec brio des thèses dont les prémices étaient parfois un peu fragiles, mais auxquelles il était très attaché.
Enfin, en séance plénière, comme dans toutes les assemblées où il était présent, chacune de ses interventions était écoutée avec beaucoup d’attention. Assis à gauche de cette assemblée, légèrement penché en avant, il était très attentif. Dès le terme de la présentation et les derniers applaudissements, sa main se levait. Je le vois encore, faisant un geste assez impératif pour demander la parole. La question jaillissait, toujours courte, pertinente, parfois déstabilisante, mais en général génératrice d’une réponse qui faisait progresser la solution.
En 1983, le Professeur Cier est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il peut alors se consacrer aux Académies dont il était membre dont à Lyon, l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts. Surtout il pouvait satisfaire ses passions.
Jean-François Cier était un passionné de voyages qu’il organisait avec beaucoup de soin, parfois même avec un peu d’inconscience. Je fais allusion au dernier d’entre eux où il a entraîné au fin fond de la Namibie, plusieurs couples d’octogénaires qu’il a amenés à vivre sous la tente. Ce n’était peut-être pas l’idéal à ces âges.
Dans cette dynamique de voyages et de contacts, il avait dans la personne de son épouse, Renée Arnaud, médecin elle aussi, une complicité tout à fait exceptionnelle.
Elle lui a apporté une aide très précieuse, levant les soucis quotidiens et mettant elle-même avec beaucoup d’ardeur, la main à la pâte. Affecté d’une pathologie lourde, elle a préféré sacrifier tout l’équilibre de ses dernières années de vie, pour l’entourer, l’accompagner, car elle sentait combien sa présence lui était indispensable. Je voudrais dire l’affection respectueuse que je portais à Renée Cier et l’admiration que j’ai toujours eue pour elle.
Il n’y avait pas que les voyages lointains, il y avait aussi les plaisirs, la chasse comme son père ou la pêche. Il retenait d’un voyage qu’il avait fait au Canada chez notre grand confrère en physiologie Claude Fortier, surtout l’initiation à la pêche au gros que celui-ci lui avait fait découvrir et qu’il devait prolonger par la suite en famille dans les mers chaudes de l’hémisphère sud.
Il avait aussi un goût prononcé pour l’activité physique de terrain. Il aimait travailler de ses mains, privilégiant souvent l’action sur la méditation. Dans le petit village de Charsac, au nord de la Drôme, il menait un peu la vie de gentleman farmer, taillant les arbres, soignant ses abeilles. C’est là qu’il a été frappé d’un accident vasculaire dont l’évolution a transformé douloureusement ses dernières années de vie.
C’était surtout un passionné de montagne. Beaucoup de nos amis lyonnais, dont Alain Bouchet que je remercie pour ses confidences, ont participé avec lui à des courses en montagne. Celui-ci se souvient de l’enthousiasme qu’il mettait et de la méticulosité qu’il apportait à leur préparation. Il avait toujours au moment voulu le matériel adéquat lui permettant de répondre aux situations difficiles. Il était extrêmement fier d’avoir signé des publications dans des revues spécialisées pour rapporter la découverte de voies d’accès nouvelles.
En conclusion, Jean-François Cier, ce personnage hors du commun dont la carrière fut exceptionnellement féconde, était le modèle d’un universitaire. Un universitaire, c’est un homme qui va l’essentiel, un homme qui sait transmettre aux jeunes ses connaissances et son expérience, un homme qui sait éduquer et apporter des valeurs.
Le Doyen Jean-François Cier était un universitaire, mais c’était réellement un très grand universitaire.
Je termine en exprimant à tous les siens l’expression de notre compassion attristée.