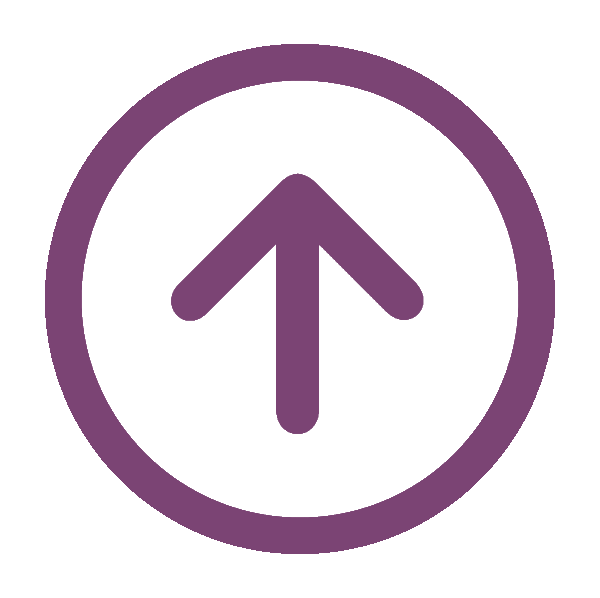Résumé
Peut-on parler de douleur psychique ? Le psychiatre est confronté à toutes sortes d’états émotionnels, de la tristesse à l’exaltation de l’humeur, et le terme de douleur morale est couramment utilisé dans la description d’un épisode dépressif à caractéristiques mélancoliques. Mais est-il possible de caractériser cette douleur sans lésion visible ni délimitation corporelle ? Nous montrons qu’il est légitime de parler de douleur psychique, à la fois d’un point de vue physiopathologique, d’un point de vue pronostique et d’un point de vue thérapeutique. Les neurosciences cognitives permettent en effet de montrer que les structures cérébrales impliquées dans la représentation de la douleur physique sont également activées par la douleur psychique. L’importance de la douleur psychique est par ailleurs associée au risque suicidaire. Enfin, les antalgiques, notamment les opioïdes et la kétamine, modulent la douleur psychique et peuvent être utilisés dans cette perspective.
Summary
The psychiatrist is confronted by a variety of emotional states, ranging from sadness to exaltation. The term ‘‘ psychache ’’ has been used to describe depression with melancholic features. But can such mental pain be defined without reference to visible lesions or precise physical symptoms? We report pathophysiological evidence supporting this concept and show that it has implications for both treatment and prognosis. Cognitive studies have shown that the neurological substrate of physical pain is also activated by mental pain. Mental pain is associated with a risk of suicide and can be improved by analgesics, including opiates and ketamine.
INTRODUCTION
L’exercice de la médecine nous apprend qu’un diagnostic doit avoir un sens. Au-delà d’un nom laissé à la postérité, tel ou tel symptôme, tel ou tel syndrome ou même maladie ne peuvent être légitimement évoqués que si les identifier modifie la compréhension de ce que traverse le patient ou sa prise en charge. Autrement dit nous ne devrions recourir à un diagnostic que s’il correspond à une physiopathologie spécifique, ou s’il modifie la prise en charge thérapeutique ou du moins le pronostic.
Qu’en est-il de la douleur psychique ? Tristesse, sentiment de vide, souffrance, perte d’espoir, déréliction, affliction, amertume, blessure, brûlure, chagrin, déchirement, désolation, deuil, élancement, enfer, épreuve, peine, repentir, tiraillement, torture, tourment, détresse, dévastation, cauchemard, la liste pourrait s’allonger sans fin. Au sein de cette litanie, chacun des termes désigne quelque chose de sensiblement différent dans l’éventail des expériences émotionnelles que traverse le patient déprimé. Notre nosographie moderne impose de regrouper ces symptômes en nombre suffisant, associés à des perturbations physiologiques (sommeil, appétit) et évoluant pendant une durée suffisante (au moins quinze jours) pour porter le diagnostic d’épisode dépressif caractérisé. Mais peut-on tenter de circonscrire au sein de cette diversité d’expressions cliniques des entités dont la physiopathologie serait mieux connue ?
Ainsi l’anhédonie, la perte de plaisir, a fait l’objet d’une réflexion spécifique, notamment dans ses liens avec la transmission dopaminergique [1, 2]. Ce faisant, les liens entre ralentissement psychomoteur dans la dépression et syndromes neurologiques peuvent être interrogés. Y a-t-il quelque chose de commun entre la dépression et la perte d’auto-activation psychique décrite par Laplane après des lésions bipallidales [3], cet étonnant contraste entre une interaction possible et la perte totale d’initiative, ne serait-ce que l’initiative de penser ? Peut-on rapprocher le ralentissement psychomoteur dans la dépression des symptômes moteurs identifiés au sein du syndrome parkinsonien, tentative ou tentation que l’école de la Salpêtrière a bien connue [4] ? Cette piste de réflexion et de recherche est assurément prometteuse, la neuro-imagerie permettant désormais d’étudier précisément la dynamique des structures cérébrales dopaminergiques.
Pour autant, la dépression peut-elle se résumer à cette perte d’élan vital parallè- lement à un déficit dopaminergique ? Ce serait mettre de côté bon nombre des affects qui animent le patient déprimé. L’anxiété, voire l’angoisse, peuvent d’ailleurs conduire à des états d’agitation, dans le cadre d’une mélancolie anxieuse, où la sémiologie du ralentissement psychomoteur est remplacée par une agitation anxieuse. À l’inverse, les formes de dépression marquées par l’apathie, l’hypersomnie plutôt que l’insomnie, l’hyperphagie plutôt que la perte d’appétit sont précisément qualifiées d’atypiques [5]. Ce diagnostic de dépression atypique nous rappelle que l’expression de dépression est habituellement différente. Dans le registre des perturbations physiologiques (sommeil appétit), mais aussi dans celui des affects. Car la dépression impose de considérer les affects qui l’animent. Tristesse, vague à l’âme, nostalgie, sentiment de perte : aucun de ces affects ne peut résumer à lui seul l’expérience émotionnelle du patient déprimé. Mais une tonalité générale se dégage, un climat menaçant se précise : il s’agit d’affects douloureux. Dès lors, il devient nécessaire de préciser ce que nous pourrions désigner sous le terme de douleur psychique.
Quelle est la physiopathologie de la douleur psychique ?
Une première piste pour s’autoriser à évoquer une douleur psychique consiste à en identifier la physiopathologie. Nous pouvons pour ce faire partir de la douleur physique. La question de ses déterminants périphériques (la cascade de phénomènes conduisant d’une lésion corporelle à un signal douloureux transmis par le système nerveux périphérique jusqu’à la moelle épinière et de la moelle épinière au cerveau) fait l’objet d’intenses recherches mais n’a probablement pas de lien avec notre démarche. En revanche la mécanique cérébrale sous-tendant l’expérience douloureuse nous intéresse au plus haut point. Les neurosciences cognitives permettent de concilier d’une part une démarche cognitive (l’élaboration d’un modèle rendant compte de propriétés cognitives identifiées, et la construction de paradigmes de psychologie expérimentale permettant de tester ce modèle) et d’autre part les apports des techniques de neuro-imagerie. Ainsi un réseau d’aires cérébrales soustendant l’expérience douloureuse a pu être caractérisé : ce réseau associe le cortex somatosensoriel, l’insula et le cortex cingulaire dorsal [6, 7]. Toutes sortes de dispositifs expérimentaux peuvent être utilisés, selon le mécanisme générant une douleur (thermique, piqure, compression, etc.), et aboutissent au même constat de l’activation de ce réseau contemporain de l’expérience douloureuse.
Partant de ce constat, quelle démarche pourrait nous permettre d’élaborer un concept de douleur psychique ? Une première piste serait de lier l’activation de ce réseau cérébral de la douleur aux expériences que nous voudrions précisément désigner sous le terme de douleur psychique. Mettre en évidence l’activation de ce réseau contemporaine d’une situation de douleur psychique et en l’absence de douleur physique appuierait notre hypothèse. Comme nous allons le voir, plusieurs paradigmes expérimentaux répondent à cet objectif.
Empathie à la douleur
Seuls nos propres états mentaux nous sont directement accessibles et nous sommes obligés d’inférer ceux des autres par leur comportement. Il existe donc une asy- métrie entre notre connaissance de nous-mêmes et notre connaissance d’autrui.
L’empathie, aptitude à se mettre à la place d’autrui, à ressentir ce qu’il ressent, comblerait en partie ce fossé en permettant un accès à l’émotion de l’autre. Cette faculté est essentielle au sein des relations interhumaines. Elle est à la source du raisonnement social et des comportements moraux. Jean Decety, professeur de Neurosciences sociales à l’Université de Washington, définit l’empathie comme une simulation mentale de la subjectivité d’autrui [8]. La douleur est l’émotion ayant fait l’objet des travaux les plus nombreux sur l’empathie [9]. Comme pour les autres émotions, l’observation de la douleur chez autrui recrute en partie les mêmes aires cérébrales que l’expérience douloureuse directe. Certaines données neurophysiologiques récentes ont montré que l’expérience douloureuse d’autrui peut également être « incarnée » par l’observateur sur un mode non seulement affectif mais aussi sensori-moteur [10]. Par ailleurs, l’activation de l’insula et du cortex cingulaire antérieur induite par la perception de visages exprimant la douleur est corrélée avec l’estimation que l’observateur fait de l’intensité de la douleur d’autrui tandis que le degré d’activation du cortex frontal inférieur gauche et de l’insula est lié à son degré d’empathie [11]. La vue de mains ou de pieds dans des situations douloureuses entraîne elle aussi l’activation de l’insula et du cortex cingulaire antérieur, qui est là encore corrélée à l’estimation de l’intensité de la douleur supposée ressentie par autrui [12-14]. Selon certains auteurs, ces activations cérébrales du réseau de la douleur lors de l’observation de la douleur d’autrui pourraient sous-tendre un processus de résonance émotionnelle automatique entre l’observateur et celui qui souffre, permettant ainsi une compréhension immédiate et intuitive de la douleur d’autrui.
Nous disposons donc au travers de ces paradigmes d’empathie à la douleur d’un moyen de générer chez un sujet la signature cérébrale de la douleur sans aucune stimulation douloureuse directe. Qui plus est il est possible d’activer ce réseau cérébral de la douleur chez des patients n’ayant jamais ressenti de douleur physique.
Nicolas Danziger, lauréat du prix Prosper Weil de l’Académie nationale de médecine en 2009, s’est ainsi intéressé à l’influence que pourrait avoir la propre sensibilité à la douleur de l’observateur sur sa perception de la douleur d’autrui [15]. Il a travaillé à cette fin avec des patients insensibles congénitaux à la douleur (ICD).
Cette population clinique rare permet de tester l’empathie à la douleur chez des patients qui n’ont jamais éprouvé de douleur physique, donc dépourvus de capacité de résonance émotionnelle immédiate avec la douleur d’autrui. Le savoir sémantique sur la douleur des patients ICD (évaluer la douleur de quelqu’un lors de situations racontées verbalement) ne différait pas de la population témoin. Les patients arrivaient également aussi bien que les témoins à estimer l’intensité de la douleur d’autrui à partir d’expressions faciales En revanche, lorsqu’il s’agissait d’évaluer la douleur d’autrui lors de courtes vidéos, en l’absence d’indices émotionnels ou comportementaux (mimiques, cris/pleurs), les patients sous-estimaient globalement la douleur d’autrui. De plus, le jugement de la douleur des patients ICD (sur les expressions faciales douloureuses et les séquences vidéo) était corrélé à leurs capacités d’empathie (évaluée par des échelles validées), ce qui n’était pas le cas chez les témoins. Ces résultats suggèrent que l’expérience personnelle de la douleur n’est pas indispensable pour percevoir et ressentir de l’empathie vis-à-vis de la douleur d’autrui. Cependant, en l’absence des mécanismes de résonance façonnés par des expériences douloureuses antérieures, l’estimation de la douleur d’autrui est très difficile lorsqu’aucun indice émotionnel n’est disponible, sauf si l’observateur est doué d’assez d’empathie pour compenser son absence d’expérience personnelle.
Quelles sont les bases cérébrales de cette inférence de l’état émotionnel d’autrui sans recours possible à la résonance immédiate ? En 2009, Nicolas Danziger et coll. ont utilisé l’IRM pour étudier chez ces mêmes sujets les réponses cérébrales à la vue de photographies de parties du corps dans diverses situations douloureuses ou d’expressions faciales de douleur [16]. Etonnamment, le réseau cérébral de la douleur s’activait chez les patients ICD malgré l’absence d’expérience douloureuse antérieure. Chez les patients, le degré d’activation des régions médianes (cortex préfrontal ventromédian et cortex cingulaire postérieur) était spécifiquement corrélé au score d’empathie : plus les patients étaient dotés de capacités d’empathie élevées, plus ces régions de leur cerveau se trouvaient activées à la vue de la douleur d’autrui. En revanche, aucune corrélation entre le score d’empathie et l’activité cérébrale n’était observée dans le groupe témoins dans les mêmes conditions.
L’ensemble de ces résultats suggère que les patients ICD, privés du mécanisme de résonance automatique faisant appel aux expériences douloureuses antérieures personnelles, recourent, lorsqu’ils doivent imaginer la douleur d’autrui, à des processus plus complexes d’inférence émotionnelle associés à la mise en jeu des structures médianes et dont le recrutement est — à la différence de ce que l’on observe chez les sujets sains — étroitement dépendant de leur capacités d’empathie.
L’empathie à la douleur permet donc non seulement d’activer le réseau cérébral sous-tendant l’expérience douloureuse, mais il est également possible de différencier une activation automatique, en résonance, de ce réseau de son activation au gré d’un effort actif de représentation de l’expérience subjective d’autrui. Beaucoup reste à faire pour rapprocher ces données de l’expérience du patient déprimé. Quel serait le profil d’activation cérébrale chez un tel patient dans ce paradigme expérimental ?
Pourrait-on mettre en évidence une plus grande sensibilité de ce réseau face à l’expérience douloureuse d’autrui ? Observera-t-on également une activation des structures préfrontales médianes, traduisant la façon dont le patient s’attribue activement cette expérience douloureuse ?
Douleur liée à une perte
Une seconde piste pour générer une douleur et en explorer les bases cérébrales sans éprouver de douleur physique consiste à réactiver chez un sujet un sentiment de perte. La perte d’un être cher, le deuil, est ainsi une situation pour laquelle il est aisé de se représenter la douleur ressentie. Nous retrouvons ici la diversité des états émotionnels que nous évoquions pour décrire l’expérience affective du patient déprimé. Il est bien entendu question de tristesse notamment, mais nous continuerons ici à tenter de dégager des affects d’une autre nature : ceux qui ont trait à la douleur.
Ainsi une étude de neuro-imagerie menée chez des sujets membres d’une association de parentes de patientes décédées d’un cancer du sein illustre bien la mobilisation du réseau de la douleur : la perception de photographies de la patiente défunte par rapport à des photographies neutres active chez la mère ou la sœur de la patiente le cortex cingulaire dorsal, l’insula et la substance grise péri-acqueducale [17]. Chez les parentes faisant un deuil pathologique, on retrouve également une activation plus forte du nucleus accumbens, structure impliquée dans la motivation (dans les addictions par exemple), comme si les parentes gardaient une dépendance trop forte à la patiente décédée.
Il est possible d’utiliser des paradigmes expérimentaux beaucoup plus simples pour induire ainsi une douleur liée à une perte. L’expérience affective liée à une perte financière, depuis la prise de conscience d’une dépense inappropriée jusqu’à l’effondrement des cours pour un courtier, n’est pas étrangère à la question de la douleur.
Petrovic et coll. , ont ainsi enregistré l’activité cérébrale de sujets volontaires soumis à des pertes d’argent au gré d’un jeu de hasard très simple : ces pertes d’argent sont considérées comme désagréables par les sujets (l’intensité de cette réaction est évaluée sur une échelle visuelle analogique) et s’accompagnent de l’activation du cortex cingulaire dorsal et de l’insula [18]. Qui plus est, l’administration versus placebo d’un antagoniste du système opioïde, la naloxone, entraîne une majoration de la cotation du caractère désagréable de cette perte parallèlement à une augmentation de l’activité du cortex cingulaire et de l’insula.
Il est donc possible de montrer que l’expérience douloureuse associée à une perte non seulement met en jeu les mêmes structures cérébrales que la douleur physique, mais est modulée comme cette dernière par le système opioïde.
Douleur liée à l’exclusion sociale
L’identification de mécanismes physiopathologiques sous-tendant telle ou telle propriété doit toujours être confrontée à une réflexion sur les bases phylogénétiques cette propriété. Quels liens la douleur pourrait ainsi avoir avec la survie ? La réponse paraît évidente : ne pas ressentir une douleur, c’est s’exposer à de graves blessures et donc mettre en danger sa vie. En d’autres termes la douleur serait un signal utile à la survie, en permettant d’éviter ou de limiter d’éventuelles lésions corporelles. Mais quel pourrait être alors le rôle de la douleur psychique ? Une première hypothèse consiste à la considérer comme un simple recyclage de la douleur physique, cette fois à des fins sociales. On imagine l’impact social que la douleur psychique peut avoir, sans pour autant, à ce stade, faire de lien direct avec la survie : cohésion sociale pour l’empathie à la douleur par exemple, ou encore pondération affective des choix complexes qu’un courtier doit faire sur le marché non seulement pour faire des bénéfices mais aussi pour limiter ses pertes. Une analogie est possible avec un tout autre champ des neurosciences cognitives, la lecture. Puisque l’écriture est une invention toute récente, de l’ordre de cinq mille années, aucune pression phylogéné- tique ne peut avoir sélectionné des structures cérébrales dédiées à la lecture. Et pourtant nous sommes experts dans cette procédure complexe qu’est la lecture d’un mot, l’identifiant en moins de 500 ms. L’implication causale d’une région bien définie du cortex occipito-temporal gauche dans cette expertise a également été démontrée [19]. Pour rendre compte de cette expertise, Stanislas Dehaene et Laurent Cohen font l’hypothèse d’un recyclage de structures dédiées à l’expertise visuelle et sélectionnées par l’évolution [20]. Ainsi la structure cérébrale symétrique dans l’hémisphère droit de celle nécessaire à la lecture dans l’hémisphère gauche est impliquée dans la reconnaissance des visages : on imagine aisément comment l’expertise dans la reconnaissance de visages, et des émotions qu’ils expriment, a pu contribuer à la survie de nos aïeux. L’apprentissage de la lecture dans l’enfance permettrait de mettre à profit de telles structures occipito-temporales impliquées plus généralement dans les mécanismes d’abstraction progressive à partir d’un stimulus visuel.
Il est possible de faire une hypothèse similaire concernant la douleur psychique, en la découplant donc de la question de la survie de l’espèce au gré de cette hypothèse générale du recyclage. Pourtant les observations faites concernant l’empathie à la douleur pouvaient déjà nous donner l’intuition d’un impact plus important : ses potentiels effets sur la cohésion d’un groupe social pourraient bien ne pas être étrangers à la survie. Eisenberger et coll. , montrent ainsi que l’exclusion sociale, dont on imagine les conséquences sur la survie, est à l’origine d’une forme de douleur [21]. Des sujets volontaires dont on enregistre l’activité cérébrale en IRM fonctionnelle participent à un jeu avec deux autres joueurs consistant à s’envoyer une balle. Sans qu’ils en aient été avertis, ils se trouvent exclus de la partie, les deux autres joueurs n’échangeant la balle qu’entre eux. On observe alors l’activation du cortex cingulaire dorsal, activation corrélée à un score de détresse sociale ressentie les sujets. Le polymorphisme de gène codant pour le récepteur opioïde Mu module cette activation, démontrant à nouveau l’implication du système opioïde dans la douleur psychique [22]. Dans la continuité de ces travaux, Naomi Eisenberger et Matthew Lieberman ont exploré les liens entre douleur physique et douleur sociale [23], montrant combien nombreux sont les recoupements.
Il est possible d’aller plus loin encore, en caractérisant le comportement des nouveau-nés lors d’une séparation. La séparation précoce des souriceaux de leur mère entraîne une détresse marquée par des vocalisations et autres comportements d’appel et de recherche de la mère. Des souriceaux dont le gène codant pour le récepteur opioïde Mu a été inactivé ne présentent pas ces comportements d’attachement [24]. On imagine aisément l’impact d’un tel déficit sur la survie. La douleur psychique n’est donc pas le résultat d’un simple recyclage de la douleur corporel dans le champ social : ce recyclage participe directement à la survie et a donc pu être également sélectionné par l’évolution [25].
Au gré de cette exploration des bases cérébrales de l’empathie pour la douleur d’autrui, de la douleur ressentie lors d’une perte et enfin de la douleur ressentie lors d’une situation d’exclusion sociale (y compris lors d’une séparation précoce du nouveau-né de sa mère), nous avons pu caractériser une modalité psychique de douleur. Nicolas Danziger se livre, dans son livre à venir aux éditions Odile Jacob, à une passionnante exploration de ce champ dont nous n’avons pu ici qu’esquisser les contours. Dans notre démarche de psychiatre, quel usage pouvons-nous en faire d’emblée ? Au-delà de la physiopathologie, répondons-nous à l’impératif énoncé dans notre introduction d’un impact nécessaire sur le pronostic et ou le traitement pour qualifier un symptôme ?
La douleur psychique détermine-t-elle le pronostic ?
L’intuition s’impose : si la douleur psychique est une dimension de la dépression et si le passage à l’acte suicidaire est lié à l’intensité de la dépression, alors la douleur psychique pourrait bien être un facteur précipitant dans ce passage à l’acte. Encore faut-il pouvoir mesurer cette dimension. Les paradigmes expérimentaux associés à l’imagerie cérébrale décrits précédemment sont extrêmement prometteurs dans cette perspective. Mais des procédures plus simples peuvent être utilisées. Ainsi une équipe de Montpellier spécialisée dans l’exploration des conduites suicidaires, a utilisé une simple échelle visuelle analogique, classique mesure de la douleur physique mais ici utilisée pour mesurer la douleur psychique. Les patients déprimés ayant fait une tentative de suicide ont des scores de douleur psychique supérieurs à ceux de patients déprimés sans conduite suicidaire [26].
Cette étude nécessite bien sûr d’être affinée, en mettant notamment à profit les outils des neurosciences cognitives. Montrer un simple lien entre souffrance au sens large et suicide peut en première lecture paraître trivial. Sauf à considérer que les circuits sous-tendant cette dimension sont spécifiques et nécessitent donc une intervention spécifique. Il est ainsi probable que les anxiolytiques n’agissent pas sur cette dimension. Définir la douleur psychique comme symptôme modifie-t-il donc la démarche thérapeutique ?
La douleur psychique détermine-t-elle le traitement ?
Le délai d’action des antidépresseurs étant habituellement de trois à six semaines, la prise en charge d’un patient déprimé impose dans les formes sévères un traitement symptomatique. Les anxiolytiques les plus couramment utilisés, les benzodiazépines, présentent les risques habituels de cette classe médicamenteuse, notamment le risque de dépendance. Mais leur potentiel désinhibiteur interroge également quant au risque suicidaire. Le recours à un traitement neuroleptique sédatif est donc fréquent, notamment dans le cadre hospitalier. Ces traitements auraient-ils un potentiel antalgique ?
L’effet myorelaxant des benzodiazépines ainsi que les effets directs de certaines d’entre elles sur les douleurs neurogènes sont bien connus. Par ailleurs l’utilisation initiale des neuroleptiques en anesthésiologie et l’effet d’indifférence affective qu’ils induisent illustrent les liens que cette classe pourrait bien avoir avec l’expérience douloureuse. On pourrait également citer les propriétés antalgiques de certains neuroleptiques, tels que la lévomépromazine. Pour autant, il ne nous semble pas que ces effets antalgiques ou d’allure antalgique soient suffisamment caractérisés et importants au regard de l’effet tranquillisant, au premier plan des effets des benzodiazépines et des neuroleptiques, pour que ces molécules soient maniées avec cet objectif précis. En revanche certaines équipes, dont la nôtre, font un choix beaucoup plus explicite en utilisant les morphiniques majeurs pour apaiser les patients pré- sentant un épisode dépressif majeur mélancolique. Si les effets anxiolytiques et sédatifs des morphiniques sont également bien connus, le lien direct avec l’effet antalgique est ici plus évident. Ainsi nous souvenons nous de ce patient bipolaire médecin qui lors de ses épisodes mélancoliques demandait avec une insistance toute légitime d’être soulagé par un « antalgique psychique », en l’occurrence le laudanum, seul traitement l’apaisant dans l’attente des bénéfices du traitement antidépresseur.
Quant au traitement antidépresseur, une molécule a fait récemment son apparition dans l’arsenal thérapeutique en faisant le lien entre effet antalgique et effet antidé- presseur, la kétamine. Cet antagoniste des récepteurs NMDA au glutamate est utilisé comme anesthésiant, notamment en pédiatrie, et de plus en plus souvent comme antalgique [27]. Récemment son efficacité comme antidépresseur a été démontrée par une étude en double aveugle contre placebo [28]. Cette efficacité antidépressive ouvre de nouvelles perspectives pour l’innovation thérapeutique : la voie glutamatergique fait l’objet d’un intérêt renouvelé dans la recherche de nouveaux antidépresseurs [29], l’efficacité de la kétamine passant notamment par la libération secondaire de glutamate et son action sur les récepteurs AMPA [30]. Mais au-delà de ces effets glutamatergiques, il est intéressant d’explorer les effets de la kétamine à l’échelle des structures cérébrales classiquement impliquées dans la dépression. Ainsi le cortex cingulaire antérieur semble jouer un rôle important, tant du point de vue des facteurs prédictifs de la réponse à la kétamine [31] que des effets directs de la kétamine [32]. La kétamine entraîne en effet une désactivation du cortex cingulaire subgénual, une région dont la stimulation par des électrodes intracéré- brales réduit les symptômes dépressifs dans certains cas de dépression résistante [33], et une activation du cortex cingulaire dorsal, qui fait partie du réseau cérébral de la douleur. L’effet immédiat est la réduction de l’idéation suicidaire [34], parallèlement à l’amélioration de l’humeur. On sait que la kétamine augmente également le taux de dopamine dans le striatum [35], notamment lors de l’administration conjointe d’amphétamines [36, 37]. De sorte qu’il est tentant au gré de l’efficacité de la kétamine de faire un lien entre les deux aspects majeurs de la dépression que nous avons évoqués en introduction : l’anhédonie et le ralentissement psychomoteur d’une part, et la douleur psychique d’autre part. La kétamine agirait directement sur la douleur psychique et indirectement sur l’hypodopaminergie qui sous-tend l’anhé- donie et le ralentissement psychomoteur, rendant compte de son efficacité antidépressive spectaculaire et immédiate.
CONCLUSION
Plutôt que d’évoquer les effets d’un antalgique, la kétamine, sur la douleur psychique, nous aurions pu évoquer les effets bénéfiques des antidépresseurs sur les douleurs corporelles. Ce faisant, c’est une tout autre réflexion que nous aurions développé, concernant les liens entre douleurs physiques et dépression. On sait ainsi que la prévalence d’épisodes dépressifs chez les patients souffrant de douleurs chroniques est importante, que ces douleurs peuvent « masquer » un épisode dépressif caractérisé, ou encore que les troubles musculo-squelettiques ou la fibromyalgie, troubles dont l’incidence va croissante, semblent bien souvent liés à des éléments de nature psychique. Nous avons décidé de faire le chemin inverse, en cherchant à caractériser une douleur de nature psychique plutôt que d’étudier les liens entre douleur corporelle et psychisme. Cette méthode nous semble davantage en accord avec notre démarche de psychiatre : sans bien sûr négliger l’importance des phénomènes corporels, qui d’ailleurs sont partie intégrante de la sémiologie psychiatrique, le psychiatre s’intéresse avant tout aux contenus psychiques auxquels le patient lui permet d’accéder, contenus dont la douleur psychique ferait partie.
Pour nous autoriser à désigner ainsi une douleur de nature psychique, nous avons montré que cette dernière ne respecte pas seulement l’une des trois conditions nous semblant nécessaires pour caractériser un symptôme mais les trois conditions :
reposant sur une physiopathologie spécifique, dont les contours se précisent grâce aux neurosciences cognitives, elle influence à la fois le pronostic et la prise en charge thérapeutique.
BIBLIOGRAPHIE [1] Stein D.J. — Depression, anhedonia, and psychomotor symptoms: the role of dopaminergic neurocircuitry. CNS Spectr. , 2008, 13 (7), p. 561-5.
[2] Nestler E.J., Carlezon W.A. JR. — The mesolimbic dopamine reward circuit in depression.
Biol. Psychiatry , 2006, 59 (12), p. 1151-9.
[3] Laplane D. et al. — [Loss of psychic self-activation. Compulsive activity of obsessional type.
Bilateral lenticular lesion (author’s transl)].
Rev. Neurol. (Paris) , 1982, 138 (2), p. 137-41.
[4] Widlocher D.J. — Psychomotor retardation: clinical, theoretical, and psychometric aspects.
Psychiatr. Clin. North Am. , 1983, 6 (1) , p. 27-40.
[5] Pae C.U. et al. — Atypical depression: a comprehensive review. CNS Drugs , 2009, 23 (12) , p. 1023-37.
[6] Wiech K., Ploner M., Tracey I. — Neurocognitive aspects of pain perception. Trends Cogn.
Sci. , 2008, 12 (8) , p. 306-13.
[7] Tracey I., Mantyh P.W. — The cerebral signature for pain perception and its modulation.
Neuron. , 2007, 55 (3) , p. 377-91.
[8] Decety J. — L’empathie est-elle une simulation mentale de la subjectivité d’autrui ? in
L’empa- thie . 2004, Odile Jacob: Paris.
[9] De Vignemont F., Singer T. — The empathic brain: how, when and why?
Trends Cogn. Sci. , 2006, 10 (10) , p. 435-41.
[10] Avenanti A. et al . — Transcranial magnetic stimulation highlights the sensorimotor side of empathy for pain.
Nat. Neurosci. , 2005, 8 (7) , p. 955-60.
[11] Saarela M.V. et al . — The compassionate brain: humans detect intensity of pain from another’s face.
Cereb. Cortex , 2007, 17 (1) , p. 230-7.
[12] Jackson P.L., Meltzoff A.N., Decety J. — How do we perceive the pain of others? A window into the neural processes involved in empathy. Neuroimage , 2005, 24 (3), p. 771-9.
[13] Jackson P.L. et al . — Empathy examined through the neural mechanisms involved in imagining how I feel versus how you feel pain.
Neuropsychologia , 2006, 44 (5) , p. 752-61.
[14] Morrison I. et al. — Vicarious responses to pain in anterior cingulate cortex: is empathy a multisensory issue? Cogn. Affect Behav. Neurosci. , 2004, 4 (2) , p. 270-8.
[15] Danziger N., Prkachin K.M., Willer J.C. — Is pain the price of empathy? The perception of others’ pain in patients with congenital insensitivity to pain. Brain , 2006, 129 (Pt 9), p. 2494-507.
[16] Danziger N., Faillenot I., Peyron R. — Can we share a pain we never felt? Neural correlates of empathy in patients with congenital insensitivity to pain. Neuron. , 2009, 61 , p. 203-212.
[17] O’Connor M.F. et al . — Craving love? Enduring grief activates brain’s reward center. Neuroi- mage , 2008, 42 (2) , p. 969-72.
[18] Petrovic P. et al. — Blocking central opiate function modulates hedonic impact and anterior cingulate response to rewards and losses.
J. Neurosci. , 2008, 28 (42) , p. 10509-16.
[19] Gaillard R. et al . — Direct intracranial, fMRI and lesion evidence for the causal role of left inferotemporal cortex in reading.
Neuron. , 2006, 50 (April 20), p. 191-204.
[20] Dehaene S., Cohen L. — Cultural recycling of cortical maps.
Neuron , 2007, 56 (2) , p. 384-98.
[21] Eisenberger N.I., Lieberman M.D., Williams K.D. — Does rejection hurt? An FMRI study of social exclusion. Science , 2003, 302 (5643) , p. 290-2.
[22] Way B.M., Taylor S.E., Eisenberger N.I. — Variation in the mu-opioid receptor gene (OPRM1) is associated with dispositional and neural sensitivity to social rejection. Proc. Natl.
Acad. Sci. U S A , 2009, 106 (35) , p. 15079-84.
[23] Eisenberger N.I., Lieberman M.D. — Why rejection hurts: a common neural alarm system for physical and social pain. Trends Cogn. Sci. , 2004, 8 (7) , p. 294-300.
[24] Moles A., Kieffer B.L., D’Amato F. — Deficit in attachment behavior in mice lacking the mu-opioid receptor gene. Science , 2004, 304 (5679) , p. 1983-6.
[25] Panksepp J. — Neuroscience. Feeling the pain of social loss.
Science , 2003, 302 (5643), p. 237-9.
[26] Olie E. et al . — Higher psychological pain during a major depressive episode may be a factor of vulnerability to suicidal ideation and act.
J. Affect Disord ., 120 (1-3) , p. 226-30.
[27] Bell R.F. — Ketamine for chronic non-cancer pain.
Pain , 2009, 141 (3), p. 210-4.
[28] Zarate C.A. JR. et al . — A randomized trial of an N-methyl-D-aspartate antagonist in treatment-resistant major depression.
Arch. Gen. Psychiatry , 2006 , 63 (8) , p. 856-64.
[29] Machado-Vieira R., Manji H.K., Zarate C.A. — The role of the tripartite glutamatergic synapse in the pathophysiology and therapeutics of mood disorders. Neuroscientist , 2009, 15 (5) , p. 525-39.
[30] Maeng. S. et al. — Cellular mechanisms underlying the antidepressant effects of ketamine: role of alpha-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid receptors.
Biol. Psychiatry , 2008, 63 (4) , p. 349-52.
[31] Salvadore G. et al. — Increased anterior cingulate cortical activity in response to fearful faces:
a neurophysiological biomarker that predicts rapid antidepressant response to ketamine.
Biol.
Psychiatry , 2009, 65 (4) , p. 289-95.
[32] Deakin J.F. et al . — Glutamate and the neural basis of the subjective effects of ketamine: a pharmaco-magnetic resonance imaging study.
Arch. Gen. Psychiatry , 2008, 65 (2) , p. 154-64.
[33] Mayberg H.S. et al. — Deep brain stimulation for treatment-resistant depression. Neuron. , 2005, 45 (5) , p. 651-60.
[34] Price R.B. et al. — Effects of intravenous ketamine on explicit and implicit measures of suicidality in treatment-resistant depression.
Biol. Psychiatry , 2009, 66 (5), p. 522-6.
[35] Del Arco A., Segovia G., Mora F. — Blockade of NMDA receptors in the prefrontal cortex increases dopamine and acetylcholine release in the nucleus accumbens and motor activity.
Psychopharmacology (Berl) , 2008, 201 (3) , p. 325-38.
[36] Kegeles L.S. et al. — Modulation of amphetamine-induced striatal dopamine release by ketamine in humans: implications for schizophrenia.
Biol. Psychiatry , 2000, 48 (7) , p. 627-40.
[37] Miller D.W., Abercrombie E.D. — Effects of MK-801 on spontaneous and amphetaminestimulated dopamine release in striatum measured with in vivo microdialysis in awake rats. Brain
Res. Bull. , 1996, 40 (1) , p. 57-62.
DISCUSSION
M. Henri LÔO
La dénomination douleur psychique semble se substituer à celle de douleur morale, mais l’adjectif moral, peut-être un relan suranné, passéiste, réactionnaire ou « moralisateur » et explique peut-être ce glissement de terminologie. Vous avez situé la douleur psychique dans le cadre de la dépression, mais il existe d’autres contextes où elle s’exprime : le schizophrène dépersonnalisé ou halluciné chez lequel des morphiniques sont efficaces, l’anxieux, l’agoraphobe ou le phobique social. Ces contextes différents ont-ils des répercussions identiques en particulier sur le plan psychopathologique et en imagerie ?
Effectivement la dénomination qu’utilise la psychiatrie française est celle de douleur morale. Quant à la psychiatrie anglo-saxone, largement dominante pour l’édification de la critériologie diagnostique internationale, elle a tout simplement supprimé toute réfé- rence à la douleur. Afin d’éviter d’inutiles querelles et malentendus, notamment quant à la polysémie des termes utilisés (l’adjectif moral par exemple), nous pensons qu’il est plus simple de faire référence à une entité dont la physiopathologie se précise, la douleur psychique. Par ailleurs j’ai effectivement restreint ma présentation au contexte dépressif, mais on peut s’interroger sur d’autres situations pathologiques dans lesquelles la douleur psychique serait à prendre en compte. C’est l’enjeu d’une démarche qui serait davantage dimensionnelle que catégorielle, s’intéressant ici à la dimension « douleur psychique ». Il est fort probable que différentes catégories diagnostiques mettent en jeu cette même dimension.
M. Roger NORDMANN
Votre remarquable exposé a comporté un volet sur l’utilisation de la kétamine en tant que modulateur de la douleur psychique pour le traitement d’urgence des états dépressifs majeurs. La prévalence des suicides étant particulièrement élevée en France, notamment chez les jeunes, cette indication me paraît d’un intérêt majeur. Pourriez-vous nous préciser la voie d’administration préconisée, la durée du traitement, ainsi que les effets indésirables de cette utilisation de la kétamine, substance souvent détournée de ses indications thérapeutiques à titre de drogue ?
Il me semble qu’il faut rappeler que la première question médicale qui se pose dans le contexte d’une tentative de suicide est celle de l’existence ou non d’un épisode dépressif caractérisé, et si oui il faut rappeler que cet épisode dépressif doit faire l’objet d’un traitement validé. Concernant la kétamine, elle est utilisée par voie intraveineuse, à la dose habituellement de 0,5 mg/kg en 40 minutes. Se pose la question de la stratégie de maintien des bénéfices, ce d’autant que le mécanisme d’action très spécifique de la kétamine n’a pas d’équivalent à ce jour sous une autre forme. Certaines équipes répètent les perfusions, par exemple à un rythme mensuel, comme c’est le cas dans certains tableaux poly-algiques résistants. Notons qu’une étude a montré que l’amélioration spectaculaire de l’humeur après une perfusion unique de kétamine s’accompagne d’une diminution tout aussi spectaculaire de l’idéation suicidaire, suggérant que la kétamine pourrait être utilisée dans le traitement aigu d’épisode dépressifs sévères avec risque suicidaire majeur, dans l’attente des bénéfices de traitements antidépresseurs plus conventionnels, dont l’efficacité n’est pas attendue avant trois à six semaines.
M. Jean-Jacques HAUW
La douleur psychique est-elle universelle ? N’est-elle pas liée à d’autres facteurs sociaux ou sociétaux puisque les causes et les expressions de la douleur peuvent être très diverses (à titre d’exemple, la fibromyalgie est observée dans certains pays et non d’autres) ? Est-ce une « voie finale commune » de toute difficulté psychique ?
J’incline à considérer comme universelle l’expérience de la douleur psychique. Les hypothèses phylogénétiques que j’ai évoquées sont d’ailleurs en faveur d’un tel constat.
Cela étant les modalités d’expression peuvent être tout à fait différentes d’un individu à l’autre, d’une population à l’autre. Ainsi les liens entre douleur psychique et douleur physique dépendent-ils peut-être de facteurs culturels.
M. Gérard MILHAUD
Si j’ai bien suivi votre démonstration il devrait être possible de traiter, au moins de soulager, les patients ayant des tendances suicidaires par la dopamine et les inhibiteurs de la dégradation de la dopamine ?
J’ai pointé une hypothèse, selon laquelle une partie des effets bénéfiques de la kétamine serait liés à une libération secondaire de dopamine, au niveau striatal tout particulièrement. On ne peut en conclure directement que les agents dopaminergiques auraient des effets antidépresseurs. Cela étant notre expérience est que l’association d’agents dopaminergiques à des molécules sérotoninergiques (comme c’est le cas de la plupart des antidépresseurs) est très bénéfique, notamment dans les tableaux résistants. C’est d’ailleurs également le mécanisme d’action d’une classe thérapeutique tombée en désué- tude du fait de ses contraintes hygiéno-diététiques mais qui rend encore de grands services, les inhibiteurs de la mono-amine oxydase.
M. Christian NEZELOF
Vous nous montrez les différents facteurs conduisant à des douleurs psychiques. Le chagrin d’amour est-il une cause explorée de cette douleur psychique et appelle-t-elle un traitement particulier ? Quel est le rôle des endorphines dans cette cascade ?
Quant aux endorphines, je vous ai montré qu’un antagoniste opioïde tel que la naloxone majore la douleur psychique ressentie face à une perte, et que cette modulation comportementale correspond bien à la modulation du circuit cérébral de la douleur. Donc il est bien probable que les endorphines soient impliquées dans la régulation de la douleur psychique. Quant au chagrin d’amour, je vous répondrai en citant mon maître Henri Lôo : « un chagrin d’amour qui dure et ne guérit pas, c’est une maladie psychiatrique qui débute ».
M. Charles-Joël MENKÈS
La fibromyalgie est-elle une maladie purement psychiatrique ? La douleur psychique peutelle se traduire par un tableau clinique assez univoque d’un patient à l’autre ?
La psychiatrie étant une branche de la médecine, ou d’ailleurs dirais-je avec Henri Ey la médecine étant une branche de la psychiatrie, cela ne change finalement pas grand-chose.
Il est fort difficile de caractériser la fibromyalgie, et comme je l’ai dit j’ai préféré m’intéresser à la pathologie psychiatrique classique plutôt qu’aux interactions entre pathologie psychiatrique et pathologie physique. Mais l’ampleur du phénomène justifie amplement qu’on l’étudie, et avant tout que l’on soulage ces patients. Force est alors de constater l’efficacité des antidépresseurs dans cette pathologie.
Mme Dominique LECOMTE
A côté de la thérapeutique médicamenteuse quelle est la place pour la parole, l’écoute ? Je parle de la douleur psychique dans le deuil.
Il est impossible d’oublier qu’en tout psychiatre il y a également un psychothérapeute. Et les vertus du langage, qui permet de donner à cette douleur une autre expression, de mots en mots, sont certaines. Je souscris donc tout à fait à votre commentaire sur la place de l’écoute et sur la nécessité de trouver par le langage une expression, sinon à un sens à cette expérience douloureuse.
M. Pierre RONDOT
Comment expliquer l’échec de la dopamine dans le traitement du syndrome dépressif accompagnant souvent la maladie de Parkinson ?
La physiologie de la dopamine est fort complexe, et je crains de ne pouvoir répondre à cette question. Manifestement beaucoup reste à faire tant du point de vue fondamental que du point de vue pratique pour la prise en charge de troubles spécifiques, dont la maladie de Parkinson.
M. Jean-Luc de GENNES
Vous nous avez répondu de manière indirecte sur l’implication de l’endorphine dans les douleurs psychiques. Avez-vous une expérience directe par de véritables dosages chimiques des endorphines dans ces situations ?
À ma connaissance il n’existe pas à l’heure actuelle de dosages de cette nature. Ce que nous pouvons faire, c’est montrer qu’une modulation de telle ou telle voie de neurotransmission affecte tel phénomène psychique, à la fois d’un point de vue comportemental et du point de vue des bases cérébrales qui sous-tendent ce phénomène. Peut-être le renouveau de la tomographie par émission de positrons permettra de mieux connaître la pharmacodynamie qui est associée à ces modulations.
Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 3, 567-581, séance du 2 mars 2010