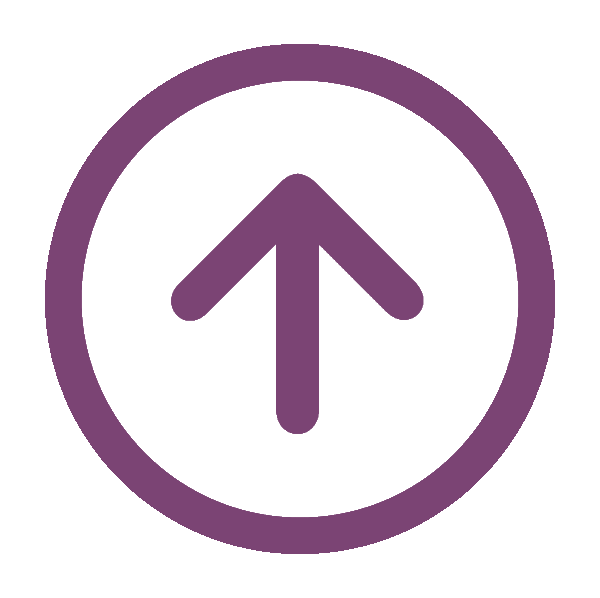Résumé
La violence à l’adolescence sous une forme auto ou hétéro-agressive devient un problème de santé publique. La clinique de ces adolescents difficiles nous montre que la violence n’est pas un choix mais une contrainte qui s’exerce sur le sujet violent. Le point commun de ces adolescents est en effet une vulnérabilité de leur personnalité qui génère un sentiment d’insécurité interne et une dépendance accrue à l’environnement pour se sécuriser. Le comportement violent devient le moyen de retrouver par la destructivité une forme de pouvoir et de maîtrise de la situation qu’il ne peut avoir par la recherche du plaisir ou du succès. L’évolution sociale et familiale comporte des caractéristiques qui peuvent favoriser ces comportements.
Summary
Violence during adolescence, whether self-oriented or directed towards others, is becoming a public health concern. Clinical reports on these difficult adolescents indicate that violence is not a choice but a constraint for the violent subject. Such adolescents share a vulnerable personality that generates a feeling of internal insecurity and an increased dependency on their environment to secure themselves. Violent behavior, through its destructiveness, becomes a means of restoring a kind of power and control over the situation, which cannot be obtained through the search for pleasure and success. The current evolution of society and the family may favor the onset of these behaviors.
Ayant eu l’honneur d’être sollicité pour participer à cette journée scientifique consacrée à la violence à l’adolescence, du fait je suppose de ma qualité de psychiatre d’adolescents, c’est en tant que clinicien que j’interviendrai. Je le ferai sous la forme d’un exposé sur ce que m’a appris ma pratique de près de 40 ans avec ces adolescents en grande difficulté en développant les lignes de force qui paraissent conditionner leurs comportements, les possibilités d’entrer en relation avec eux ainsi que l’impact de l’évolution sociale et familiale de ces dernières décennies. Ce ne seront pas des données expérimentales mais plutôt expérientielles qui orientent quotidiennement nos actions thérapeutiques auprès de ces adolescents et de leurs familles mais aussi nos actions de formation auprès des différents intervenants qu’ils appartiennent aux champs de la santé, de la justice, de l’éducation nationale ou de la police et de la gendarmerie. Cela nous a conduits à créer il y a 3 ans un Diplôme Universitaire qui s’adresse à tous ces intervenants ayant au moins 5 ans de pratique en vue de leur donner des bases communes de compréhension et de les conforter dans leurs identités respectives, la nécessaire différence de leurs actions mais aussi leur complémentarité facilitée par une meilleure connaissance réciproque de leurs rôles et fonctions respectifs. Il s’agira donc d’un bref exposé des lignes générales d’une expérience clinique, sans revue de la littérature sur le sujet et donc sans bibliographie, bien que profondément redevable aux nombreux auteurs qui ont contribué à notre formation et nourri notre expérience.
L’adolescence est entrée en force dans le champ de la psychopathologie ces quatre dernières décennies. C’est le cas en particulier des troubles du comportement, notamment dans leur dimension destructrice, qu’elle prenne une forme auto ou hétéro-agressive. La violence des jeunes est ainsi devenue un problème de santé publique alors même que ces jeunes en sont plus souvent victimes qu’acteurs. Mais le caractère souvent spectaculaire de cette violence juvénile, son absence de motivations claires, la gratuité apparente de beaucoup de ces gestes, sans bénéfice pour l’intéressé, ne peuvent qu’accroître l’inquiétude et le désarroi des adultes. On ne peut pas ne pas s’interroger sur les facteurs, sinon sur les causes impliqués dans cette évolution.
Cependant si on voit à l’adolescence l’émergence d’un certain nombre de violences il ne faudrait pas pour autant assimiler violence et adolescence. Il n’y a pas que les adolescents qui sont violents bien entendu, et il faut prendre garde à cette tendance des adultes à évacuer ce problème sur la classe des jeunes de façon tout à fait abusive.
Mais l’adolescence est quand même un moment privilégié de mise en place de ces comportements qu’ils soient hétéro ou auto agressifs.
QU’ENTEND-ON PAR VIOLENCE ?
Violence « qualité de ce qui agit avec force » nous dit le dictionnaire Littré. À ce titre la vie est violence qui procède par transformations permanentes de la matière. La violence serait donc consubstantielle à l’existant. Elle prend néanmoins une forme
particulière chez les êtres vivants qui les conduits à une lutte permanente pour la défense du territoire, la survie de l’individu et de l’espèce qui s’exprime de façon spectaculaire par la destruction ou la soumission des uns par les autres.
Mais c’est chez l’homme qu’elle acquiert sa dimension la plus tragique du fait même de la conscience qu’il en a et parce qu’elle y fait l’objet à la fois d’une répression sans égale par les interdits qui pèsent sur elle, et d’une extension sans limite, elle aussi sans équivalent.
Il n’est pas aisé de définir la violence. Où commence-t-elle ? Finalement, malgré son imprécision cette définition du Littré, est intéressante à nos yeux de psychiatre si on replace cette force dans le contexte du sujet. Est alors susceptible d’être ressentie comme violente toute force qui agit le sujet. Celui-ci se retrouve de ce fait en situation d’être passivisé, emporté et dépossédé de lui-même par cette force. Ce peut être une force venue de l’extérieur ou de l’intérieur de soi, mais en quelque sorte étrangère au Moi et dépassant ses capacités de maîtrise. On parlera de la violence d’un désir, d’un appétit. Elle n’est pas nécessairement agressive. La violence d’un amour est là pour en témoigner. Mais elle comporte toujours une potentialité destructrice, de soi-même, dans le débordement des capacités de contrôle, mais aussi de l’objet du désir.
C’est là qu’intervient à notre avis la place du sujet. Cette force qui emporte est désubjectivisante, que cette désubjectivation s’applique au sujet lui-même et/ou à l’objet auquel elle s’adresse. Il y a du viol dans la violence et au-delà de l’étymologie commune, elle comporte une dimension d’effraction qui fait vivre au Moi un sentiment de dépossession de lui-même. Il n’est plus maître chez lui mais se vit comme le jouet d’une force qui le dépasse que celle-ci soit l’œuvre du destin, d’autrui ou de désirs que le Moi a du mal à reconnaître comme siens. Dans tous les cas de figure c’est le Moi la principale victime. Il n’est pas étonnant que les affects du registre narcissique, la honte et la rage, soient fréquemment générés par la violence subie.
La violence n’est pas un choix mais une contrainte qu’elle soit subie bien sûr, mais même quand elle est agie. Un sujet menacé est un sujet susceptible de devenir menaçant. La violence n’est pas le fait d’un sujet épanoui, en accord avec lui-même, et dans une relation avec le monde où la satisfaction et la confiance l’emportent sur le besoin de dominer et de contrôler et sur la méfiance et la menace. La violence, en tout cas dans le contexte social qui est le nôtre, n’est pas la manifestation d’un surcroît de force mais l’aveu de faiblesse d’un Moi sous l’emprise des émotions qui l’assaillent. Il ne peut trouver en lui les ressources suffisantes pour se sécuriser, attendre et évaluer la situation. Il est finalement l’esclave de ses craintes et de son hyperréactivité.
Mais le pire ennemi est toujours celui de l’intérieur, beaucoup plus difficile à détecter et qui détruit de l’intérieur l’envie même de résister. Le sujet potentiellement violent ressent ainsi son besoin des autres comme une dépendance intolérable. Il se sent diminué et menacé face à ce besoin qui le confronte à une passivité affolante. Le
besoin de l’autre devient un envahissement par celui-ci transformé en une force aspirante. Son besoin n’est plus ressenti comme tel par le patient mais comme un pouvoir d’autrui sur lui. On n’est pas loin du syndrome d’influence et c’est ce que le passage à l’acte violent tente de conjurer. Potentiellement tout ce qui touche ces sujets tout ce qui les émeut, les affecte est perçu comme un effet d’autrui sur eux.
L’autre n’est plus objet d’un désir ressenti comme leur appartenant et provenant d’eux, mais comme l’origine de leurs émotions, dont la source est ainsi déplacée de l’intérieur vers l’extérieur. Par l’affect, c’est l’autre qui fait intrusion en eux, les manipule, les possède, les influence, bref les dépouille de leur libre-arbitre.
LA VIOLENCE : UN ÉCHEC DU LIEN D’ATTACHEMENT.
Il existe ainsi une relation dialectique entre la violence, la vulnérabilité du Moi générant un sentiment d’insécurité interne, une dépendance accrue à la réalité perceptive externe pour se sécuriser en l’absence de ressources internes accessibles et en retour un besoin de réassurance et de défense du Moi par des conduites d’emprise sur autrui ou soi-même pour lesquelles la dimension de violence est prépondérante.
Si la violence animale est fortement ritualisée et par là même contrôlée il n’en est pas de même pour la violence humaine. L’histoire des sociétés mais aussi des faits divers nous montre que la réalité dépasse en horreur tout ce qui a pu être imaginé.
Pourquoi cette violence sans limite chez l’homme ? Est-il besoin d’un instinct de mort autonome pour penser la violence, ou n’est-elle pas la conséquence logique des particularités du développement humain ? Inscrite comme potentialité au même titre que la relative liberté humaine.
Deux données nous semblent caractériser l’espèce humaine : l’intensité et la durée de sa dépendance à l’égard de ses objets d’attachement et l’accession à une conscience réflexive. Plus que tout autre être vivant l’enfant naît avec une importante discordance de maturation entre un système sensitif et sensoriel rapidement fonctionnel et par contre un système nerveux moteur très immature. Il va se trouver ainsi soumis à un afflux de stimuli et de sensations avec peu de possibilités de réponses motrices.
Cette situation favorise une intense dépendance à l’égard des adultes, tandis que ses capacités cérébrales remarquables lui permettent d’engranger une somme importante d’informations et de développer une conscience de lui-même et un langage qui à la fois accroissent l’importance des informations fournies par l’entourage et favorisent très tôt des capacités de se différencier de cet entourage et de s’opposer.
Ce qui nous différencie des animaux c’est l’activité réflexive, c’est-à-dire la capacité de se voir, que la sophistication du langage, la culture, l’évolution de la civilisation n’ont fait qu’accroître. Cette capacité réflexive, pour laquelle il n’est pas nécessaire d’inférer une intervention d’un autre ordre que celui du développement de la matière, introduit quand même un champ spécifique à l’humain, qui est celui de la représentation et la possibilité de percevoir sa dépendance à l’environnement et plus particulièrement à l’égard de ses objets d’attachement.
Le besoin de dépendre des autres est plus particulièrement marqué chez le petit enfant qui reste débile moteur pendant près de deux ans et beaucoup plus dépendant de son entourage que les animaux. Dépendance motrice et affective dont le bébé prend rapidement conscience et qui introduit le paradoxe au cœur du développement humain, le besoin de dépendance n’ayant d’égal que le besoin d’autonomie.
Ces deux exigences correspondent aux deux lignes essentielles du développement de l’être humain qui font que pour être soi il faut se nourrir des autres (physiquement et psychologiquement) mais aussi se différencier d’eux et notamment de ceux dont il est le plus proche et dont il a le plus besoin. Il s’agit d’un paradoxe, propre à l’être humain, du fait de la conscience qu’il a de lui-même comme sujet unique et différent, c’est-à-dire d’une fausse contradiction mais qui peut lui apparaître comme une contradiction insoluble. Ce sera d’autant plus le cas quand l’enfant est en insécurité interne et se sent très dépendant des autres et tenu de s’agripper à eux, comme l’enfant qui a peur de quitter sa mère. Si le lien à un ou des personnages tiers n’est pas suffisant, le bébé puis l’enfant risquent de se sentir pris dans des liens de captation affective et de dépendance exagérées. Entre l’angoisse d’abandon et celle d’être sous la dépendance d’autrui, l’enfant est souvent contraint de chercher un compromis par l’insatisfaction, la plainte ou l’opposition par lesquelles il pousse les adultes à s’occuper de lui tout en échappant à leur pouvoir du fait même de ses insatisfactions.
Plus l’enfant aura intériorisé une relation de confiance et de sécurité avec l’environnement, plus il sera porteur de sa propre capacité de se sécuriser lui-même et d’être au contact de ses ressources personnelles, de plaisir notamment, plus il sera autonome et capable de s’ouvrir aux tiers. A l’inverse plus il sera en insécurité, plus il deviendra dépendant de l’environnement et du besoin de s’assurer du contrôle de celui-ci par la perception et la motricité au détriment de ses capacités psychiques internes. C’est ce qui se passe pour l’enfant qui se panique quand il est laissé seul et a besoin de s’agripper à une personne connue, non parce qu’il l’aime particulièrement, mais parce qu’il a peur sans elle. C’est du même ordre que ce qui se passe quand le rêveur est réveillé la nuit par l’angoisse et se rassure en constatant qu’il est en sécurité dans sa chambre. Mais cette dépendance à l’environnement a un prix.
L’enfant qui se sent trop dépendant de son environnement pour assurer sa sécurité va défensivement chercher à rendre son environnement dépendant de lui notamment par le caprice, qui deviendra à l’adolescence le comportement d’opposition, et par les plaintes corporelles.
On voit apparaître là un caractère essentiel de cette dépendance à la réalité perceptive : le besoin d’opposer à celle-ci des exigences propres accrues, comme si son opposition permettait à l’enfant d’inverser la situation et de mettre sous emprise celui par lequel il se sent contrôlé et d’exercer ainsi à son encontre une violence.
Dans les cas de carence affective pour suppléer l’absence d’objet d’attachement, l’enfant développe une activité de quête de sensations qui ont comme caractéristiques d’être toujours douloureuses et avec une dimension autodestructrice. Il remplace l’absence de lien à l’entourage par l’auto-stimulation de son corps. Il se
balance de façon stéréotypée, commence à se taper la tête contre les bords du lit, à s’arracher les cheveux. A la place du lien plus ou moins interrompu l’enfant investit un élément neutre du cadre environnant ou une partie de son propre corps. Plus la dimension relationnelle se perd, plus l’investissement supplétif sur le corps se fait sur un mode mécanique et désaffectivisé. La violence de cet investissement et son caractère destructeur sont proportionnels à la perte de la qualité relationnelle du lien et à ce qu’on pourrait appeler sa déshumanisation.
Il y a toujours cette dimension autodestructrice dans ces situations de carences relationnelles de l’enfance qui sont réactivées au moment de l’adolescence en lien à la fois avec la perte relationnelle, et avec la menace que représente pour ces sujets l’autre quand il se rapproche.
LA PUBERTÉ : UNE VIOLENCE POTENTIELLE FAITE A L’ADOLESCENT.
De tout temps l’adolescence a été associée à la violence. Les rites d’initiation qui caractérisaient le passage de l’enfance à l’âge adulte dans les sociétés dites primitives, sans écriture, sont là pour nous le rappeler. Toute société a eu peur de la puberté : peur des changements porteurs d’un risque de désorganisation et de menace sur les liens existants. Les rites d’initiation impliquent toujours de la violence. Il n’y a pas de rite doux. Ils comportent des épreuves qui peuvent mettre la vie du sujet en danger et qui vont au minimum se conclure par des marques corporelles douloureuses qui viennent probablement témoigner de la coupure d’avec le monde de l’enfance et de l’agrégation dans un monde des adultes, marqué par une différence des sexes socialement très affirmée Il ne faut pas minimiser la potentialité traumatique de la puberté, son caractère d’effraction possible, de débordement des capacités d’organisation du Moi devant ce brutal changement du corps. Cette accession à un corps apte à agir les pulsions a des effets sur la psyché du pré-adolescent et notamment celui de lui donner le sentiment d’être confronté à quelque chose qui s’impose à elle sans qu’elle l’ait choisie. Cette passivité est susceptible tout à la fois de le fasciner et de l’effrayer, notamment parce qu’elle renvoie au vécu de dépendance de sa première enfance.
Cette passivité le confronte inéluctablement aux lois de la nature et à ce qu’il peut vivre comme son destin et à ce qui lui est imposé par sa naissance notamment son statut sexué, de garçon ou fille, et ce sans qu’on l’ait consulté quant à ses éventuelles préférences. Cette confrontation à la nécessité génère un vécu d’allégeance à ceux dont il a hérité de ce corps, à savoir ses parents.
La confrontation à la passivité est volontiers ressentie, quand elle n’est pas choisie par l’être humain et plus spécifiquement à l’adolescence, comme une menace car elle met en cause son sentiment de continuité et d’unité fruit de la progressive maîtrise de ses moyens et de ses acquis. A l’adolescence les sources de cette passivité sont doubles et se renforcent l’une l’autre : passivité du Moi face aux transformations pubertaires dont le corps est l’objet et qui s’imposent à lui ; passivité liée à la
situation d’attente à l’égard des adultes, mais aussi des futurs objets d’investissements tant affectifs que professionnels, ainsi que du statut social à venir.
Cette situation a pour effet la nécessaire modification de la distance aux parents et aux adultes. L’effet s’en fait immédiatement sentir sur la relation à ceux-ci qui perd son naturel. La sexualisation du lien crée une gène que traduit l’apparition de la rougeur et de formations réactionnelles caractéristiques de l’adolescence qui expriment les réactions de fuite voire de dégoût à l’égard du corps des parents. Mais cette prise de distance génère à son tour une interrogation sur la capacité d’autonomie de l’adolescent et la qualité de ce qu’il a à l’intérieur de lui-même.
L’adolescence est ainsi révélatrice de la qualité de ce que l’on a pu emmagasiner, intérioriser pendant l’enfance. Plus on arrive à l’adolescence pourvu d’une sécurité intérieure, d’une estime de soi suffisante, nourri de la qualité des liens avec l’environnement, plus on sera capable de gérer la distance avec une certaine souplesse.
Mais plus on y accède avec un passif important, des traumatismes, une dépendance exagérée à l’environnement, plus ce sera difficile. Les jeunes ont d’autant plus besoin de se sentir reconnus qu’ils ne sont pas sûrs eux-mêmes de leur propre valeur.
La puberté oblige l’adolescent à prendre ses distances avec ses parents réveillant les inquiétudes narcissiques et la quête d’un soutien relationnel. Inversement la fragilité narcissique en exacerbant l’« appétence relationnelle » contribue à donner aux liens une intensité qui en renforce le caractère potentiellement incestueux. Cette dialectique — entre le besoin que l’on a de s’appuyer sur les autres, la sexualisation de ce lien et le besoin de se différencier et de s’affirmer dans son autonomie — constitue une des clés de la problématique adolescente. Elle se présente sous la forme d’un paradoxe : « ce dont j’ai besoin, cette force des adultes qui me manque, et à la mesure de ce besoin, c’est ce qui menace mon autonomie naissante » Il y a là quelque chose qui peut être vécu comme une contradiction absolue : comment, pour trouver la sécurité, la force, les atouts qui manquent, se nourrir de ces adultes qui sont censés avoir tout cela sans être complètement dépendant d’eux ? C’est ce que traduit cette expression si parlante des jeunes disant d’un adulte qu’il leur « prend la tête ». Mais la tête n’est prise que parce qu’elle est ouverte. Si l’adolescent n’était pas en attente vis-à-vis des adultes, l’adulte ne le pénétrerait pas. Il ne le pénètre que parce qu’il y a une ouverture. Son propre ennemi est à l’intérieur de lui : c’est son désir lui-même, véritable cheval de Troie de l’adulte à l’intérieur de lui.
Plus le jeune attend quelque chose de l’adulte, plus il se sent en menace de pénétration et cette menace génère une humiliation d’autant plus intense qu’il se sent prêt à céder. Le plaisir de désirer se transforme en un pouvoir sur soi donné à l’autre. Il y a là quelque chose d’assez intolérable, avec toutes les gradations entre les relations normales — celles que l’on rencontre souvent dans les relations amoureuses — et les relations les plus psycho-pathologiques. Un tel antagonisme entre ces deux lignes de développement n’est évidemment pas perçu comme tel par le sujet. Il est vécu et subi comme une contrainte interne qui ne dit ni son nom, ni son origine, et qui ne peut être perçue que par ses effets. C’est d’autant plus le cas qu’il ne s’agit pas de conflits
entre des désirs contradictoires ou un désir et un interdit, mais d’exigences internes qui ne peuvent être perçues par ces adolescents que comme s’annihilant entre elles.
On est en fait dans le registre du paradoxe. Les deux termes de l’antagonisme n’appartiennent pas en effet au même niveau de logique. Ils ne s’opposent pas mais devraient au contraire se compléter, comme c’est le cas dans un développement plus satisfaisant où le narcissisme se nourrit de l’intériorisation des relations objectales.
Les conséquences s’en font sentir à deux niveaux : sur le développement de la personnalité, en empêchant la poursuite des processus d’échanges et d’intériorisation et en bloquant les mécanismes d’identifications, nécessaires à la maturation du sujet ; sur le fonctionnement mental lui-même, en entravant les possibilités de représentation, les situations paradoxales ayant des effets spécifiques de sidération de la pensée, comme l’on montré, après les travaux de G. Bateson, les études sur les systèmes d’interactions et la pensée paradoxale.
On peut voir, dans cette menace sur l’autonomie et la pensée du sujet, une situation de violence qui attaque son intégrité narcissique et génère en retour une violence défensive que traduit la réponse par l’agir comportemental. Celui-ci tente de restaurer des limites et une identité menacée, par la négation des désirs et des liens internes et par l’emprise sur les personnes externes.
LA VIOLENCE : UNE CONTRAINTE AU SERVICE DU MOI.
L’opposition, expression minimale de la violence, est l’une des façons de sortir de ce paradoxe. Dans l’opposition on s’appuie sur l’autre tout en méconnaissant qu’on en a besoin, puisque on n’est pas d’accord avec lui. C’est l’une des clés pour comprendre l’importance des conduites négatives des adolescents, même s’il existe des facteurs d’ordres divers (tempérament, génétique etc..). Elles ont toutes cette dimension d’échec plus ou moins sévère et focalisée (l’anorexie c’est le problème de son corps et de la nourriture, pour un autre ce sera l’échec scolaire etc..). Le piège et le drame, c’est que ce comportement négatif est pour l’adolescent un moyen d’affirmer son identité et sa différence. Quelqu’un qui est trop en attente ne sait plus où est son propre désir et celui des autres. Il est dans un état de gêne et de confusion d’autant plus grand que ses relations de plaisir ou de satisfaction créent un rapproché exagéré avec un des adultes auquel il est attaché.
Il est frappant de voir combien d’adolescents, à la puberté, mettent en échec ce qui est source de valorisation, ce qui était objet de fierté partagée avec l’un ou l’autre, ou les deux parents. Il se met donc en situation d’échec ou de retrait pour assurer sa différence. L’échec suprême, c’est la conduite suicidaire qui exprime rarement un véritable désir de mourir ; ou un désir de mourir qui traduit en fait la peur et le refus.
Ce « je peux choisir de mourir » répond en écho au cri d’impuissance du « je n’ai pas demandé à naître » qui témoigne du refus d’accepter ce qu’on est et ce que sont les proches, ceux dont on attend des réponses qui ne viennent pas. Il témoigne beau-
coup plus de l’expression du désir démiurgique ou prométhéen de rapter le pouvoir des parents de donner la vie pour reprendre en main son destin et s’auto-générer dans la destruction de ce que seuls les parents ont eu le pouvoir de créer, c’est-à-dire son corps, mais au fond en ayant le fantasme, tel le phœnix, de ressusciter de ses cendres en gardant intact la volonté de réaliser sa vie telle qu’on le voulait sans renoncer à aucune de ses envies.
On voit une fois de plus à l’œuvre la violence, ici celle de l’autodestruction, comme ultime moyen de maîtrise d’un Moi dépassé. Le choix de la vie, du succès, du plaisir est toujours aléatoire et dépend beaucoup de facteurs qu’on ne maîtrise pas, notamment l’opinion et les sentiments des autres. De plus le plaisir a toujours une fin et confronte les anxieux aux angoisses de perte et de séparation. On peut par contre être toujours maître de son échec, du refus d’utiliser ses potentialités, des comportements d’auto-sabotage et d’auto-destruction.
Cette véritable fascination par le négatif est le danger qui guettent nombre d’adolescents peu sûr d’eux et en insécurité interne. Paradoxalement le négatif leur confère un pouvoir que la recherche de la satisfaction de leurs désirs et de la réussite ne leur donnerait pas. Mais c’est un plaisir d’emprise et non de la satisfaction du désir. C’est le prix à payer pour rassurer le Moi et lui prouver qu’il a les moyens de contrôler et les désirs et les objets de ceux-ci et qu’il n’est pas sous leur dépendance.
Cela permet de comprendre l’effet de soulagement de ces comportements autodestructeurs, comme l’apaisement qui accompagne la décision de se suicider ou la cessation de l’angoisse après s’être infligé des brûlures ou des scarifications du corps.
Mais il est important de repérer ce que ces comportements révèlent de désir d’affirmation, de déception et de colère. C’est l’ultime moyen à leur disposition d’affirmer leur existence et leur différence à la fois dans un refus et un rejet catégorique de ce qui est attendu d’eux notamment par les parents, et un besoin d’être vus et d’exister pour ceux-ci, souvent largement méconnus d’eux, qui ne peut s’exprimer que sur le mode de l’inquiétude suscitée. Ce qui est impossible c’est le plaisir partagé vécu comme une reddition du Moi à ces objets dont l’intensité même de l’attente déçue interdit toute satisfaction.
Les voies d’expression de la violence par la recherche d’une emprise qui se substitue aux vulnérabilités internes suivent celles habituelles des modes d’expression de l’individu : la voie perceptivo-motrice du comportement ; la voie neuro-végétative, neuro-endocrinienne ou neuro-immunologique des troubles psycho-somatiques ; la voie du surinvestissement de l’objet, celle de la passion ; la voie de la représentation mentale pour l’écraser dans l’inhibition ou le négativisme ou l’exacerber dans la surestimation de ses jugements et de ses croyances. On peut ainsi considérer l’ensemble du système défensif du sujet et les modalités relationnelles qui en découlent sous l’angle de l’aménagement de la dépendance d’un Moi affaibli par un sentiment d’insécurité interne. A la place de relations simples et diversifiées s’installent des modes relationnels défensifs marqués par le besoin d’emprise que traduisent deux qualités d’investissement qui signent le besoin du Moi de compenser une faiblesse interne par un surinvestissement de l’objet investi ou de ses substituts et qui sont :
l’excès et la rigidité. L’excès est l’effet d’un surinvestissement lui-même généré par la nécessité de contre-investir une réalité interne insécurisante. Quant à la rigidité son intensité est proportionnelle à celle de la menace narcissique éprouvée par le Moi.
Chez ces sujets, le drame, c’est que le rétablissement des liens fait resurgir la douleur des déceptions antérieures. C’est bien un des paradoxes de leurs psychothérapies.
C’est cette menace qui est susceptible de générer un mouvement de rejet de toute trace de lien. Il conduit l’adolescent à rejeter, c’est-à-dire à désinvestir, tout ce qui porte la trace de l’autre au niveau en tout cas du comportement ou plus généralement de la conduite qui focalise son conflit.
On voit ainsi apparaître clairement la fonction anti-relationnelle de ce comportement qui peut conduire l’adolescent non seulement à accentuer le recours à cet agir, mais également à en évacuer les traces de liens. Le comportement devient de plus en plus désaffectivisé, purement mécanique, tandis que disparaît toute référence aux liens antérieurs au profit du besoin de sensations violentes pour se sentir exister et non plus pour éprouver du plaisir comme dans le cas de l’enfant carencé évoqué ci-dessus.
Le masochisme représente de façon privilégiée une de ces modalités de liaison de la violence en une agressivité retournée contre soi La solution masochique s’impose au Moi comme un compromis toujours possible « à portée de main » pourrait-on dire quand le Moi est menacé de débordement. Réussir et avoir du plaisir sont aléatoires et rendent dépendants des autres. Détruire et se faire du mal sont toujours possibles et rendent les autres impuissants.
DIFFICULTÉS ET PARADOXES DE LA RELATION ÉDUCATIVE.
Comment dans ces conditions faire appel au Moi pour l’éduquer ? Comment lui redonner un espace et une consistance propres ? Comment le Moi peut-il se construire s’il n’a aucune possibilité de contenir et ainsi se réapproprier ces forces pour les mettre au service d’un projet ? A une contrainte n’est-on pas tenu d’opposer à un moment donné une autre forme de contrainte dont la finalité est d’arrêter ce cycle de stimuli-réponses sans fin et de permettre au sujet de penser sa situation et de poser des choix ?
L’objectif de l’éducation est de permettre à l’enfant de devenir autonome et de ne plus dépendre de l’autorité de l’adulte. On a pu penser que cette autonomie s’acquerrait plus facilement en laissant l’enfant très libre et en lui posant le moins de limites possibles. Ne pas exercer d’autorité, c’est abandonner l’enfant à lui-même, à la tyrannie de ses besoins et de ses contradictions, sans références extérieures pour les réguler, les projeter dans l’avenir et leur donner un sens. L’essentiel de la liberté d’un individu dépend de sa capacité d’attendre. Or l’attente est un apprentissage qui résulte à la fois des capacités propres à l’enfant et de sa prise en compte progressive des limites que les adultes lui imposent pour le protéger, mais aussi l’insérer dans le
groupe social. En acceptant ces limites et interdits, l’enfant s’assure en retour de sa valeur par l’amour et l’estime que les adultes éprouvent à son égard. La capacité d’attendre repose non pas sur le refus de la satisfaction immédiate mais sur la possibilité de la différer en vue d’un plus grand bien : l’approbation des adultes dans un premier temps, puis la prise de conscience progressive de ses ressources propres, de ses moyens de contrôle. L’enfant se perçoit ainsi progressivement comme plus libre, tant par rapport à ses besoins propres que par rapport aux réactions de l’environnement.
Si l’adulte est trop laxiste, l’enfant est prisonnier de ses contradictions internes, sans autre valorisation structurante que la quête répétée de satisfactions passagères auxquelles il risque d’être condamné.
Mais attendre suppose une confiance suffisante dans les autres et en soi-même. C’est justement ce qui manque le plus à ces adolescents difficiles. Leur insécurité les laisse sans ressources internes pour s’assurer leur équilibre, à la merci de leurs émotions et particulièrement dépendants du contexte environnemental comme des attitudes et des réponses de ceux qui les entourent. Ils tolèrent mal la solitude comme de ne pas être le centre d’intérêt et d’avoir le sentiment de ne pas être vus. Si on ne s’occupe pas d’eux, ils se ressentent vite abandonnés et si on s’intéresse à eux ils se sentent tout aussi rapidement envahis voire persécutés, d’autant plus qu’ils sont plus en attente de l’intérêt des autres mais qu’ils doutent de leur propre intérêt et de leur valeur et qu’ils se perçoivent sans ressources et sans qualités.
Cela peut nous conduire à prescrire ce qu’on pense que le patient désire. Cette secrète attente qu’on le devine est très typique de l’adolescent. Paradoxalement, la prescription les soulage. Il faut qu’il y ait une contrainte extérieure pour qu’ils ne soient pas obligés de saboter tout ce qu’ils désirent.
Les adultes doivent avoir des exigences qui apportent les limites dont les adolescents ont besoin et qui les rassurent. La formulation de ces exigences permet en outre l’expression d’une conflictualité qu’il faut rendre tolérable, offre la possibilité à l’adolescent de prendre sa mesure dans l’affrontement, mais surtout, contribue à le protéger d’une prise de conscience trop brutale de ses besoins et de sa passivité. En effet, paradoxalement en apparence, avoir des exigences permet à celui qui en est l’objet de satisfaire un certain nombre de ses désirs et besoins, sans avoir à les reconnaître, mais en pensant qu’il ne fait que subir une contrainte extérieure. Or, celle-ci est toujours ressentie moins péniblement que les contraintes intérieures liées aux besoins et désirs qui représentent la véritable passivité, la plus dangereuse pour l’intégrité du Moi, car ce dernier ne peut se révolter totalement contre elles, comme dans le cas des contraintes externes puisqu’il en est le complice et qu’elles font partie de lui. Le risque n’est plus alors celui de la révolte mais celui, bien plus grave, d’un effondrement du Moi ou d’une annihilation des désirs.
L’ADOLESCENT : MIROIR DE LA SOCIÉTÉ
Cette grande dépendance des adolescents vulnérables à l’environnement et au regard des autres sur eux contribue à faire des adolescents le révélateur de la société des adultes.
Cette fonction de révélateur de l’adolescence est d’autant plus sensible actuellement que cette période de la vie s’étend et que la société, en mal de valeurs reconnues, s’en sert comme d’un miroir qui permet aux adultes à la fois de dénier le temps qui passe et leur propre dépression en focalisant leurs inquiétudes sur les jeunes. Cette situation accroît la proximité entre adolescents et adultes, affaiblit les médiations susceptibles de servir de limites différenciatrices et de soutien à une fonction tierce, et rend les jeunes d’autant plus réactifs aux attitudes et à l’état psychologique des adultes. L’enfant soutient les parents, les parents soutiennent l’enfant dans des relations de dépendance. Il y a une espèce de complicité avec cet enfant qui prend vite un caractère incestuel réciproque mêlé à une peur du conflit, qui conduit à un évitement généralisé de tout affrontement. On se dit tout, on partage tout, ce qui est très enrichissant pour des enfants, mais leur fait courir un risque d’indifférenciation des générations. Ce qui va faire tiers, et va avoir une fonction différenciatrice, quand on est dans ces relations de dépendance narcissique excessive c’est tout ce qui s’oppose au plaisir partagé, tout ce qui est de l’ordre de l’insatisfaction, de l’opposition, de la souffrance et qui relève d’une forme de violence destructrice.
L’évolution sociale permet aux jeunes, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, en tout cas à une si grande échelle, de concevoir un avenir qui ne soit pas la pure répétition de la vie de leurs parents. Cette ouverture vers un mode de vie en partie inconnu, accompagnée d’un affaiblissement des interdits mais d’un accroissement des exigences de performance et de réussite individuelles, favorise tout naturellement l’expression des inquiétudes narcissiques et des besoins de dépendance, tout en diminuant les occasions de conflits. Le slogan implicite des sociétés de type occidental pourrait être : « fais ce que tu veux mais sois le meilleur ». Mais si l’on peut faire ce qu’on veut, on ne sait plus toujours ce qu’on veut ou on veut des choses contradictoires. L’enfant et plus encore l’adolescent sont confrontés trop vite et trop massivement à leur ambivalence et à leur solitude devant cette ambivalence.
Face à leurs contradictions et à leurs insatisfactions ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes et n’ont plus aussi aisément qu’auparavant le recours aux limitations venues de l’extérieur, des parents ou de la société. De plus comme il faut faire bien ce que l’on fait, ils sont immédiatement sollicités au niveau narcissique. Le conflit s’est déplacé de la lutte contre les interdits à la guerre entre les ego et les territoires pour être le meilleur et le mieux servi. On le sent bien actuellement dans cette espèce de culte de la performance qui sert d’idéal à la société. Il y a un combat acharné à tous les niveaux de la compétition, avec ce que cela a de créatif mais aussi de violent et de potentiellement destructeur.
On retrouve dans le fonctionnement de la famille le même affaiblissement des interdits et des limites au profit de l’accroissement des exigences narcissiques.
L’évitement des conflits, la perte de la médiation que représentait le consensus social sur les règles de vie, favorise la création d’une pseudo mutualité familiale et l’enchevêtrement entre les générations. A la problématique du conflit, liée à des interdits forts et propre aux sociétés aux règles transactionnelles rigides, se substitue une problématique du lien pour laquelle la distance relationnelle ne peut plus se moduler par le biais des limites et des différences clairement affirmées. Le maintien du lien est d’autant plus nécessaire qu’il est plus chargé d’attentes narcissiques réciproques et qu’il sert à contre-investir une agressivité que l’absence d’occasions de la manier oblige à réprimer. L’intolérance au lien est à la mesure de sa nécessité, l’un renforçant l’autre, en un mouvement de nœud coulant qui finit par menacer jusqu’à l’identité même du sujet. Le risque est bien réel. L’analogie soulignée entre cette dissolution du statut d’adulte et la prolifération des états limites ou des fonctionnements limites en est une illustration. Le risque commun à ces situations, au delà de leur possible diversité apparente c’est la perte d’un minimum de liberté du sujet et en particulier de la capacité de choisir. Sous l’apparente anarchie des choix et des comportements, c’est la contrainte, c’est-à-dire une forme de violence, qui impose sa loi : contrainte des ruptures successives et des passages à l’acte ; contrainte à fuir l’objet du désir quand il se rapproche ; contrainte du Moi pris entre l’angoisse d’abandon et celle d’intrusion ; contrainte d’éviter les désirs objectaux parce qu’ils menacent l’équilibre narcissique.
Quand un sujet est en souffrance, ce n’est pas un choix c’est une contrainte. Une contrainte qui est un appel aux autres à intervenir, appel qui ne peut pas être dit par le langage, parce que il y aurait là aussi excès de rapprocher. Dans ce cas l’appel aux tiers que ne peut formuler le sujet, il faut savoir l’imposer, quoi qu’en dise le sujet, pour faire contrepoids à ses contraintes internes. A une contrainte interne qui ne dit pas son nom, on est en droit d’opposer une contrainte externe qui limite cette contrainte interne. Non pas pour imposer une solution définitive, mais pour permettre au sujet de retrouver progressivement une liberté de choix qui n’est possible que s’il acquiert une capacité minimale de prendre soin de lui et d’exister dans sa différence autrement qu’en s’attaquant lui-même. Ceci me semble vrai aussi bien au niveau individuel qu’au niveau social.
DISCUSSION
M. Jacques-Louis BINET
Philippe Jeammet nous a si bien décrit l’évolution de cette menace d’identité, cette incapacité d’attendre. Comment peut-on en sortir ? Quels sont les moyens que le psychiatre peut utiliser ?
Il faut tâcher de réunir un faisceau de moyens qui repose : sur la nécessité de poser des limites aux comportements auto-destructeurs de l’adolescent avec l’aide des parents.
Essayer de rétablir une relation de confiance avec un adulte et la faciliter par un mode d’intervention pluri-focal où plusieurs intervenants agissent en complémentarité et en cohérence. La pluralité offre une marge de choix à l’adolescent qui peut d’autant plus facilement se rapprocher d’un adulte qu’il s’oppose à un autre. On retrouve avec cette triade les exigences essentielles du développement de la personnalité : la continuité des relations de confiance dans un lien privilégié avec un ou plusieurs adultes ; l’ouverture à des tiers extérieurs à cette relation initiale privilégiée ; la nécessité de limites posées à l’enfant et à l’adolescent qui lui permettent de prendre conscience de ses ressources propres, de s’opposer et de se différencier des adultes qui l’entourent tout en satisfaisant aux exigences du développement de ses capacités propres.
M. Georges DAVID
Vous avez cité ce très bel ouvrage de Camus LE PREMIER HOMME. Comment expliquez-vous que le narrateur ait pu se construire alors même que le père est au début de sa vie absent physiquement puisque mort et que la mère est ancrée dans le malheur ?
Il est difficile de résumer en quelques mots une relation aussi complexe que celle de Camus avec son entourage et notamment sa mère. On peut néanmoins remarquer que le père était tout de même présent dans le souvenir et en tant que porteur d’un idéal ; des souvenirs très chaleureux de plaisir liés aux promenades et à la chasse sont associés à l’oncle Emile, frère de la mère, et surtout au rôle essentiel de l’instituteur, Monsieur Germain, comme ouverture au tiers et à la culture dont la lettre de réponse à Camus après son obtention du prix Nobel est un véritable chef d’œuvre sur l’art d’éduquer.
Mme Monique ADOLPHE
La crise d’adolescence violente est-elle plus fréquente chez les enfants adoptés ?
Des études épidémiologiques notamment hollandaises du Pr Verhulst publiées dans la Psychiatrie de l’Enfant font état d’environ 10 % supplémentaire de troubles du comportement et du développement chez les enfants adoptés par rapport aux enfants naturels.
M. Christian NEZELOF
Connaît-on des éléments génétiques individualisés qui constituent une base favorisant le comportement violent de l’adolescent ?
Le professeur Karli a développé ce point ce matin. Il n’y a pas de gène de la violence, mais une série de facteurs polygéniques qui confère une héritabilité à la violence dans une interaction constante avec l’environnement qui peut faciliter ou inhiber l’expression de ce potentiel de violence.
* Chef du service de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte. Institut Mutualiste Montsouris 42, boulevard Jourdan 75014 Paris. Tirés à part : Professeur Philippe JEANMET à l’adresse ci-dessus. Article reçu et accepté le 8 novembre 2004.
Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1347-1360, séance du 25 novembre 2004