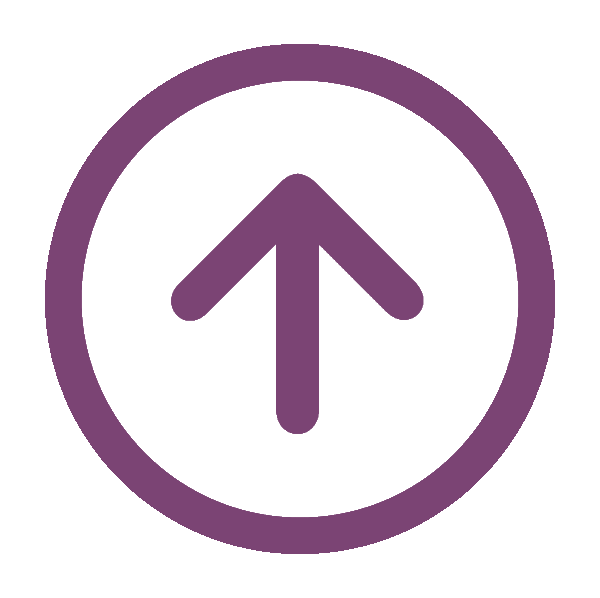Résumé
Après la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme formulée à Nuremberg, en 1948 toute une série de déclarations et de textes nationaux et internationaux ont suivi, au fil des années, conduisant à reconnaître au malade des droits particuliers, notamment son droit à l’information et la nécessité de son consentement aux soins proposés, en application directe de la reconnaissance de l’autonomie de la personne et de sa dignité. Le rappel des dates de promulgations des diverses lois sur les droits des malades dans les pays de la CEE témoigne du fait que ce mouvement n’est réellement engagé dans l’Europe que depuis deux décennies. En France un grand nombre de textes législatifs ont été promulgués constituant un arsenal législatif de plus en plus complexe. Il est le reflet de l’attitude consumériste du patient devenu usager, progressivement substituée à la tradition humaniste qui avait été, notamment, celle de la médecine française. La relation soigné-soignant s’en trouve profondément modifiée. L’usager consommateur de soins devient de plus en plus exigeant vis-à-vis des prestataires de soins dont il exige de plus en plus de technicité et d’efficacité. Certaines de ces exigences sont d’autant plus exprimées qu’elles figurent dans les textes de loi comme des droits mais d’autant plus difficiles voire impossibles à satisfaire que les moyens financiers correspondants ne sont pas ou très insuffisamment accordés par la société elle-même. En même temps qu’il se comporte en consommateur de technologies, l’usager exprime ses exigences sécuritaires voire indemnitaires en cas de résultat insuffisant ou d’événement indésirable. Ces attitudes relèvent souvent de la confusion entre droit à la sécurité et droit à la santé comme entre droit aux soins et droit à la santé, mais aussi de la confusion entre « droit de … » ce qui signifie faire « ce que la loi n’interdit pas » et « droit à .. . » qui recouvre des revendications à l’obtention de biens matériels ou immatériels. En matière de besoins individuels de santé, on ne peut demander à la loi de tout prévoir et d’apporter la solution à tous les besoins individuels formulés comme des droits. Les droits des malades ne se résument pas à l’expression de la légitime prise en compte des besoins matériels nouveaux créés par leur maladie, dans un concept « marchand », et du « chacun pour soi ». A ces droits devrait faire écho le devoir de solidarité des citoyens, c’est-à-dire de la société toute entière évidemment faite en majorité de bien portants qui n’en sont pas moins tous des malades potentiels. Par contre la loi peut être utile et devenir nécessaire pour adapter la législation générale aux situations nouvelles, conséquence des profondes évolutions de la médecine sur la société. Des exemples en sont donnés (loi sur le handicap, loi relative à la fin de vie). Légiférer sur la relation soigné soignant est difficile et inutile. Cette relation n’est pas du domaine commercial, et ses modalités ne peuvent être fixées de manière réglementaire. Elle relève de l’humanisme, or l’humanisme si profondément inscrit dans notre culture ne se décrète pas, pas plus que la loi ne peut le déclarer obsolète. Il y a maintenant plus d’un demi-siècle, les horreurs de la deuxième guerre mondiale ont fait prendre conscience au monde que la dignité inhérente à la personne humaine pouvait être bafouée. L’Assemblée générale des Nations Unies avait à
Nuremberg , le 10 septembre 1948 proclamé la Déclaration universelle des droits de l’homme , qui reconnaît la valeur de la personne humaine. On peut y lire en son article 25 /I : toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille, notamment pour (…) les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de maladie, d’invalidité, de veuvage et de vieillesse.
Au fil des années, toute une série de déclarations et textes nationaux et internationaux ont suivi, conduisant à reconnaître au malade des droits particuliers, notamment son droit à l’information et la nécessité de consentement aux soins proposés, en application directe de la reconnaissance de l’autonomie de la personne et de sa dignité.
LES TEXTES INTERNATIONAUX
Ils sont paradoxalement relativement récents et, pour la plupart d’entre eux, font écho à la déclaration de la 34e assemblée de l’Association médicale mondiale, réunie à Lisbonne en 1981 plus de trente ans après Nuremberg…On y trouve formulés « le droit de décision, le droit à l’information nécessaire pour prendre ses décisions clairement » et encore « le malade doit pouvoir comprendre l’objet d’un examen ou d’un traitement, les effets de leurs résultats et les conséquences d’un refus de traitement ( art.3a-b ) ».
Les mêmes recommandations furent amendées à Bali en 1995 : « le patient a le droit de refuser de participer à la recherche ou à l’enseignement de la médecine » puis révisées à Santiago du Chili en octobre 2005.
Plus encore, elles sont clairement formulées dans la « C onvention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine » du Conseil de l’Europe adopté à Oviedo le 4 avril 1997.
Les deux articles essentiels sont l’article 5 qui indique qu’ une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé et l’article 10-2 relatif au droit à l’information qui stipule : toute personne a le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé .
Cet article ajoute toutefois : cependant la volonté d’une personne de ne pas être informée doit être respectée. Il s’y ajoutera un droit à l’indemnisation des accidents médicaux.
De l’humanisme au consumérisme
Ainsi, progressivement, une attitude consumériste du patient devenu usage r s’est substituée à la tradition humanist e qui avait été, notamment, celle de la médecine française [1]. Les philosophes diront que l’on est passé d’une éthique médicale téléologique , qui met en au premier plan le principe de bienfaisance, à une éthique déontologique qui met au premier plan le respect des personnes tenues pour sujets moraux autonomes.
Certains ont voulu y voir une évolution dans le droit-fil du mouvement européen des lumières (Koch) même si elle nous semble venue surtout par l’influence nordaméricaine.
Pour d’autres elle serait à la médecine européenne ce qu’est à la vie politique européenne l’apprentissage de la démocratie. Sans doute faut-il voir là pourquoi plusieurs nations européennes n’ont que récemment légiféré sur la question et pourquoi la convention d’Oviedo n’a encore été ratifiée que par un nombre restreint de parlements européens.
Les pays européens légifèrent en ce sens
Sous des formes diverses les pays membres de la CEE ont inscrits cette modification profonde soit dans des textes de loi soit par des textes de droit jurisprudentiel. Ils figurent dans le tableau 1.
TABLEAU no 1. — Législation ou réglementation en Europe (hors France) 1992, Finlande , loi no 785/1992 dite « act on the status and rights of patients » (17-0892) 1993, Danemark, loi « l’accès aux informations médicales ». sera remplacée en 1998 par une loi sur « le statut juridique du patient » 1995 , Pays-bas, loi « d’accord en matière de traitement médical » affirme « l’existence d’un contrat entre les patients et les prestataires des soins de santé » prévoit « un accès large du patient à son dossier médical » 1997, Grèce, Islande , loi no 74/1997, du 01-07-97 1998, Grande-Bretagne, loi sur « les données personnelles ».
Norvège , loi no 63 du 27-07-1998, entrée en vigueur le 1°-01 2001.
Allemagne, ( Droit jurisprudentiel), « prestataires de soins et patients sont liés par un contrat de service dont l’existence fonde la plupart des droits des patients »
Italie , tribunal des droits des malades : 450 sections locales.
Belgique , ( Droit jurisprudentiel : contrat tacite entre les patients et les prestataires de soins de santé . Août 2002, loi « relative aux droits du patient ».
En
France, pays des droits de l’homme… et des lois ! La réflexion est longtemps restée confinée dans des cercles philosophiques, sociologiques juridiques où politiques en dehors de la préoccupation du monde médical et du plus grand nombre des malades.
Cependant les principes fondamentaux figuraient dés la Constitution de 1946 (avant
Nuremberg !) et furent repris dans la
Constitution de 1951 .
En 1988 une loi introduisait la notion de consentement éclairé pour la « protection des personnes qui se prêtent à la recherche biologique et médicale » ( Loi Huriet –
Sérusclat , no 88-1138 du 20.12.88). Les lois dites de Bioéthiques (no 94-643 et 94-644,) les premiers votées en Europe sous ce vocable en juillet 1994 formulaient clairement le respect du corps humain , sa non patrimonialité . Il n’y était pas question de « droits des malades ».Mais une nouvelle version du Code de déontologie médicale qui en intégrait la substance fut promulguée dès 1 995 . Elle comporte un chapitre III intitulé :
Devoirs envers les patients .
— Il stipule en son article 35 : le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne, ou qu’il conseille, une information loyale, claire et approfondie sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose…
— Et en son article 36 : le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas…
—
L’article 45 traite du dossier médical établi pour chaque malade, « fiche d’obser- vation qui lui est personnelle, confidentielle et conservée sous la responsabilité du médecin »
Une «
Charte du patient hospitalisé » traitant de « l ’information du patient et de ses proches et du principe général du consentement préalable » fut publiée la même année.
Le texte devant en être remis à chaque patient hospitalisé.
C’est surtout autour du droit d’accès au dossier médical que se focalisa d’abord la discussion.
En 1996 un rapport de Claude Evin, ancien Ministre de la Santé, devant le Conseil
Economique et Social, sur les droits de la personne malade, éclairait bien le nouveau courant de pensée : « le fondement philosophique de l’obligation d’informer est le droit de chacun à être traité dans le système de soins en Citoyen et en adulte responsable …Il s’identifie insensiblement aux droits du consommateur vis-à-vis des fournisseurs de soins et prestataires de services de santé » [2].
ORAGE SUR LA RELATION MÉDECIN- MALADE
Le coup d‘envoi de ce qui fut dans notre pays une véritable révolution dans les relations traditionnelles soignés soignants vint d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 25 février 1997. Statuant sur une recherche en responsabilité dans une affaire concernant une complication survenue au cours d’une ablation de polype du colon par colonoscopie. Cet arrêt Hédreul, dont le
Président Sargos fût le rapporteur [3], fait référence à l’ensemble des pratiques professionnelles de tous les débiteurs contractuels ou légaux dans une formule générale. Il précise que cette « assimilation de l’acte médical, résultat d’un assentiment aux soins proposés, au contrat passé avec n’importe quel fournisseur ou prestataire de service, s’inscrit bien dans l’évolution de la relation patient —médecin ramenée à celle d’un consommateur avec son fournisseur ».
Saisi d’une demande d’avis du Gouvernement sur le consentement éclairé des personnes qui se prêtent à des actes de soins et de recherches, le Comité Consultatif National d’Éthique, dans son rapport No 58 de juin 1998 y voit le passage d’une « ambiance de paternalisme, où il était entendu que le médecin décide plus ou moins unilatéralement de ce que doit être le bien du patient, et l’impose, à une ambiance plus contractuelle, où le médecin tient compte de ce que le patient considère comme son bien, et négocie avec lui les modalités de son intervention ».
Par sa décision du 5-01-2000, le
Conseil d’État a choisi d’aligner sa position sur celle de la Cour de Cassation, soumettant ainsi les médecins hospitaliers aux mêmes obligations.
Dès lors, on ne saurait s’en étonner, s’amplifia le glissement vers ce qu’il est convenu d’appeler la judiciarisation de la médecine. La conséquence logique et immédiate en fût une modification de la relation traditionnelle médecin-malade.
La relation de confiance, l’assentiment du malade au traitement proposé par le médecin qui détient le savoir et prend sa décision au mieux de l’intérêt de son patient est perturbée. Une méfiance réciproque s’installe, celle du patient qui en vient à soupçonner le caché, celle du médecin tenté de voir en son patient un plaignant potentiel. On sait à quels excès cette attitude a conduit la pratique médicale aux
USA. Il faut aussi se souvenir que la société française avait été profondément marquée par l’affaire du sang contaminée (1985) dont elle n’était pas encore vraiment remise. Ses peurs bientôt réveillées par « la vache folle », exprimait de plus en plus fermement une exigence sécuritaire allant jusqu’à la formulation du « principe de précaution » mais aussi désormais d’une exigence indemnitaire .
LA LOI KOUCHNER DU 4-04-2002
C’est dans ces conditions qu’à l’initiative du Ministre de la Santé Bernard Kouchner le parlement français vota la loi 2002-203, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé » (le titre initial était « et à la démocratie sanitaire », ce que certains non sans humour, ni sans raison, avaient traduit par « et de démagogie sanitaire ») Son originalité qui ne manquait pas de courage, il convient de le remarquer, fut d’ajouter au projet de loi initial un titre IV intitulé « réparation des conséquences des risques sanitaires » qui précise « la procédure de règlement amiable en cas d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales ». Elle apporte
une solution longtemps attendue à l’indemnisation de l’aléa médical (les « événements indésirables »).
S’il apparaît clairement que la définition de telles procédures est bien du domaine de la loi, on peut s’interroger sur l’utilité qu’il y avait à y introduire une somme considérable de dispositions dont il n’est pas déraisonnable de penser qu’elles pouvaient ne pas relever de la loi. A la lecture de ce texte législatif, l’Académie nationale de médecine observait [4, 5] qu’y figurent comme droits des malades un grand nombre de règles telles que le devoir du médecin d’informer le malade, et l’exigence de son consentement aux soins proposés qui figuraient de longue date dans les textes réglementaires comme étant les devoirs des médecins .
Notre code de déontologie médicale, prévoyait en effet déjà en son article 37 « en toutes circonstances le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade » mais aussi plus généralement en son article 32 « dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science.
QUE VAUT UNE LOI SANS FINANCEMENT CORRESPONDANT ?
L’usager consommateur de soins devient d’autant plus exigeant vis-à-vis des prestataires de soins que ces exigences figurent dans les textes de loi comme des droits.
Mais elles sont d’autant plus difficiles, voire impossibles, à satisfaire que les décisions nécessaires à leur mise en œuvre, notamment les moyens financiers correspondants ne sont pas prises ou toujours différées ou très insuffisamment accordés par la société elle-même qui, par ses représentants au Parlement, fixe dans une loi de finance le budget de l’assurance maladie et de la protection sociale. En voici deux exemples démonstratifs.
La loi DMOS no 95-116 du 4-2-95 art.31, dite Loi Neuwirth, prévoit : « les établissements de santé mettent en œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu’ils accueillent ». La Loi no 99-477 du 9 juin 1999 est intitulée « loi visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs ». Sept ans après le vote de cette loi, les moyens financiers correspondants ne sont pas votés par le Parlement. Le médecin ne peut que déplorer la difficulté qu’il rencontre à faire ce qui, en ce domaine, est « son devoir envers les patients » bien précisé dans l’article 38 du code de déontologie médicale qui stipule « le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage ».
Cette évidence n’avait pas échappé à notre ancien ministre de la Santé, Claude Evin, je lis dans son rapport déjà cité [2] : « Affirmer des droits, c’est bien, les faire vivre c’est mieux…. Il faudra certes que nous adoptions rapidement un texte de loi pour réaffirmer les droits des personnes malades. Au-delà de l’affirmation législative, je suis convaincu
que cette reconnaissance des droits des malades passera essentiellement par des changements de comportement et de culture, pour lesquels la loi ne saurait être suffisante ».
LA RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ NE S’IMPOSE PAS PAR LA LOI
Il faut reconnaître que dans notre pays, l’accumulation de textes législatifs successifs portant sur les droits des malades n’a pas conduit à une situation totalement satisfaisante. Les « changements de comportement et de culture » espérés se font attendre ou, à tout le moins ne vont pas dans le sens qui conviendrait. Une récente communication de l’Académie nationale de médecine fait état de l’augmentation considérable des plaintes de malades enregistrées par « les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation » (CRCI) crées par la loi de 2002 sur les droits des malades. Cette détérioration observée dans la relation duale de confiance entre le malade et le médecin, prouve bien que la relation soignant-soigné ne se décrète pas par des textes législatifs !
Cette revendication à l’égard du médecin est rarement exprimée dans la médecine de proximité , celle du médecin praticien mais est de plus en plus fréquemment exprimée dans le cadre de la médecine hospitalière .
MÉDECINE
DE
PROXIMITÉ,
UNE
RELATION
DUALE
ENCORE
CONFIANTE.
Cette médecine qui fut si longtemps celle du « médecin de famille », qualifié désormais de généraliste ou de médecin traitant , représente encore, il faut le rappeler plus des trois-quarts des actes médicaux. Pourtant, dans notre société de consommation cette médecine est dévalorisée, mon petit médecin de quartier ! Dés lors que sa pratique relève avant tout de la relation humaine obsolète, privée de l’aura de la technique et de la modernité ? Cette médecine au quotidien, faite d’écoute et de dialogue, n’exige pas moins de compétence, de bon sens clinique et de don de soi.
Elle n’est pas, elle non plus, exempte de risque et d’erreurs. Erreur de diagnostic, toujours possible, bien évidemment, mais dont il ne peut être tenu pour coupable s’il est de bonne foi. Plus souvent retard au diagnostic dans des situations difficiles ou inhabituelles. Prescriptions inadaptées de médicaments qui peuvent être cause d’accident iatrogène. Mais aussi surconsommation avec prescriptions abusives de médicaments, d’examens complémentaires inutiles, ou d’arrêts de travail. En fait, erreur ou faute rarement relevé e . Parce que survenue encore heureusement dans le cadre d’une relation duale, humaine, dont la confiance n’est pas exempte, qui comporte compréhension mutuelle et tolérance, voire indulgence, parfois jusqu’à l’excès . Cependant l’inscription dans la loi de la possibilité pour le patient en incapacité d’exprimer sa volonté, de faire appel à une personne de confiance de son
choix, n’évoque pas même la possibilité que le médecin traitant puisse se voir confier cette mission. Méfiance ?
MÉDECINE HOSPITALIÈRE, COLLECTIVE, TECHNICITÉ ET RESPONSABILITÉ DILUÉE
Les revendications le plus souvent d’inspiration indemnitaire s’ expriment essentiellement dans le cadre de la médecine hospitalière. Elle ne représente cependant qu’à peine 25 % des actes médicaux. Mais cette médecine met, aujourd’hui au service du malade, les possibilités fantastiques des progrès scientifiques et techniques.
On avait dit « d’Hippocrate au Scanner ! ». On en est aujourd’hui bien au-delà !
Mais en contrepartie de sa modernité, Cette médecine technique et scientifique est nécessairement collective, dépersonnalisée . En dépit des intentions vertueuses du texte de loi qui fixe les modalités du consentement, il n’est pas rare que le médecin auquel le malade a donné son consentement au traitement proposé soit celui qu’il verra le moins, le plus rarement, durant son séjour au cours duquel il passe de visage en visage, de main en main, jusqu’alors inconnues et souvent encore anonymes.
Mais aussi devenu consommateur d’une médecine qui ne se contente plus de diagnostiquer, (encore que les progrès de l’imagerie et de la biologie en accroissent chaque année les possibilités, donc le succès et les exigences), mais est attendue comme une médecine curatrice, qui traite, répare, corrige, remplace, qui séduit et enivre dans le tourbillon de la modernité, de la surinformation médiatique, mais aussi qui illusionne, jusqu’à créer l’illusion de sa totale fiabilité, du succès certain et du risque zéro !
DROIT À LA SÉCURITÉ OU DROIT À LA SANTÉ ?
DROIT AUX SOINS OU DROIT À LA SANTÉ ?
En même temps qu’il se comporte en consommateur de technologies, l’usager exprime ses exigences sécuritaires voire indemnitaires en cas de résultat insuffisant ou d’événement indésirable. Ces attitudes relèvent souvent de la confusion entre droit à la sécurité et droit à la santé comme entre droit aux soins et droit à la santé , mais aussi de la confusion entre « droit de … » ce qui signifie faire « ce que la loi n’interdit pas » et « droit à … » qui recouvre des revendications à l’obtention de biens matériels ou immatériels.
Des faits récents touchant à la médicalisation de la reproduction qui, à l’évidence, n’est pas une maladie !
Des exigences formulées autour de la naissance ont nettement fait apparaître, en France, les dangers de cette confusion. Le risque de dérive existe, entretenu voire créé par une surabondance de textes qui surajoutent les uns aux autres des droits de la personne sans jamais y associer ou même seulement y faire référence, les devoirs de l’individu tant en tant que personne autonome qu’en tant que citoyen.
LA COMPLÉMENTARITÉ DES DROITS ET DES DEVOIRS
Concernant la santé, l’homme n’a-t-il que des « droits à… » n’a-t-il pas aussi les « devoirs de … » à commencer par exercer sa propre responsabilité vis-à-vis de sa propre santé par des attitudes de prévention mais aussi responsabilité vis-à-vis des autres qui doit se traduire par l’entraide et la solidarité ? Cette nécessaire complé- mentarité des droits et des devoirs , ne devrait-elle pas être le fondement d’une nouvelle culture de notre médecine européenne ? Il n’est peut-être pas inutile de rappeler les termes de la
Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe , qui concluait la consultation européenne sur les droits des patients réunie sous l’égide du Bureau régional de l’ OM pour l’Europe à Amsterdam en mars 1994.
Cette déclaration prend en compte tant le point de vue des dispensateurs de soins que celui des patients. Elle donne du patient la définition suivante « personne, malade ou non, ayant recours aux services de santé », ce qui inclut donc ce que l’on peut appeler les bien portants de la société, c’est-à-dire la société toute entière évidemment faite de malades potentiels. On inclut donc sous ce vocable les « usagers » de plus en plus souvent regroupés en associations « de consommateurs », qu’il convient de distinguer des « associations de malades » regroupés en fonction de leur maladie et qui sont les partenaires irremplaçables des médecins dans la prise en charge de leur maladie chronique.
« les patients ont des devoirs tant envers eux-mêmes, pour les soins qu’ils peuvent se prodiguer qu’envers les dispensateurs de soins, et ceux-çi ont la même protection de leurs droits que toute autre personne …
« La formulation des droits des patients favorisera chez les individus une prise de conscience de leurs responsabilités, qu’ils demandent, reçoivent, ou prodiguent des soins, ce qui instituera dans les relations patients/soignants un climat de confiance et de respect mutuel ».
Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe, Amsterdam mars 1994
On ne saurait mieux dire ! Observons que la Suède est l’un des pays européens qui n’a pas jugé nécessaire de légiférer sur les « droits des malades ». Ils bénéficient en effet du « consensus social » auquel nos voisins nordiques sont si profondément attachés.
Confiance et respect mutuel ! Comment pourraient-ils être du domaine de la loi ?
*
* *
On ne peut demander à la loi de tout prévoir et d’apporter la solution à tous les besoins individuels formulés comme des droits en matière de besoins individuels de
santé. Non seulement la loi, par définition, ne peut être que générale mais aussi elle ne sert à rien si la société ne se donne pas les moyens de l’appliquer.
Les droits des malades ne se résument pas à l’expression de la légitime prise en compte des besoins matériels nouveaux créés par leur maladie, dans un concept « marchand », et du « chacun pour soi ».
A ces droits devrait faire écho l e devoir de solidarité des citoyens , c’est-à-dire de la société toute entière évidemment faite en majorité de bien portants qui n’en sont pas moins tous des malades potentiels.
Par contre la loi peut être utile et devenir nécessaire pour adapter la législation générale aux situations nouvelles, conséquence des profondes évolutions de la médecine sur la société. J’en citerai quelques exemples :
— La loi sur le handicap (loi no 2005-102 du 11 février 2005) Elle vise particulièrement le droit au travail des personnes handicapées, et l’accessibilité des édifices publics aux personnes en fauteuil. Mais aujourd’hui, le handicap est aussi celui des personnes âgées dont les besoins — formulés comme des droits — appellent d’autres dispositions, qui relèvent plus du bon sens de chacun que de la loi.
— La loi relative à la fin de vie (loi no 2005-370 du 22 avril 2005) aborde très justement les situations nouvelles de la « fin de vie » résultant des progrès et possibilités offertes par les techniques de réanimation, mais aussi celles qui résultent de certaines situations extrêmes en rapport avec le grand âge. Pour la première fois, à ma connaissance, cette nécessaire prise en compte des droits et des devoirs des soignés et des soignants y apparaissent clairement dans la brièveté et la précision de seulement quatre articles. Deux concernent le patient, deux concernent le médecin et pour chacun d’eux, un article traite des droits, l’autre des devoirs. Cependant, persistent quelques interrogations sur les difficultés d’application de la loi aux arrêts de vie dans certaines situations très individuelles et spécifiques de grande invalidité chronique en dehors de celles du grand âge.
— Un projet , récemment évoqué par le Président de la République, vise à modifier la législation en matière de prêts bancaires ou d’assurances , pour tenir compte de la situation nouvelles de nombreux malades guéris ou en très longue rémission de cancer ou d’affection à VIH qui s’en trouvaient jusqu’alors définitivement écartés en raison de leur maladie, aujourd’hui par eux heureusement surmontée.
CONCLUSION
Légiférer sur la relation malade-médecin est difficile et inutile [6]. La relation soigné- soignant comme la relation malade-bien portant n’est pas affaire de loi. On ne saurait réduire dans quelques articles de loi la singularité de chaque personne et plus encore de chaque personne malade. La médecine n’est pas un produit de consommation. La relation soigné soignant n’est pas du domaine commercial, et ses modalités ne peuvent être fixées de manière réglementaire.
Au-delà de ses droits, ce qu’attend la personne malade, ce n’est pas l’intervention d’un prestataire de service pour une fourniture ou une réparation standard. Quand
bien même il lui reviendrait, de par la loi, ayant été dûment informé, de consentir au soin proposé ou de le refuser, quand bien même il aurait l’assurance que le médecin ayant aujourd’hui renoncé à toute attitude « bienveillante et paternaliste » lui offre désormais « un partenariat ». Il n’en attend pas moins une relation humaine [7].
La relation malade-médecin est une question d’éthique. Or l’éthique ne peut être normative. Cette relation relève de l’humanisme . Or l’humanisme si profondément inscrit dans notre culture ne se décrète pas, pas plus que la loi ne peut le déclarer obsolète.
REMERCIEMENTS
A Jacques HUREAU pour sa contribution à la documentation BIBLIOGRAPHIE [1] PELLERIN D. — Médecine du XXIe siècle : consumérisme ou humanisme ?
Bull. Académ. sciences et lettres Montpellier , 2000, 31 , 180-190.
[2] EVIN Cl. — Les droits de la personne malade. Rapport 196/6-12-06-96
C.E.S-Paris FRA [3] SARGOS P. — CC. 1° civ. arrêt du 25 février 1997
Gazette du Palais , 27-29 avril 1997, p. 22-7.
[4] PELLERIN D. — Étude du projet de loi dit de modernisation du système de santé (Rapport au nom de la Commission XV), Bull. Acad. Natle Méd ., 2001, 185 , no 7, 1345-1354.
[5] PELLERIN D. — Sur la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (Rapport au non de la Commission XV), Bull. Acad. Méd ., 2003, 187 , no 5, 997-1000.
[6] MANTZ J.M. — L’importance de la communication dans la relation soignant-soigné (Rapport au nom de la Commission XV, et d’un groupe de travail), Académie nationale de médecine (séance du 20-06-06) à paraître dans Bull. Acad. Natle Méd ., 2006, 190 , no 9.
[7] PELLERIN D. — À propos du rapport Cordier : éthique et professions de santé. Médecine et Humanisme (Rapport au nom de la Commission XV), Bull. Acad. Natle Méd ., 2004, 188 , no 3, 539-546.
* Professeur Denys PELLERIN, président de l’Académie nationale de médecine (France)
Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 9, 1871-1881, séance du 16 mai 2006