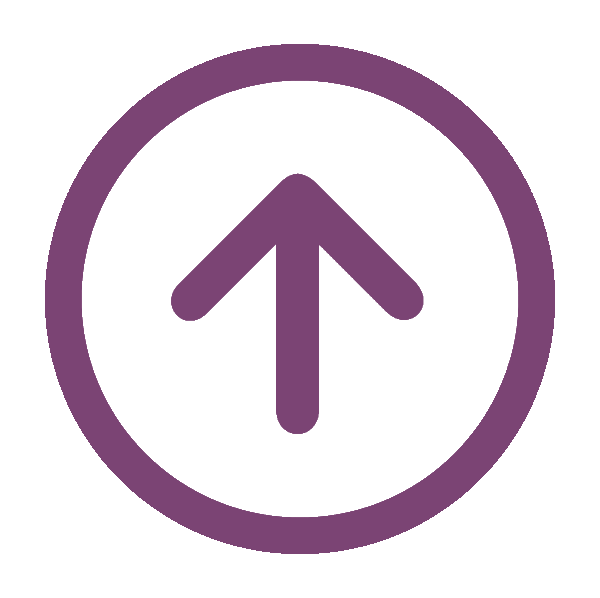Résumé
La méthodologie d’évaluation des produits médicamenteux est aujourd’hui bien établie. Elle repose, d’une part sur des études scientifiques réalisées en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché et, d’autre part sur des études moins rigoureuses méthodologiquement visant à évaluer l’effet des produits en situation réelle de prescription dans un système de soin donné. Des progrès sont à attendre pour réduire le différentiel méthodologique entre les deux perspectives. Dans le domaine des médicaments antipsychotiques, ces progrès devraient porter en premier lieu sur la définition des critères d’efficacité. Des travaux récents montrent en effet que des améliorations symptomatiques peuvent entraîner un meilleur « insight » qui à son tour peut augmenter le niveau d’exigence du patient. Il peut en résulter une stagnation de la qualité de vie perçue. Les essais randomisés ne permettent en outre qu’une médiocre transposabilité de leurs résultats à la pratique clinique quotidienne. Des études d’épidémiologie évaluative, rigoureuses sur un plan méthodologique et réalisées par des organismes indépendants doivent être encouragées.
Summary
The methodology for evaluating medicinal products is now well established. It is based partly on scientific studies provided in support of marketing application, and also on less rigorous ‘‘ real-life ’’ studies conducted in a specific healthcare system. The gap between these two methodological perspectives needs to be reduced. In the case of antipsychotic drugs, what is needed most is a better definition of endpoints for efficacy. Recent studies show that symptomatic improvements may enhance patients’ insight and, in turn, increase their expectations, with a resulting stagnation of their perceived quality of life. The results of randomized trials are difficult to extrapolate to everyday clinical practice. Epidemiological studies with strict methodologies and conducted by independent bodies should be encouraged.
INTRODUCTION
Les médicaments antipsychotiques sont un élément essentiel de la prise en charge des patients atteints en particulier de trouble schizophrénique. L’évaluation de l’efficacité de ces médicaments est actuellement très codifiée. Après des études précliniques (modèles moléculaires, cellulaires ou animaux), les industriels testent les produits chez l’humain : le paradigme incontournable est ici l’essai randomisé contrôlé. Les contraintes méthodologiques sont très strictes, elles sont édictées pour l’essentiel par un consortium international (Etats-Unis, Europe, Japon) regroupant autorités de santé et firmes pharmaceutiques : le projet ICH (International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use). Les résultats sont alors synthétisés et proposés aux agences du médicament (pour l’essentiel Américaines, Européennes et Japonaises) ;
si l’examen du dossier est positif le produit reçoit son « autorisation de mise sur le marché » (AMM). L’obtention d’une AMM est donc un exercice très codifié qui produit des données d’évaluation scientifique récoltées le plus souvent à l’échelon international. La question se pose aussitôt de la transposabilité de ces données à l’échelon national, étape cruciale car déterminant souvent le niveau de prix du médicament. En France, l’efficacité potentielle de nouvelles entités pharmaceutiques en situation réelle de prescription est appréciée par la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) avec l’aide d’un groupe important d’experts. Les vingt membres votants nommés notent la valeur thérapeutique ajoutée (Amélioration du Service Médical Rendu) du médicament de un (amélioration majeure) à cinq (aucune amélioration). Cette notation est immédiatement utilisée par le Ministère de la Santé pour aider à déterminer le prix et le taux de remboursement de ce médicament.
On voit ici à quel point l’évaluation des produits de santé est actuellement clivée :
très scientifique et internationale pour l’obtention de l’AMM, elle est au contraire très clinique et intuitive pour l’obtention du prix et plus généralement pour l’évaluation de l’efficacité du produit en situation réelle de prescription (tout au moins en France). De toute évidence, des progrès méthodologiques doivent être réalisés dans ce domaine.
Nous allons maintenant voir dans cet article les principaux éléments méthodologiques devant être abordés lors de la mise sur pied d’un protocole d’évaluation d’un traitement antipsychotique. Nous conclurons par les changements que l’on pourrait imaginer pour améliorer le système existant actuellement.
DÉFINITION DES TRAITEMENTS À COMPARER
Contrairement à ce que l’on pense souvent, la définition des traitements à comparer pose souvent problème dans les essais cliniques, y compris en médecine somatique :
en cancérologie par exemple, les pratiques de références ne sont pas toutes consensuelles, doit-on comparer un nouveau produit à une première, deuxième, troisième ligne de chimiothérapie(s), et à quelle posologie ? Doit-on associer au médicament une radiothérapie ou une chirurgie ?
Pour une thérapeutique antipsychotique, la question prend souvent la même allure.
Quelle posologie utiliser (la posologie optimale du traitement de référence peut ainsi varier d’un pays à l’autre) ? Quels traitements peut-on associer (antidépresseur, anxiolytique, coprescription d’antipsychotique, voire sysmothérapie) ? Homogé- néiser les schémas thérapeutiques permet certes d’augmenter la puissance statistique mais souvent au prix d’une moindre pertinence clinique des résultats. Nous verrons dans une section suivante que la réalisation d’études d’épidémiologie évaluative peut être une réponse intéressante à ce dilemme.
DÉFINITION DES CRITÈRES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION
Cette question renvoie à la notion de phénotype clinique, de maladie. On remarquera à ce propos que la nature catégorielle des phénotypes ou des maladies n’est pas une évidence ; en effet, les processus physiopathologiques sous-jacents aux maladies obéissent souvent à une logique dimensionnelle. Il en est d’ailleurs de même pour de nombreux troubles : l’asthme, la dépression, l’arthrose de hanche peuvent être considérés avec une gradation d’intensité. Cela peut se concevoir également pour des pathologies cancéreuses, où les formes in situ , voire les simples dysplasies, peuvent être considérées comme d’intensité intermédiaire.
En fait, c’est la thérapeutique, et non la physiopathologie, qui a dicté le caractère catégoriel des maladies. Si, dans l’arthrose de hanche, on peut envisager un continuum d’intensité de la pathologie (correspondant à un continuum de destruction du cartilage), la décision de poser une prothèse totale de hanche ne pourra être, elle, que binaire, donc catégorielle. Ainsi, c’est dans le but de faciliter l’opérationnalisation de la décision thérapeutique que la nosographie médicale est construite sur la base de catégories.
La caractérisation des maladies, la définition de critères diagnostiques est une tâche qui passionne les psychiatres et l’on dispose aujourd’hui de systèmes critériologiques opérationnels, sinon consensuels. On pensera par exemple à la Classification internationale des maladies (CIM) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
L’ American Psychiatric Association a élaboré, quant à elle, un Diagnostic and
Statistical Manual (DSM) lui aussi très utilisé.
Si ces systématisations manquent souvent de finesse dans l’explicitation des tableaux cliniques, elles ont la vertu d’homogénéiser les diagnostics et sont de ce fait très utiles pour la recherche. Cela a été tout particulièrement vrai dans le domaine de la schizophrénie. Qui plus est, ces classifications internationales bénéficient généralement d’un minimum de validation expérimentale, sur la base d’une bonne homogénéité des patients au sein des catégories diagnostiques choisies et d’une capacité discriminante intéressante en termes de choix thérapeutique et de pronostic.
Les classifications doivent cependant éviter le piège de l’excès d’académisme. Les noms des maladies sont en effet non seulement utilisés par les acteurs de la recherche clinique et épidémiologique, mais aussi par les médecins praticiens et par les citoyens.
Il est indispensable que ces derniers ne perdent pas complètement leurs repères à l’occasion d’une évolution de la nosographie. À ce sujet, la notion de psychose, sous jacente au terme « antipsychotique », est problématique : elle continue en effet à être utilisé par les praticiens et parfois par les médias alors que l’on a assisté à la quasi disparition des notions de névrose et de psychose dans le DSM.
Revenons maintenant à notre question : quels progrès doit-on attendre dans les études d’évaluation des antipsychotiques ? Nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, les critères du DSM ont été un progrès incontestable car ils ont permis une homogénéisation du concept de schizophrénie au plan international. Des questions sont cependant d’une actualité brulante. — Doit-on associer à la sémiologie traditionnelle des marqueurs génétiques ou des épreuves cognitives ? Il est fort probable que ce sera le cas dans quelques dizaines d’années, cela permettra notamment de gagner en homogénéité et donc en puissance statistique pour démontrer des différences entre traitements. Cela est peut être encore prématuré pour les toutes prochaines années. — Doit-on envisager un continuum entre troubles de l’humeur (trouble bipolaire notamment) et trouble schizophrénique ? Cette interrogation est importante en termes psycho et physiopathologiques ; elle l’est peut être moins en ce qui concerne la méthodologie d’évaluation des antipsychotiques. — Le diagnostic de schizophrénie doit-il impérativement reposer sur des critères internationaux évalués avec rigueur ? Oui si l’on veut gagner en puissance ; non si l’on souhaite pouvoir généraliser les résultats à la pratique de soin quotidienne (cette pratique ne reposant pas, en France, sur le recours à des critères stricts). Ici aussi il y a une tension entre la nécessité d’une évaluation scientifique réalisée en vue de l’obtention d’une AMM et la nécessité d’une évaluation plus pragmatique, réalisée en vue du remboursement à l’échelon national.
LA DÉFINITION DES CRITÈRES D’EFFICACITÉ
Actuellement, les critères d’évaluation des médicaments antipsychotiques reposent essentiellement sur des échelles dimensionnelles symptomatiques. Cela est légitime car les symptômes sont par définition en rapport avec la plainte des patients, or, depuis Georges Canguilhem, l’art médical est par essence la réponse à une demande [1]. D’autre part, la sémiologie psychiatrique résulte de la lente sédimentation d’une expérience clinique plus que millénaire (les grecs proposaient déjà des descriptions cliniques de leurs patients psychiatriques) [2]. Cette approche symptomatique de l’évaluation peut cependant être critiquée, en particulier dans le domaine de la schizophrénie. En effet, les patients présentant une symptomatologie négative (déficitaire) sont souvent à l’origine de peu de plaintes alors que leur besoin d’une prise en charge médicamenteuse adaptée est bien réel.
Des approches alternatives sont donc nécessaires. On trouve actuellement :
— des mesures d’impression clinique globale (CGI pour clinical global impression) : relevant d’une perspective plus phénoménologique que sémiologique elles capturent le patient dans sa globalité, mais sont plus difficilement interpré- tables et ont vraisemblablement un moins bon accord interjuge ;
— des mesures de fonctionnement : intéressantes car en relation directe avec la vie du patient, elles pâtissent cependant d’une faible sensibilité au changement ;
— des mesures cognitives : intéressantes sur un plan théorique et possiblement pour leur sensibilité au changement, elles présentent cependant une pertinence clinique plus discutable.
Les mesures de qualité de vie suscitent un intérêt croissant dans le domaine de la schizophrénie. Le concept est difficile à capturer mais d’une part il permet d’obtenir l’avis du patient lui-même (alors que les échelles symptomatiques de référence sont généralement remplies par le clinicien) et, d’autre part il permet de proposer une vision démédicalisée de l’état du patient.
Un instrument récemment développé a permis de mettre en évidence une relation complexe entre l’évolution de l’intensité symptomatique de patients schizophrènes et l’évolution de leur qualité de vie. Cet instrument, l’OPS (pour Outcome revealed by Preference in Schizophrenia [3]), est construit sur les bases de la théorie de Calman de la qualité de vie c’est-à-dire qu’elle est définie comme la différence entre les attentes d’un patient et ce qu’il estime être sa position dans la vie. L’OPS a été construit à partir de la biographie de seize patients schizophrènes recruté pour l’hétérogénéité de leur niveau de gravité. Ces seize biographies ont été classées par ordre d’acceptabilité croissante par un groupe de patient. Finalement, six vignettes d’une demi page ont été constituées à partir des biographies qui étaient perçues de façon consensuelles comme ayant des niveaux croissant d’acceptabilité. Une de ces vignettes est par exemple :
« Mr C. a trente ans. Il se considère comme un artiste des rues. Il fréquente beaucoup les cafés de sa ville où il rencontre beaucoup de gens. Il a toujours eu de nombreuses « petites amies » sans que des relations durables puissent s’établir. Il supporte d’ailleurs très mal les contraintes, notamment celles des relations intimes. Il lit et réfléchit dans des champs très ésotériques, ce qu’il appelle son activité philosophique. Son projet est d’écrire des chansons. Il a une sœur qu’il voit de temps en temps mais qui n’est pas très présente. Il vit d’une allocation d’adulte handicapé et possède un appartement et des biens légués son père et qui sont gérés par un curateur. Il a toujours refusé de prendre un traitement, ne se sentant pas malade.
Dans les moments de « crises », il est hospitalisé, souvent contre son grè. Il prend alors un traitement qu’il arrête très vite après. Ses hospitalisations sont parfois très rapprochées et très longues. Elles sont en général liées à des troubles du comportement, des actes peu compréhensibles et une grande agitation ».
Les six vignettes sont proposées une première fois au patient, ce dernier doit indiquer alors si elles correspondent à une vie : « Pas acceptable du tout », « Peu acceptable », « Assez acceptable » ou « Acceptable ». Le score total, obtenu à partir de la somme des réponses aux six vignettes, correspond à un score d’attente par rapport à la vie. Les six vignettes sont proposées une seconde fois et le patient doit ici indiquer si elles correspondent à une vie : « Beaucoup moins acceptable que la sienne », « un peu moins acceptable que la sienne », « Un peu plus acceptable que la sienne », « Beaucoup plus acceptable que la sienne ». Le score total correspond ici à un score de position par rapport à la vie. Le deuxième score diminué du premier est, selon la théorie de Calman, un indicateur de qualité de vie.
Cet instrument a été validé [3] et utilisé dans une étude clinique [4] sur des patients schizophrènes ayant un score de PANSS supérieur à 48, candidats à un changement de traitement, sans hospitalisation ni admission d’urgence dans les trois derniers mois. 306 patients ont été suivis un an et évalués à trois reprises (entrée de l’étude, six mois et un an). Dans une analyse de variance sur mesures répétées (modèle mixte incluant également un effet « temps » ainsi qu’un terme d’interaction), il a été démontré que le score total de la PANSS était associé négativement au score d’attente (quand les symptômes diminuent, les attentes augmentent), le score total de la PANSS était également associé négativement au score de position par rapport à la vie (quand les symptômes diminuent, la position dans la vie d’améliore), mais que le score total de la PANSS n’était pas associé au score de qualité de vie (différence des deux scores précédents) : une amélioration symptomatique n’est donc pas associée à une amélioration de la qualité de vie, et ce du fait d’une augmentation du niveau des attentes du patient.
L’ensemble de ces éléments doit inciter à la plus grande prudence quant au choix des critères d’efficacité dans les études d’évaluation des antipsychotiques. L’avenir est sûrement à la multiplicité des approches : des études objectivant avec finesse le fonctionnement cognitif doivent être complétées non seulement par des études cliniques évaluant les symptômes mais également par des études s’intéressant à l’évolution du ressenti intime des patients.
LA COMPARABILITÉ DES DIFFÉRENTS GROUPES DE TRAITEMENT
Dans un essai thérapeutique, la comparabilité des groupes de sujets est traditionnellement garantie par le recours à la statistique ainsi que par l’attribution aléatoire des traitements à comparer. Ce tirage au sort, utile car il permet d’éliminer la quasi totalité des sources de bais, peut poser problème : — les patients et les cliniciens ne sont a priori pas neutres vis-à-vis des différentes modalités de prise en charge médicamenteuses, rien ne dit alors que l’efficacité d’un médicament attribué par tirage au sort (surtout s’il est prescrit « à l’aveugle ») soit comparable à l’efficacité d’un médicament donné en situation réelle de prescription ; — le tirage au sort impose de comparer un faible nombre de groupes de patients qui, par ailleurs, doivent être homogènes. Cela conduit souvent à contraindre la liberté de prescription du clinicien (en termes de co-prescription notamment) et nuit d’autant plus à la transposabilité des résultats ; — le tirage au sort peut rebuter les cliniciens et les patients, il peut ainsi rendre difficile l’inclusion des patients et mettre en péril la faisabilité des études d’évaluation.
Le tirage au sort n’est cependant pas indispensable. Des techniques de modélisation statistiques permettent de redresser les différences entre les groupes afin de la rendre comparables. Le développement assez récent de scores de propensions est à ce propos particulièrement intéressant [5].
CONCLUSION
L’évaluation d’une thérapeutique est toujours un problème complexe, qui ne possède, en médecine somatique comme dans le domaine des thérapeutiques psychiatriques médicamenteuses, aucune solution définitive. Le cas particulier des médicaments antipsychotiques soulève ainsi des problèmes à propos de la définition des produits à comparer ou à propos de la constitution des critères d’inclusion ou d’exclusion, ces problèmes ne sont cependant pas spécifiques. La question de la définition des critères d’évaluation est, elle, plus caractéristique. Elle invite à se pencher au plus près sur ce que doit être l’objectif fondamental d’un soin : réduire l’intensité des symptômes ? Améliorer le fonctionnement ? Améliorer la qualité de la vie ?…
Toutes ces facettes ont des limites. La notion même de satisfaction du patient, tellement mise en avant actuellement, peut être critiquée. John Stuart Mill, philosophe anglais de le fin du xixe siècle ne disait-il pas : « It is […] better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied » [6] ? Le traitement d’un patient souffrant de schizophrénie peut ainsi conduire à une amélioration de son insight et donc à le rendre plus critique par rapport à son état mental. Des éléments de preuve expérimentale vont d’ailleurs dans ce sens [4], certains travaux mettent par ailleurs en évidence une liaison positive entre le risque suicidaire et le niveau des attentes de ces patients [7].
L’approche actuelle de l’évaluation du médicament, basée sur un rituel bien réglé d’octroi d’AMM et de procédure de remboursement, ne permet pas de gérer un tel niveau de complexité. Il est possible d’envisager des progrès à moindre coût. Une évaluation de médicament antipsychotique pourrait ainsi reposer sur :
— des travaux précliniques et physiopathologiques (imagerie, études cognitives, etc.) permettant d’appréhender les mécanismes d’action du produit et ainsi d’anticiper les différentes facettes de son effet chez les patients ;
— des études randomisées réalisées sur des effectifs plus homogènes et plus limités que maintenant, reposant sur des échelles symptomatiques passées dans des conditions optimales (entretiens filmés et cotés par des spécialistes ne prenant pas part au soin par exemple). Ces études pourraient conduire à une AMM précoce et conditionnelle ;
— des études obligatoires d’épidémiologie évaluative réalisées en situation réelle de prescription, selon des standards de qualité, par des organismes indépendants.
Les effets des facteurs « posologie », « coprescription », « comorbidité », etc.
pourraient ainsi être étudiés, non seulement en relation avec l’intensité des symptômes mais également en relation avec des marqueurs de fonctionnement ou de qualité de vie. Nul doute qu’un dossier informatisé performant sera un atout considérable pour accompagner cette mutation.
Enfin, il faudra ne jamais oublier que dans le mot évaluation il y a « valeur », et que la science s’intéresse aux faits, parfois au sens, mais jamais aux valeurs qui relèvent traditionnellement du domaine de la morale. L’évaluation d’un médicament devra ainsi toujours rester, in fine , l’affaire d’humains s’intéressant au devenir d’autres humains que l’on appelle, ponctuellement, malades.
BIBLIOGRAPHIE [1] Canguilhem G. —
Le normal et le pathologique . PUF, 2005.
[2] Quetel C. —
Histoire de la folie : De l’Antiquité à nos jours . Tallandier, 2009.
[3] Falissard B., Bazin N., Hardy-Bayle M.C. — Outcome revealed by preference in schizophrenia (OPS): development of a new class of outcome measurements. Int. J. Methods Psychiatr.
Res., 2006, 15(3), 139-145.
[4] Wilson-D’Almeida K., Karow A., Bralet M.C., Bazin N., Hardy-Baylé M.C., Falissard B. — In Patients with Schizophrenia Symptoms Improvement can be Uncorrelated with Quality of Life Improvement. Submitted.
[5] Rosenbaum P., Rubin D. — (1983) The central role of the propensity score in observational studies for causal effect. Biometrika, 70 , 41-55.
[6] Mill J.S. —
Utilitarianism . University of Chicago Press, 1906.
[7] Siris S.G. — Suicide and schizophrenia.
J. Psychopharmacol ., 2001, 15(2), 127-135.
DISCUSSION
M. Henri LÔO
Merci d’avoir dénoncé l’inflation disproportionnée des exigences méthodologiques et d’avoir rappelé l’utilité des conditions réelles de prescription. A ce niveau, pourquoi n’investigue- t-on pas l’efficacité des associations d’antipsychotiques ? Actuellement, par exemple, l’association clozapine-ripiprazole est fréquemment utilisée dans les schizophrénies résistantes.
La principale raison est que ces études ne sont pas demandées pour obtenir une autorisation de mise sur le marché (où l’on demande le plus souvent des études contre placebo voire contre un comparateur actif), or aujourd’hui c’est l’autorisation de mise sur le marché qui consomme la plus grande partie de l’effort d’évaluation des thérapeutiques médicamenteuses.
M. Patrice QUENEAU
Je vous remercie d’avoir souligné les difficultés qui existent pour évaluer de nombreuses associations médicamenteuses. Ces difficultés étant liées notamment à la question du financement de ces études. Concernant les associations d’anti-psychotiques, il me paraît indispensable que leur évaluation fasse l’objet de financements publics (Inserm…), ceux-ci sont nécessaires pour au moins deux raisons, d’une part, l’absence habituelle de financements privés compréhensibles dès lors qu’il s’agit d’associations de molécules produites par des firmes pharmaceutiques différentes, voir compétitives, d’autre part de tels financements publics conféreraient une valeur d’indépendance supplémentaire à de telles études. Qu’en pensez-vous ?
Je suis tout à fait d’accord.
M. Jean-Pierre OLIÉ
Vous avez cité une étude française de pharmaco-épidémiologie menée avec le médicament antipsychotique, Risperdal consta*. Le critère de jugement étant le nombre de réhospitalisations, s’agit-il d’une étude « d’efficacy, d’effectiveness, ou d’efficiency » ?
Il s’agit d’un critère classiquement d’un critère d’effectiveness. Même s’il est vrai qu’une part importante de la prise en charge de ces pathologies réside dans les réhospitalisations.
Mme Monique ADOLPHE
Si vous allégez trop les AMM, ne pensez-vous pas que le problème des effets secondaires devienne encore plus dangereux pour nos sociétés qui recherchent une totale absence de risque ?
Oui, cette remarque est essentielle. J’ai dit dans ma présentation que les AMM devraient être systématiquement conditionnelles. J’aurais dû ajouter qu’elles devraient être dans un premier temps circonscrites à des centres experts (par exemple) dans lesquels seraient réalisés des études de pharmaco-épidémiologie.
Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 3, 595-603, séance du 2 mars 2010