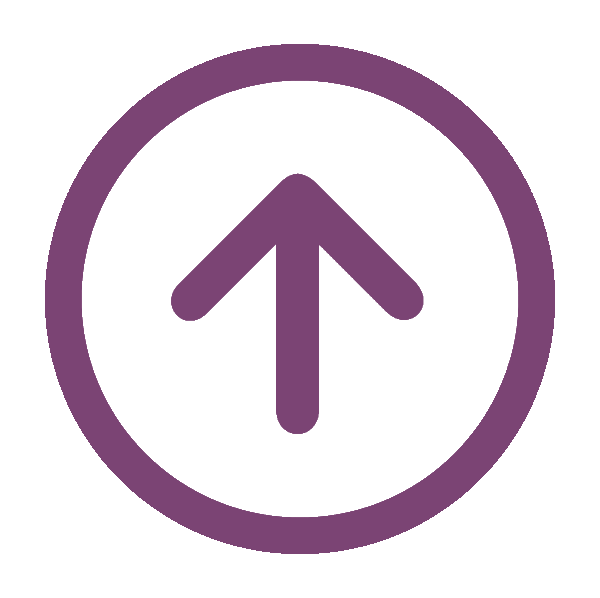Résumé
De l’ionien d’Hippocrate à l’anglais scientifique, quelques moments clés.
Summary
From ionian Greek, used by Hippocrates, to scientific English, some key-moments.
INTRODUCTION
L’envahissant prestige de l’anglais scientifique en médecine, comme d’ailleurs dans bien d’autres branches du savoir, est-il une fatalité contre laquelle il est impossible de se défendre, ou une mode qui passera ? Les leçons de l’histoire peuvent nous aider à comprendre ce phénomène, avec notamment la naissance de la littérature médicale en ionien, les efforts linguistiques des médecins romains, les thèses de médecine en latin jusqu’au premier tiers du XIXe siècle, le problème de la langue de traduction des
textes médicaux grecs, tel que se le posent les médecins érudits au milieu de ce même siècle.
Naissance de la langue scientifique de référence : un dialecte grec, l’ionien
Ce n’est pas « en grec » mais dans un dialecte grec que s’écrivent d’abord l’histoire, la philosophie, les sciences et la médecine occidentales : le dialecte ionien, dialecte de l’Ionie, littoral d’Asie mineure de Phocée à Milet. Pour la médecine, ce passage à l’écriture est un grand changement, dû à un élargissement de la clientèle potentielle des malades et donc à la nécessité de former des médecins en dehors du cadre strictement familial par le seul apprentissage. Or Hippocrate est un Dorien de Cos ;
pourtant il écrit pour ses élèves dans le dialecte ionien. Pourquoi ? Parce qu’avant lui, comme des savants ioniens avaient écrit tout naturellement en leur langue, « cette habitude se perpétua (écrit Littré à la page 479 de son volume d’introduction aux Œuvres d’Hippocrate publié en 1839)… C’est de ce dialecte que se sont servis
Anaxagore, Parménide, Démocrite, Mélissus, Diogène d’Apollonie. Il ne faut pas chercher d’autres raisons de la préférence que le Dorien Hippocrate donna à l’ionien ».
Son ionien, sans doute, n’était pas aussi pur que celui d’Hérodote, mais suffisamment tout de même pour que rapidement, avec le triomphe littéraire de l’attique, sa prose eût besoin d’être parfois expliquée, par Bacchius et plus tard par Galien dans ses commentaires, ou normalisée c’est-à-dire atticisée, comme par Artémidore Capiton, premier éditeur de la collection hippocratique.
Mais l’impact des écrits du maître de Cos est tel que ce dialecte devient une langue de référence et de prestige pour tous les médecins. Il est parfois difficile de comprendre si c’est par nécessité ou par mode : Arétée de Cappadoce (Ier siècle de notre ère), qui professe la doctrine pneumatique, très différente de la doctrine humorale du maître de Cos, n’a pas expliqué pourquoi il écrivait néanmoins dans la langue d’Hippocrate ; il est vrai qu’il s’empêtre parfois, nous laissant une œuvre géniale par bien des aspects, mais très difficile à comprendre 1. Mais le pli était pris : la médecine pouvait sans doute s’écrire aussi en d’autres dialectes grecs, mais elle avait pour langue de référence l’ionien d’Hippocrate.
Du grec au latin : une gageure pour les Romains, dirais-je un « challenge » ?
Changeons de continent et de siècle et passons en Italie romaine. Le latin ne fut pas d’emblée la langue de toute l’Italie antique, mais il le devint progressivement, les 1. Cf. DEICHGRÄBER K. — Aretaeus von Kappadozien als medizinischer Schriftsteller , Berlin, 1971 ; et
GRMEK M. D, —
Arétée de Cappadoce. Des Causes et des signes des maladies aiguës et chroniques , traduit par R.T.H. Laennec, éd. et comm. par MDG, préf. de Danielle Gourevitch, Droz, Genève, 2000.
habitants de Rome s’imposant de toutes les façons. Leur langue ne fut jamais la langue unique de l’empire romain, mais il en était la langue administrative (et, dans une certaine mesure seulement, la langue du savoir). Il n’a jamais été parlé partout et exclusivement dans l’Empire, mais chacun le connaissait du moment qu’il était tant soit peu en contact avec les dirigeants et les administrateurs.
En 142 avant J.-C., Corinthe est prise. Mais chacun sait que Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio (Horace, Ep . II, 1 , 156). Le vainqueur adopte la civilisation supérieure du vaincu. L’élite de l’Italie devint même bilingue et parla le grec ; ce qui ne se fit pas sans mal, les « vieux romains » (dont le porte-parole était Caton) ayant bien compris qu’il y avait là un véritable enjeu de civilisation. Les plus grands médecins d’époque romaine, Soranos, Galien, originaires d’Asie mineure, le premier d’Éphèse en Ionie, le second de Pergame en Mysie, s’installèrent à Rome, mais écrivirent tout de même en grec.
L’élaboration d’un latin médical a donc posé des problèmes particuliers, le grec restant très présent dans ce domaine 2. Cette élaboration ne s’est d’ailleurs pas faite de la même façon selon qu’il s’agissait d’un traité original ; d’une compilation encyclopédique 3 ; d’un commentaire, d’une adaptation, d’une traduction d’un ouvrage grec ; d’un abrégé simplifié ; d’un manuel de vulgarisation ; d’un caté- chisme par questions et réponses, et j’en passe. Mais quel que soit le type de l’ouvrage, il y faut latiniser le vocabulaire grec 4 par des copies de mots grecs avec des formules du type ut Graeci dicunt , des translittérations, des calques morphologiques ou sémantiques, des couples de doublets explicitant ensemble une notion difficile, des formules nouvelles (comme, pour l’épilepsie, celle de morbus maior pour éviter de parler de maladie sacrée comme faisaient les Grecs, ou de morbus comitialis , pour la situer dans le contexte politique romain), des ajouts de mots locaux (et pas seulement pour la botanique médicale), des dérivations, des compositions, des jeux étymologiques plus ou moins explicites, des métaphores nouvelles, des spécialisations de mots qui avaient jusque là un sens non médical (comme typhus ), des mots doctrinaux (en rapport par exemple avec les vues étiologiques de telle ou telle école), des noms géographiques (comme morbus Campanus , syntagme dont on ne sait d’ailleurs pas très bien à quoi il correspond). Cette importance croissante du nom donné aux maladies correspond à un effort de plus en plus poussé de découpage de la réalité nosologique. Et l’on voit bien par là que le problème de la langue médicale n’est pas un pur problème linguistique, mais est aussi fonction du savoir scientifique du moment, de l’apparition de maladies considérées comme nouvelles, des repré- sentations anthropologiques, des mentalités, de la société en général.
2. Auteurs divers — Le latin médical. La constitution d’un langage scientifique . Publications de l’Université de Saint-Étienne, 1991, ed. Sabbah G. (Centre Jean Palerne, Mém. X).
3. Auteurs divers — La Médecine de Celse. Aspects historiques, scientifiques et littéraires. Publ. de l’Un. de Saint-Étienne, 1994, ed. Sabbah G. et Mudry Ph. (Centre Jean Palerne, Mém. XIII).
4. Auteurs divers — Nommer la maladie. Recherches sur le lexique gréco-latin de la patho- logie, Publ. de l’Un. de Saint-Étienne, 1998, ed. Debru A. et Sabbah G . (Centre Jean Palerne,
Mém. XVII).
Effort linguistique admirable, extraordinairement créateur et conquérant, qui porte encore ses fruits aujourd’hui (nom latin de toutes les espèces végétales et animales, donc en particulier des microbes et bacilles par exemple), par rapport à une langue de référence qu’on cherche à égaler.
Le latin restera la langue des traducteurs et des adaptateurs tardifs en Occident, puis sera relayé par des savants orientaux, écrivant l’arabe, l’hébreu ou encore le syriaque. Ces traductions sont utiles aujourd’hui à la reconstitution de textes grecs originaux altérés, tronqués ou disparus, leurs manuscrits conservés étant parfois antérieurs aux manuscrits grecs que nous possédons. Puis l’Italie réclamera à nouveau du latin, ce que lui donneront les moines du Mont-Cassin, en particulier, qui retraduisent en latin les traductions arabes des textes grecs. Le latin est donc absolument indispensable à la connaissance de la médecine antique et de ses cheminements médiévaux. Il est devenu « incontournable ».
Du latin vivant au latin érudit : le stupide e
XIX siècle
Quand les langues nationales, qui n’avaient jamais été interdites, se raffermissent et deviennent des langues de culture, le latin subsiste dans des corps établis, et notamment les facultés. Quant au règne du latin médical, il s’est poursuivi jusqu’à l’époque moderne : on assiste donc sur une très longue durée à l’apparition, au perfectionnement, à l’évolution, à la fixation, voire enfin au gel tyrannique de ce langage scientifique.
Antonio Benivieni
Toutes les situations sont particulières, et l’évolution n’est pas linéaire. Rappelons par exemple, dans le domaine de l’anatomie pathologique, que le Florentin Antonio Benivieni, fondateur de cette discipline, se lance à la toute fin du XVe siècle dans la rédaction de son De abditis nonnulis ac mirandis morborum ac sanationum causis (publié après sa mort, en 1507), sous l’impulsion de la lecture de Celse dont vient de sortir l’ editio princeps , et que, sans nulle volonté de tromper mais aussi sans guillemets, il entrelace sa propre prose latine dans celle du Romain 5.
Le problème des thèses de Paris
À la faculté de médecine de Paris les thèses sont toutes encore écrites en latin en 1792. Beaucoup le sont toujours au XIXe siècle, privilège ésotérique, conservation jalouse des privilèges. En général, elles ne valent d’ailleurs pas grand chose, ce sont 5. GOUREVITCH D. — Le nozze del medico e di Filologia. Medicina nei Secoli , 1998, 10 , 227- 239.
des compilations non créatives. Examinons le cas de Prosper Menière 6, l’illustre médecin de l’Institution des sourds-muets après Itard. En 1829, pour son premier concours d’agrégation, devant Esquirol notamment, il présente une thèse latine intitulée Num epilepsia aliaeque convulsiones semper a lesione organica pendent ? Il n’est pas reçu. Le fait est qu’il s’agit là d’un morceau de bravoure qui affirme le credo à la mode : au symptôme sur le vivant doit correspondre le signe sur le cadavre.
L’auteur n’est pas allé aux sources sur lesquelles il prétend s’appuyer, et ce n’est ni un travail d’historien ni un travail scientifique, mais une épreuve initiatique dont le caractère rituel est accentué par l’obligation d’utiliser, tant pour le texte écrit que pour l’argumentation à l’oral, la langue latine, langue sans génie, scolaire, mais plus correcte, certainement, que n’est aujourd’hui l’anglais scientifique. Les Archives générales de médecine du 13 janvier 1827 (pp. 135-136) avaient déjà mis le doigt sur le problème à l’occasion de la fin du concours de cette année-là : « … Personne ne s’attendait à ce que l’argumentation dût avoir lieu en latin ; aussi les derniers exercices ont-ils été meilleurs que les premiers. Beaucoup de personnes ont blâmé l’usage du latin introduit dans l’argumentation ; d’autres auraient voulu qu’on attendît au moins quelques années avant d’exiger cette condition si difficile à remplir pour ceux qui ont quitté depuis longtemps les bancs du collège. Il est positif que sur 23 candidats inscrits, 9 ont cru devoir se retirer ». Le concours auquel participe Menière est le dernier à avoir lieu avec ces modalités, et quand notre auteur présentera une nouvelle thèse en 1837-38, cette fois pour la chaire d’hygiène, celle-ci sera rédigée en français.
Les traductions du grec et la querelle entre deux médecins érudits
Charles Victor Daremberg et William Alexander Greenhill entrent en relations épistolaires (bilingues) en 1844, se rencontrent en 1846 et d’emblée s’entendent très bien. Or Daremberg, médecin, bibliothécaire à l’Académie nationale de médecine puis à la Mazarine, a alors le projet de ce qu’il appelle Bibliothèque des médecins grecs et latins à propos de laquelle sont consultées par le ministre de l’instruction publique et des cultes les Académies des inscriptions et belles-lettres et de médecine.
En 1846, selon l’Académie des inscriptions, il est question de « meilleurs manuscrits », de « texte amélioré », de « traductions nouvelles », mais le silence est gardé sur la langue. En janvier 1847, dans une lettre à Greenhill, il semble aller de soi que la traduction sera française. En mars de la même année, le Français écrit : « J’ai bien pensé au latin, mais il y a bien des inconvénients. Et puis tous ceux qui profiteront de notre bibliothèque savent le français et comprennent le grec. Et puis les traductions en langues vivantes sont plus sûres, il y est plus tenu compte des difficultés que dans celles en langues mortes, surtout en latin qui se prête si bien à mettre le mot sous le mot ». Le 27 octobre, le rapport de l’Académie nationale de médecine rappelle que Daremberg « avait d’abord formé le dessein d’en donner une traduction française 6. GOUREVITCH D. — Prosper Menière et la culture antique. In LEGENT F. ed . Prosper Menière :
auriste et érudit (1799-1862) . Paris : Flammarion, 1999, 15-29.
complète ; mais ces ouvrages étant destinés aux savants de tous les pays, il a dû préférer le latin, qui est encore aujourd’hui une langue universelle, ou du moins celle qui est à l’usage de tous les savants ». En novembre 1847 est publié le « prospectus », c’est-à-dire un échantillon alléchant, effectivement avec traduction latine, de pages d’Oribase par le Hollandais francophone Bussemaker. Dans ce prospectus, pp. 35-36, on lit : « Dans le plan primitif de la Bibliothèque des médecins grecs et latins, tous les ouvrages devaient être traduits en français ; de graves considérations se sont élevées contre la réalisation de ce projet. Une pareille collection ne doit pas s’adresser seulement aux Français, mais à toutes les nations savantes. S’il est vrai que la langue française soit plus répandue qu’aucune autre langue vivante, il est également incontestable que le latin est d’un usage encore plus universel. Tous les médecins et tous les philologues (sic) avec lesquels j’ai l’honneur d’être en correspondance se sont accordés à demander que le texte grec fût accompagné d’une traduction latine ; j’ai accédé d’autant plus volontiers à cette demande que parmi les ouvrages compris dans la Bibliothèque, plusieurs n’ont d’intérêt véritable que pour les historiens ou les érudits de profession, et supporteraient même très difficilement une traduction française ».
Bref va pour le latin. Seulement, qui achètera cette traduction ? Masson et Baillière en ont discuté : les perspectives financières d’une traduction latine sont mauvaises, Daremberg devra bien l’avouer à l’Oxonien, qui, dans une lettre du 17 mars 1848, désapprouve absolument, refuse sa contribution et déclare n’accorder désormais qu’une aide personnelle. En 1851 paraît le volume I d’Oribase, avec traduction française. L’introduction, censée être la copie du « prospectus », a en fait été gravement modifiée, notamment p. XVVII-XLVIII : « On m’a fait à l’étranger des objections sérieuses contre une traduction française ; on aurait préféré une traduction latine. Á cela je dois d’abord opposer un argument sans réplique : ni les Académies auxquelles mon projet a été soumis, ni le Ministère de l’instruction publique n’ont approuvé une traduction latine, et mon honorable éditeur n’a consenti à publier la Collection qu’à la condition expresse d’une traduction française. S’il me faut dire ma pensée toute entière, je déclare que je suis très-partisan des traductions en langues modernes, les seules qui permettent de ne faire aucune espèce de compromis avec le texte, les seules qui offrent un secours vraiment efficace pour les passages embarrassants ». Il précise en note que c’est aussi l’opinion de Littré qui en 1839 commence à publier Hippocrate en langue vulgaire, en français, s’appuyant sur l’opinion de Grimm qui lui-même l’a traduit en allemand (I, p. X) : « à quoi servent des versions en langue vulgaire, puisqu’on en a tant en latin ? Qu’on se rappelle que la version latine est rédigée à son tour en une langue morte, qu’ainsi elle est doublement difficile à entendre, et qu’elle n’en reste pas moins une traduction…
Chaque nouveau traducteur porte, dans le latin, qu’il ne sait que comme langue morte, ses idiotismes particuliers, de sorte qu’il nous faudrait apprendre sa langue maternelle pour comprendre suffisamment son latin… En se laissant montrer le vieux médecin grec à travers un latin qu’on n’entend qu’à demi, on a à lutter à la fois contre l’obscurité de l’original et de la traduction ». « Grimm a raison », précise
Littré, et Daremberg aussi, en fin de compte, lui qui ne veut pas se cacher derrière les mots ; son sens du concret et du pratique lui interdit de fuir la réalité. Ses talents techniques l’aident dans sa traduction, et il considère que l’usage du latin aurait fait sur la réalité l’effet d’un filtre déformant 7.
Aujourd’hui. : mort du français ? Universalité de l’anglais ?
La querelle entre Greenhill et Daremberg a toujours son sens car un nouveau « latin » est né, qu’on appelle, bien à tort d’ailleurs, l’« anglais », nouveau langage, aussi artificiel, aussi éloigné de la réalité quotidienne, aussi mort que le latin des traductions au XIXe siècle. Qui parle en effet cette langue ? Ni les Français, ni les Allemands, ni les Italiens, ni les Japonais, ni, encore moins les Britanniques, car cet anglais des revues internationales et des congrès n’a pas grand-chose à voir avec celui de Shakespeare ni même avec l’élégant jargon snob d’Eton ou d’Oxford, c’est un anglais américain mais ce n’est pas non plus l’anglais d’Amérique ; et si les Américains sont sans doute capables de l’utiliser, eux-mêmes (ou du moins les meilleurs d’entre eux) ne sont pas à leur aise avec cette nouvelle lingua franca , si pauvre, si banale et si plate. Pourquoi, trop souvent, acceptons-nous de renoncer à notre langue maternelle 8 et de céder à cet usage mortifère ? Faut-il vraiment imposer l’anglais scientifique ?
Langue de création
Il importe en fait de distinguer langue de création et langue de diffusion. La première est celle de la science qui se fait, de la découverte, ou de l’appropriation complète par la traduction. Elle ne peut guère être pour chacun que sa propre langue, dont la richesse et les nuances sont acquises par l’apprentissage au berceau, ou à la rigueur à l’école maternelle. Alors elle peut être parfaitement maîtrisée, avec ces impondé- rables qu’on sent et qu’il est difficile d’expliquer : combien de fois le professeur le plus scrupuleux, à l’adulte étranger le plus scrupuleux aussi, doit-il dire : « écoutez, c’est comme ça ». Il y a des exceptions, et certains réussissent dans un certain champ à faire totalement leur une langue étrangère, et découvrent en cette langue, la pensée ne procédant pas de la même façon dans toutes. Rappelons un Privatdocent de psychiatrie à l’université de Moscou et une publication princeps qui devait faire date : « Étude médico-psychologique sur une forme des maladies de la mémoire », dans la Revue philosophique , alors dirigée par Théodule Ribot, 14e année, XXVII, juillet-décembre 1889, pp. 501-530. L’auteur était Korsakoff, la forme de maladie identifiée était le « syndrome de Korsakoff ». On ne verra probablement plus de tels cas dans notre langue.
7. GOUREVITCH D. — La traduction des textes scientifiques grecs ; la position de Daremberg et sa controverse avec Greenhill. Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France , 1994, 296-307.
8. LOCHAK G. — Réflexions sur le français. L’oubli des langues nationales conduit à une pensée plate, unique, stéréotypée, vers pas de pensée du tout. Le Figaro , 26 février 1999, p. 2.
Langue d’information
L’informatisation et la mondialisation de la recherche rendent indispensable un langage commun, et cette langue de bilan, de transmission des résultats ne peut évidemment être aujourd’hui que l’anglais d’Amérique, ce qui n’équivaut pas à en faire la langue universelle.
Notons bien que cet américain scientifique n’est imposé ni par la supériorité de l’Amérique ni par l’expansionnisme linguistique des Américains, arrogants souvent sans être impérialistes, mais par la veulerie et la démission suicidaires des européens : les Italiens vont peut-être encore plus loin que nous, et il m’est parfois arrivé de répondre à des collègues romains m’écrivant en anglais pour organiser un congrès en Sicile ou à Trieste : purtroppo, non parlo l’inglese .
En France
En France, on est en face d’un problème supplémentaire (qui n’existe pas, ou guère, en Hollande par exemple), c’est que les Français ne sont pas bilingues, ils ne savent pas l’anglais. Certes un ministre de l’Éducation nationale a osé dire que l’anglais n’était plus une langue étrangère. Il aurait mieux fait de dire, sans doute, que toutes les langues sont étrangères à ses élèves, pour lesquels le français lui-même est de plus en plus inintelligible, du fait de trente ans de démission de la part des enseignements primaire et secondaire associés pour cette destruction à la télévision et à ses dessins animés japonais parlant un « anglais » probablement mauvais et en tout cas impitoyablement mal traduit. Si l’ambition affichée par le pouvoir est d’étendre la connaissance de l’anglais, comment imagine-t-il que des « professeurs d’école », armés du seul savoir dispensé par leurs cours de pédagogie à l’IUFM, pourraient faire semblant d’enseigner une deuxième langue à un peuple qui perd rapidement l’usage de la sienne ?
Alors que faire ?
Devant servir au monde entier, la lingua franca est forcément simplifiée et pauvre, imposant platitude et conformisme. Donc les grandes langues doivent absolument se maintenir pour la recherche et la réflexion ; convaincue de la nocivité d’une parcellisation linguistique abusive, je ne crois évidemment pas à l’avenir scientifique du corse ou du galicien.
Un des aspects de la solution serait le renforcement de la connaissance du français à l’école ; nos ministres, malheureusement, ne semblent pas vouloir prendre ce chemin. Pourtant c’est seulement s’il maîtrise bien sa langue, que le chercheur pourra se plier aux exigences d’une autre. C’est à nous, membres des sociétés savantes et universitaires, d’être farouches et vigilants dans l’exercice de nos fonctions ; ce n’est pas être passéiste. Pour ce qui est de l’érudition médicale, rappelons que le Corpus medicorum graecorum , entreprise germanique, ne publiait autrefois que le texte
grec ; puis on a admis des traductions en la langue noble, alors l’allemand ;
aujourd’hui on admet le français et même l’italien, comme récemment pour deux importants ouvrages de Galien. Suivons la voie de la raison qu’ont adoptée les membres de cette prestigieuse entreprise. Relevons le gant, veillons à la qualité de l’enseignement littéraire en première année de médecine : apprenons enfin à lire à ces jeunes gens. Alors ils sauront plus tard écouter leurs malades. Alors ils seront réellement capables de posséder une seconde langue. Alors on ne sera plus obligé de faire l’obscurité pour passer des transparents où figure une demi-douzaine de mots anglais, d’ailleurs de racine latine ou grecque presque tous. Alors Nature ne sera plus obligé de tenir la plume de ses auteurs ! À ce que rapportait
La Recherche no 258, d’octobre 1998, p. 1054 : « Souvent on entend fustiger l’usage excessif de la langue anglaise en science. Mais s’agit-il d’anglais, et les scientifiques se comprennent-ils bien entre eux ? La célèbre revue britannique Nature n’en est pas tout à fait sûre.
C’est pourquoi elle envisage de procurer une aide rédactionnelle aux chercheurs qui publient leurs résultats dans ses colonnes », elle a déjà un bureau à Tokyo, ce qui aurait « facilité l’accès de cette publication à de nombreux chercheurs nippons ».
Alors, comme le grec avait été pour le latin une source immense d’enrichissement, l’anglais pourrait en redevenir une pour le français ; nous pourrions sortir de la situation d’infériorité volontaire, par une espèce d’auto-avilissement ou d’abjection, dans laquelle l’Occident est en train de se jeter avec délice. Permettez-moi une anecdote. Á Jérusalem, il y a quatre ans, lors d’un congrès d’histoire de la médecine intitulé From Athens to Jerusalem , on m’a demandé de parler anglais ; j’ai fait valoir que certes je pouvais le faire mais qu’il s’agissait d’un congrès international, dont le français était langue officielle, et que je choisissais de parler cette langue, la mienne.
Mon émotion a été grande de recevoir après la séance les félicitations touchantes de Juifs francophones du monde entier, heureux d’avoir enfin été débarrassés, l’espace d’une heure, de l’anglais obligatoire, mal prononcé par un orateur qui s’est fait traduire son « papier » tant bien que mal. Bref, nous avons le devoir de défendre et d’illustrer la langue française.
Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 8, 1529-1537, chronique historique