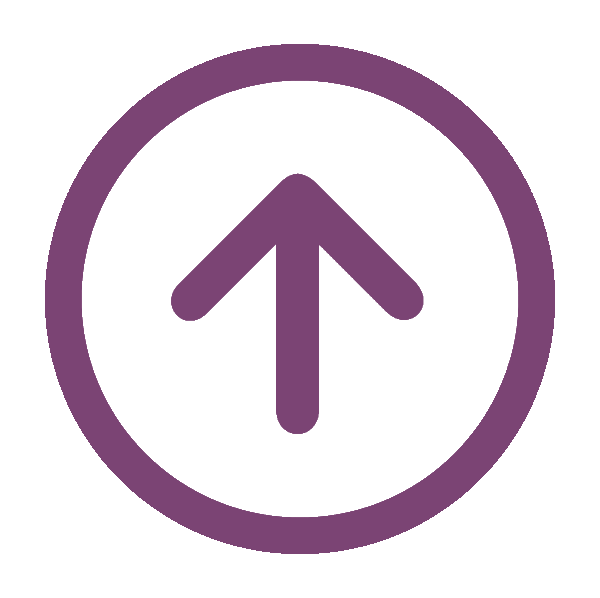La petite et la grande histoire du paludisme
Pierre AMBROISE-THOMAS *
Le paludisme : une des plus importantes, peut-être même la plus importante maladie à l’échelon mondial : cinq à six cents millions de malades, plusieurs millions de morts annuelles, le tiers de l’humanité menacé.
En évoquant devant vous la grande et la petite histoire de cette affection, mon propos n’est évidemment pas de vous infliger un cours de Parasitologie. Ce n’est pas non plus de prétendre faire œuvre d’historien. Je n’en n’ai absolument pas les compétences. Plus modestement, je voudrais tenter de rappeler ici combien la petite histoire accompagne et souvent éclaire la grande histoire, combien les découvertes, parfois les plus importantes, sont filles du hasard — le hasard dont il est vrai Pasteur disait qu’il ne favorise que les esprits préparés — mais aussi filles des nécessités, en particulier des nécessités militaires.
Je dois enfin avouer que mon but est aussi d’essayer de vous distraire et peut-être même, qui sait, de vous faire sourire car, après tout, il n’est pas absolument indispensable d’être triste pour être sérieux.
*
* *
Le paludisme est probablement une des plus vieilles maladies de l’humanité. On prétend même que l’homme préhistorique en était atteint. Dans la période historique, les Védas de l’Inde ancienne, le décrivent comme « la reine des maladies », une maladie attribuée à la colère du Dieu Shiva. Par la suite, plusieurs papyrus et différents monuments de l’Egypte ancienne font référence à une maladie associant fièvre, frissons et augmentation du volume de la rate. Dans la mythologie chinoise, le paludisme est décrit sous la forme de trois démons dont les deux premiers sont respectivement munis d’un marteau et d’un seau d’eau froide tandis que le troisième entretient un four brûlant. Ces trois démons rappellent évidemment des symptômes classiques de l’affection : céphalées, sueurs, fièvre. En Grèce, enfin, bien sûr, Hippocrate et Galien identifient des fièvres particulières dont ils soulignent la périodicité.
Au sein du vaste groupe des maladies fébriles, les premières individualisations du paludisme sont donc cliniques. Mais, dès le IIe siècle avant J.C., les grecs ébauchent
aussi une individualisation épidémiologique, en reliant le paludisme à la proximité de terrains marécageux. Ainsi s’explique l’étymologie des diverses dénominations de la maladie : paludisme vient en effet du vieux français palud, lui-même dérivé du latin palus et signifiant marécage ; malaria, la dénomination italienne adoptée aussi par les anglo-saxons, fait référence aux miasmes dont on pensait qu’ils occasionnent les fièvres.
Pendant plusieurs siècles, cette croyance justifie des mesures prophylactiques pour le moins originales, comme par exemple, le port autour du cou ou sur le bras gauche — les avis diffèrent suivant les auteurs — d’une araignée vivante emprisonnée dans une coquille de noix et qui était supposée absorber les émanations pestilentielles. Il est évidemment impossible d’apprécier l’efficacité de cette « arachnoprévention ».
Mais cette méthode devait avoir un certain renom et un apothicaire espagnol, Oliveira a même prétendu avoir préparé une « arachnidine », évidemment extraite d’araignées et à laquelle il prêtait de remarquables propriétés fébrifuges.
En fait, la première individualisation réelle du paludisme est d’ordre thérapeutique.
Traversons les siècles et les océans à la suite des conquistadores. C’est en effet au Pérou que, vers 1630, un missionnaire jésuite, Juan Lopez, est spectaculairement guéri des fièvres intermittentes par une poudre préparée à partir de l’écorce de l’ « arbre à fièvres », le quinquina. Le missionnaire informe du secret de sa guérison le gouverneur de la province. Celui-ci en informe à son tour le vice-roi du Pérou, le 4e comte de Cinchon dont la femme dit-on se mourrait des fièvres. La guérison de la comtesse assure la renommée de ce traitement, qui devient « la poudre de la comtesse ». En l’honneur de cette noble dame, Linnée baptise même Cinchona l’arbre à fièvres dont c’est désormais la dénomination scientifique.
Cette anecdote est restée longtemps classique. Elle est aujourd’hui largement contestée, avec la découverte du journal intime du vice-roi du Pérou qui ne fait aucune mention de la maladie de son épouse ni, bien sûr, de sa guérison.
Mais très vite, la préparation et l’exportation de la poudre d’écorce de quinquina deviennent le monopole des pères Jésuites. D’après la légende, ceci expliquerait la mort d’Oliver Cromwell, emporté par un paludisme cérébral après avoir refusé d’être traité avec cette « poudre des papistes ». Cette anecdote rapporte une attitude hautement exemplaire mais elle est contestée elle aussi, notamment par Pascal qui écrit dans les Pensées : « Cromwell allait ravager toute la chrétienté, la famille royale était perdue, et la sienne à jamais puissante, sans un petit grain de sable qui se mit dans son uretère ». Cromwell ne serait donc pas mort de neuropaludisme, mais il est au moins probable que son calcul urétéral était sensiblement plus volumineux qu’un grain de sable.
Quoi qu’il en soit, et au-delà de cette anecdote, la poudre de quinquina était très utilisée en Europe où le paludisme sévissait largement. En France, la maladie était répandue dans de nombreuses régions et même à Paris où le creusement du canal Saint Martin en 1811 entraîne une véritable épidémie. Les personnages les plus illustres n’échappent pas au paludisme. Richelieu en est atteint au Siège de La
Rochelle. A Versailles, le paludisme a été longtemps endémique. Le château a en effet été construit sur un terrain largement marécageux. Les magnifiques pièces d’eau qui ornent le parc devaient, notamment, en permettre le drainage et, avec le délicieux cynisme dont elle était coutumière, Madame de Sévigné écrit pendant leur construction : « les fontaines coûtent cher… sans parler des malades et des morts ».
La garde suisse paye elle aussi un tribut très lourd au paludisme. Louis XIV lui-même n’est pas épargné. L’histoire rapporte qu’il achète très cher — quarantehuit mille livres — une préparation à base de quinquina à un apothicaire anglais, Talbot, ce que La Fontaine célèbre ensuite dans un poème au titre pour le moins inattendu « ode en faveur du quinquina ».
Dans le reste de l’Europe, le paludisme était également très répandu, en Grande Bretagne, nous l’avons vu, en Espagne, en Italie (dans les marais pontins mais aussi dans le nord de la péninsule, puisqu’il est possible que Dante en soit mort à Ravenne), en Roumanie (delta du Danube), et enfin dans les pays nordiques jusqu’au littoral de la Baltique aux environs de Stockholm.
Mais revenons au quinquina. Au Pérou, un négociant anglais en laine d’alpaga, Charles Ledger, décide de se procurer des graines de l’arbre à fièvre. Il en charge son serviteur indien, Manuel, qui en Bolivie recueille vingt kilos des précieuses graines, avant d’être accusé de vol et battu à mort. Après mille péripéties, ces graines sont proposées au gouvernement britannique pour être plantées dans le parc de Kew Gardens, près de Londres, qui n’aurait d’ailleurs certainement pas constitué un biotope très favorable. Contre toute attente, cette offre est refusée par les britanniques. Elle est immédiatement acceptée par les hollandais qui font planter les graines à Java et tirent de ces plantations une richesse fabuleuse en ayant, jusqu’à la deuxième guerre mondiale, un quasi monopole de la quinine. De son côté, Ledger tire de l’opération des gains certainement substantiels mais aussi une large renommée. Le quinquina est désormais baptisé Cinchona ledgeriana et Ledger se retire en
Australie où il se voit élever un monument proclamant « qu’il a donné la quinine au monde ».
Mais la poudre d’écorces utilisée jusque là avait des vertus thérapeutiques évidemment aléatoires. En 1820, elle est transformée en médicament véritable, la quinine, par deux jeunes pharmaciens français. Respectivement âgés de vingt-cinq et de trente-deux ans, Pelletier et Caventou (l’un d’entre eux créée ensuite une pharmacie qui existe toujours rue Jacob, à quelques centaines de mètres de cette salle), isolent et caractérisent la quinine. Malheureusement pour eux, ils oublient de protéger leur découverte par la prise d’un brevet…
En moins de deux siècles, ce médicament a sauvé des dizaines ou peut-être des centaines de millions de malades dans le monde entier. Il a également joué un rôle essentiel en médecine militaire, chaque fois qu’il s’agissait de protéger des troupes envoyées sur ce que l’on n’appelait pas encore des « théâtres d’opérations extérieures ». Maillot édicte les règles de la quininisation des armées. Ceci facilite la conquête de l’Algérie mais la quinine permet aussi — et on l’oublie trop souvent —
de sauver ensuite des milliers de malades civils, notamment dans la plaine de la Mitidja. Dans les armées, la quininisation est largement employée, notamment dans les Dardanelles, pendant les combats dans la presqu’île de Gallipoli. Malheureusement, il n’en est pas toujours de même. Pendant la malheureuse campagne de Madagascar, en 1895, on compte dans le corps expéditionnaire, sur un effectif moyen de douze à quinze mille hommes, douze morts et quatre vingt-huit blessés au combat contre plus de cinq mille décès par maladie, dont les trois quarts de paludisme.
Dès la première moitié du XIXe siècle, le paludisme est donc parfaitement distingué des autres maladies fébriles. Il reste à en préciser l’agent responsable et les modalités de sa transmission. C’est ce que permettent des découvertes directement liées à l’ère pastorienne.
En effet, en 1880, un médecin militaire français, Alphonse Laveran — à qui nous avons récemment rendu hommage dans cette Académie et au Val de Grâce — découvre à Constantine, dans le sang d’un paludéen, des parasites microscopiques, les Plasmodium . Cette découverte permettra à son auteur d’être le premier français lauréat du Prix Nobel français de médecine en 1907. Les travaux se succèdent avec l’identification des quatre espèces plasmodiales parasites de l’homme et la découverte du cycle évolutif du parasite dans l’organisme humain. Deux médecins anglais Short et Garnham identifient en 1948, au Kenya, les formes hépatiques pré- érythrocytaires responsables de l’incubation clinique. En 1980, c’est-à-dire un siècle après la découverte initiale de Laveran, deux autres anglais, Bray et Krotovski, découvrent des formes plasmodiales quiescentes, les hypnozoïtes, qui provoquent les rechutes dans certaines formes de l’affection.
Cependant, la relation du paludisme avec les zones marécageuses est restée longtemps inexpliquée. Or, à la fin du XIXe siècle, le rôle vecteur de différents moustiques est mis en évidence pour d’autres maladies transmissibles, par exemple par Finley pour la fièvre jaune et par Manson pour les filarioses lymphatiques. Manson a une grande influence scientifique sur un autre britannique, Ronald Ross, qui dans des conditions très précaires démontre aux Indes en 1895 que le paludisme est lui aussi transmis par la piqûre de certains moustiques, des moustiques « ayant les ailes tachetées ». Des italiens. Bastianelli, Grassi prouvent ensuite que seuls les anophèles peuvent assurer cette transmission. Leur découverte complète fondamentalement les observations de Ross mais elle est injustement mésestimée. Et, en 1902, c’est Ross qui reçoit seul le Prix Nobel français de médecine, le deuxième Prix Nobel français de médecine puisque cette prestigieuse distinction avait été créée l’année précédente.
Cependant, l’histoire paradoxale du paludisme se poursuit. Ce fléau mondial est aussi utilisé à des fins thérapeutiques, notamment à la Pitié-Salpêtrière. Cette malariathérapie — que certains d’entre nous ont pratiquée — avait des indications très variées : paralysie générale, maladie de Burger ou, plus récemment, maladie de Lyme et Sida. Des indications très variées mais une efficacité pour le moins discutable.
Mais revenons à la thérapeutique antipalustre. Pendant la première guerre mondiale, le paludisme fait des ravages que la production limitée de quinine ne permet pas de tous éviter. On cherche donc une autre voie : les antipaludiques de synthèse.
La première découverte est faite en Allemagne en 1924 avec la Pamaquine. D’autres médicaments suivent, toujours en Allemagne, avec la Mépacrine en 1930, la Quinacrine et, en 1934, la première amino-4-quinoléine, précurseur de la Chloroquine et qui sera utilisée par l’Afrika Korps en Cyrénaïque.
Dans la guerre du Pacifique, ces antipaludiques de synthèse prennent une importance militaire déterminante. En effet, à la conquête de leur « espace vital », les troupes japonaises occupent les îles de la Sonde et donc toutes les principales zones de production de quinine. Ces troupes sont protégées contre le risque de paludisme et conservent toutes leurs capacités opérationnelles dans des combats en zones tropicales. Ce n’est pas le cas des troupes américaines maintenant privées de protection médicamenteuse. Le Général Mc Arthur déclare même que « pour une division au combat, il en a deux à l’hôpital ».
L’industrie pharmaceutique américaine entreprend alors un formidable programme de recherche et améliore finalement les procédés de synthèse industrielle des antipaludiques découverts par les allemands. Face au risque palustre, les troupes ennemies sont désormais à égalité, les japonais grâce à la quinine, les américains grâce aux antipaludiques de synthèse. Et après la guerre, le Général Mc Arthur déclare même que ces antipaludiques ont autant contribué à la victoire finale que la fabrication massive de porte-avions.
En réalité, ces porte-avions inversent la situation. Ils permettent de couper les lignes de communications nippones, et donc les voies d’acheminement de la quinine. Les troupes japonaises sont désormais privées de toute chimio-protection, face à un ennemi disposant, lui, des médicaments indispensables. C’est alors que se situe un évènement haut en couleur mais parfaitement historique. Le haut commandement nippon donne l’ordre de trouver les moyens d’amener les marines américains à refuser leurs antipaludiques. C’est une tâche apparemment impossible ! Comment en effet convaincre un soldat ennemi de ne pas utiliser un médicament qui peut lui sauver la vie ? La solution est pourtant trouvée grâce à une émission radiophonique japonaise. Etonnamment moderne pour l’époque, cette émission alterne de la musique, des reportages et diverses interventions par une jeune journaliste à la voix chaude et sensuelle, la « Rose de Tokyo ». Très largement diffusée, cette émission est fréquemment écoutée par les soldats américains, auxquels la Rose de Tokyo déclare un jour : « soldats américains, vous avez de la chance : on vous distribue des médicaments qui vous protègent contre le paludisme. Vous avez de la chance, oui, mais on ne vous a pas tout dit : ces médicaments … vont vous rendre impuissants ».
On imagine la suite.
Pour que la situation soit rétablie dans l’armée américaine, il fallut bien sûr le strict respect de la discipline qui, comme chacun sait, est la force principale des armées.
Mais il fallut aussi toute la puissance persuasive du service psychologique US qui
contre attaque sur un thème évidemment très mobilisateur : « les antipaludiques ne rendent pas impuissant. Au contraire ».
L’étape thérapeutique suivante est une autre guerre impliquant elle aussi les EtatsUnis. C’est en effet avec la guerre du Vietnam que commencent à se multiplier les résistances aux antipaludiques disponibles. L’industrie pharmaceutique américaine met au point de nouveaux médicaments, la Méfloquine, l’Halofantrine. Malheureusement, ces produits ne sont pas dépourvus d’effets indésirables et on observe l’émergence de résistances, avant même que ces antipaludiques ne soient mis sur le marché.
C’est à nouveau de la médecine traditionnelle que vient la solution. Traversons les océans et les siècles. La Chine prend le relais du Pérou. Depuis plus de deux mille ans, les chinois traitent le paludisme par le Qing Hao Shu un extrait artisanal d’une armoise,
Artemisia annua. Pendant la guerre du Viet Nam, les troupes Viêt-Cong n’ont pas accès aux antipaludiques qui viennent de l’occident. Ho Chi Minh demande l’aide de Chou en Lai et les extraits d’armoise sont pour la première fois utilisés hors de Chine. Par la suite, vers 1980, les chimistes chinois en isolent et en caractérisèrent le principe actif, l’artémisinine. L’industrie pharmaceutique occidentale et en particulier l’industrie française, prend le relais. Des dérivés comme l’artésunate sont mis au point et évalués selon les critères occidentaux. Ce sont actuellement les antipaludiques les plus efficaces.
Mais à propos de l’artémisinine, la petite histoire nous fournit une autre anecdote savoureuse. En effet, l’absinthe est, elle aussi, préparée à partir d’une armoise, il est vrai différente d’ Artemisia annua. Or, au XIXe siècle, c’est avec de l’absinthe qu’un ancien médecin de la grande armée, traite ses patients atteints de paludisme.
L’histoire ne précise pas l’ampleur de ses succès thérapeutiques. Il est d’ailleurs tout simplement possible que, après une ingestion suffisante d’absinthe, ses malades aient réussi sinon à guérir, du moins à oublier leur maladie.
Quant à la chloroquine, son histoire ne s’arrête pas avec la multiplication des résistances. Elle a récemment connu une nouvelle jeunesse. Une jeunesse potentiellement exemplaire avec la découverte de son activité dans la mucoviscidose ou — grâce à un mécanisme commun d’inhibition — face à de nombreux virus : VIH, H5N1, virus du Chikungunya. Ces indications sont très prometteuses mais elles doivent être évidemment confirmées. Mais, malheureusement, cette nouvelle jeunesse de la chloroquine est aussi crapuleuse. Depuis peu, ce médicament est en effet utilisé par des toxicomanes auxquels elle procure paraît-il de superbes « voyages » — pour adopter le vocabulaire utilisé dans ces milieux — des voyages d’autant plus inoubliables qu’ils peuvent être définitifs, — car, à fortes doses, la chloroquine est cardiotoxique. En Afrique, elle était d’ailleurs souvent utilisée dans les tentatives de suicide.
Mais revenons à la grande histoire et abandonnons un instant la thérapeutique pour évoquer un autre tournant essentiel de la lutte contre le paludisme et plus généralement de l’histoire de l’humanité. Il s’agit de la découverte en 1939 des propriétés
insecticides du Dichloro-Diphényl-Trichloroéthane, le DDT. Ce produit est synthé- tisé à Strasbourg, en 1873 par un autrichien, Zeidler qui en ignore les applications.
C’est à Bâle, plus de soixante ans plus tard, que son activité insecticide est découverte à l’issue d’un concours de circonstances très inattendu. Dans les années 30, l’héritier d’un grand laboratoire pharmaceutique bâlois, Rudolph Geigy — que j’ai personnellement bien connu à la fin de sa vie — part pour Genève réaliser une thèse de génétique. A l’époque, le seul matériel biologique disponible pour de telles études étaient les « mouches du vinaigre », les drosophiles. Pour ses expériences, Geigy apprend à élever ces insectes et, de retour dans le laboratoire familial quelques années plus tard, y importe son savoir faire avec la création d’un insectarium.
Apprécier l’éventuelle activité insecticide des substances disponibles fait désormais partie des « criblages » systématiques des laboratoires Geigy. Cela conduit, en 1939, à la découverte de Paul Muller, employé de ce laboratoire, qui démontre les proprié- tés insecticides du DDT et qui, en 1948, reçoit pour cela le prix Nobel de chimie.
Cette découverte eut des conséquences dont on mesure mal l’ampleur. C’est en particulier au DDT que l’on doit d’avoir évité, à la fin de la deuxième guerre mondiale, une gigantesque et meurtrière épidémie de typhus que n’aurait pas manqué de provoquer autrement la libération des survivants des camps nazis.
Souvent atteints de typhus, ces malheureux étaient généralement porteurs de poux.
Au sein d’une population européenne sous alimentée et affaiblie, ces parasites auraient assuré la diffusion de la maladie, si le nouvel insecticide n’avait pas permis leur destruction.
Dans la lutte contre le paludisme, le DDT joua un rôle également essentiel en permettant la destruction du moustique vecteur, l’anophèle. Ce fut la base des campagnes de lutte antivectorielle lancées par l’OMS en 1955, avec une organisation quasi militaire. Ces campagnes connurent des succès significatifs, notamment en Tunisie, mais des résistances à l’insecticide apparurent tandis que le DDT était trop et mal utilisé. Au lieu d’être réservé aux pulvérisations dans les habitations, il était en effet largement répandu sur les cultures, provoquant ainsi de graves perturbations environnementales de la faune et, secondairement, de la flore. Le DDT — et plus généralement les insecticides — en acquirent une très mauvaise réputation. Et ce n’est que très récemment, au nom de ce qui a été diplomatiquement baptisé une « position équilibrée », que l’OMS en a recommandé à nouveau l’usage.
Mais en dehors du DDT, nous disposons de plusieurs autres insecticides (HCH, pyrèthrinoïdes, etc.). Leur meilleure application fait suite aux travaux de chercheurs français de l’Institut de Recherche pour le Développement, l’ancien ORSTOM. Ces chercheurs ont imaginé une technique remarquablement efficace, parfaitement adaptée aux conditions locales et qui constitue une des plus importantes avancées dans la protection contre le paludisme. Il s’agit de l’usage de moustiquaires impré- gnées par des insecticides. La logique de la méthode est la suivante : les anophèles vecteurs ont une activité essentiellement vespérale ou nocturne. Dormir sous une moustiquaire élimine le risque d’infestation. Au moins théoriquement. Une moustiquaire est en effet rarement exempte de déchirures, parfois minuscules, difficile-
ment découvertes même par un observateur attentif mais qui sont suffisantes pour permettre le passage d’un insecte. L’imprégnation préalable par un insecticide élimine ce risque, en détruisant les anophèles au moment de leur tentative de franchissement. Cette méthode très simple est remarquablement efficace. Elle constitue l’un des meilleurs moyens de prévention du paludisme, en particulier pour les enfants.
Mais soulignons le paradoxe. Pour la prévention du paludisme, de très nombreuses recherches conduites avec les méthodes les plus compliquées et à grand renfort de technologies sophistiquées n’ont jusqu’ici apporté aucun résultat pratique. Et c’est une méthode qui paraît renvoyer à l’époque de la marine à voile et des lampes à huile qui constitue le plus indiscutable progrès.
Plusieurs millions de moustiquaires imprégnées ont été fournies aux pays d’Afrique subsaharienne. Elles ont permis de diminuer considérablement, parfois dans une proportion atteignant 40 %, la mortalité infantile par neuropaludisme.
Et puis, venons-en à l’époque actuelle.
Les trois dernières décennies sont pauvres en anecdotes.
Mais elles sont riches et même très riches en découvertes majeures, fondamentales et appliquées ou plutôt applicables. C’est d’abord la réalisation des premières cultures in vitro de Plasmodium falciparum , en 1976. Puis de nouvelles pistes thérapeutiques apparaissent et de nouveaux médicaments entrent en phase d’évaluation clinique.
C’est aussi, le séquençage du génome de Plasmodium falciparum qui est l’un des premiers pathogènes dont la structure génomique est décryptée. Parallèlement, on découvre la complexité et la variabilité de la structure antigénique des Plasmodium.
De très nombreuses fractions sont isolées et caractérisées. On identifie les gènes qui codent pour ces protéines, on découvre de nouveaux adjuvants de l’immunité. On espère ainsi pouvoir disposer d’un vaccin contre le paludisme. Malheureusement, le problème est formidablement difficile et, en dehors de certains succès très récents, tous ces espoirs ont été jusqu’ici régulièrement déçus. Ces déceptions ont été d’autant plus grandes que certains chercheurs, gravement atteints de crises narcissiques suraiguës, n’ont pas hésité à annoncer qu’ils détenaient la solution miracle et à se laisser présenter dans les médias — en toute simplicité — comme de nouveaux Pasteur.
Ces déclarations fracassantes reposaient sur des résultats malheureusement préliminaires… et qui le sont restés.
Dans l’immédiat, nous nous trouvons toujours — ou presque — dans la situation que décrivait Ronsard, Ronsard, lui aussi atteint de paludisme et qui écrit en 1560, dans le premier livre de Poèmes :
« En attendant que de mes veines parte Cette exécrable, horrible fièvre quarte Qui me consume et le corps et le cœur Et me fait vivre une extrême langueur »
Mais la coopération internationale s’intensifie. Les recherches en cours sont extrê- mement prometteuses. Elles se développent de façon spectaculaire. Nul doute qu’elles permettront un jour sinon d’éradiquer, au moins de contrôler le paludisme et d’en faire disparaître les complications mortelles.
Mais quand ? Nul ne peut le dire.
D’ailleurs, comme le faisait remarquer un homme d’état français avec une parfaite ingénuité :
« il est toujours bien difficile de faire des prédictions…surtout quand elles concernent l’avenir ».

Madame Bernadette Chirac et Jacques-Louis Binet, Secrétaire perpétuel
Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 9, 1849-1857, séance du 11 décembre 2007