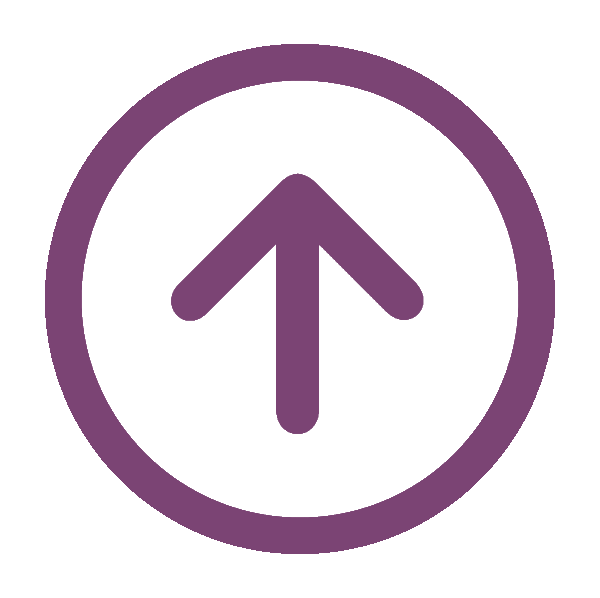Résumé
Le médecin hippocratique renonce à l’explication des maladies épidémiques par le miasme magico-religieux qui souille collectivement les populations ; il en rend responsable l’air ambiant, libérant les hommes de la crainte de la colère des dieux mais fermant ainsi la route à l’idée de la contagion et dissociant son expérience de celle des vétérinaires. Galien néanmoins, à l’occasion de l’observation de cas de lèpre en Asie mineure, a l’intuition d’une contagion inter-humaine.
Summary
The Hippocratic doctor does not believe any more in magico-religious « miasmata » that pollute whole populations ; he accuses the environmental air, thus freeing his fellow-men from the fear of gods’ wrath but impeding the rise of the concept of contagion and disconnecting his own experience from the vet’s. Galen however observing a few cases of lepra in Minor Asia intuits human contagion.
INTRODUCTION
Pourquoi la notion de contagion, c’est-à-dire de transmission d’une maladie d’un sujet atteint à un sujet sain, par contagion directe ou par l’intermédiaire d’un contage, a-t-elle eu tant de mal à s’imposer à la médecine occidentale ? Pourquoi le XIXème siècle voyait-il encore aux prises contagionnistes et anti-contagionnistes ? Il est impossible de parcourir en quelques pages les vingt-cinq siècles qui nous séparent d’Hippocrate, mais possible de voir les effets pervers qu’eut dans l’Antiquité un merveilleux effort de rationalisation.
HIPPOCRATE SE DÉBARRASSE DU MIASME RELIGIEUX ET MAGIQUE
Le médecin voyageur
Le médecin grec voyage volontiers pour exercer son art, appelé par une cité pour y être médecin public un certain temps, à la recherche d’une clientèle renouvelée, ou encore désireux de changer de contexte géographique pour en apprendre plus, comprendre mieux, vérifier la valeur de ses théories. Allant ainsi à pied de cité en cité, voguant d’île en île, il rencontre des populations complètement immergées dans certains contextes, et dont il peut croire qu’elles en sont le produit, sous l’influence de l’orientation des lieux, de la direction et de l’intensité des vents, de la qualité et de la quantité des eaux de pluie et de source, du déroulement des saisons variable selon les années. Tous les phénomènes qui touchent la vie de l’homme, y compris les phénomènes pathologiques, en dépendent. Néanmoins il ne s’agit pas d’un déterminisme absolu, car si le contexte géographique a des effets sur l’homme, celui-ci à son tour agit sur celui-là. Et si dans cette double action l’homme a le dessous, il peut demander l’aide du médecin qui interviendra, dans le refus absolu d’une interpré- tation magique. Si ce n’est pas tout à fait la naissance d’une médecine scientifique, c’est bien celle d’une médecine rationnelle et laïque.
L’air ambiant
Le traité hippocratique
Des airs, des eaux et des lieux est un manuel destiné à un tel médecin, qui en fait son compagnon dans ses pérégrinations. On y lit notamment que le πνευ´µα (l’air naturel que tous respirent) n’est pas la cause unique des maladies, mais la cause essentielle lorsqu’il s’agit des maladies dites épidémiques, qui d’un coup frappent des populations entières. Et l’auteur du traité expose à quoi doit faire face le médecin qui arrive dans une ville qu’il ne connaît pas, par exemple des « villes exposées aux vents qui soufflent entre le lever d’été et le lever d’hiver, et celles dont l’exposition est contraire » (§ 5). On aurait donc tort de trop incriminer le régime qui n’est jamais exactement le même chez tous à la fois. Le traité Des vents raffine sur ce pneuma : ce n’est pas l’air ambiant en général, mais les mouvements de celui-ci, à
l’extérieur les différents vents, ανε´µοι, et à l’intérieur les souffles internes, φυ´σαι. Si l’air est nécessaire à la vie, parallèlement « selon toute vraisemblance, la source des maladies ne doit pas être placée ailleurs, alors qu’il entre dans le corps, soit en excès, soit en défaut, ou trop à la fois ou souillé de miasmes morbifiques » (§ 5 = L. VI 96-97).
La distinction entre maladies individuelles, dues au régime, et maladies collectives, dues à l’air, se vérifie également dans la Nature de l’homme : « Les maladies proviennent les unes du régime, les autres de l’air, dont l’inspiration nous fait vivre.
On distinguera ainsi ces deux séries : quand un grand nombre d’hommes sont saisis en même temps d’une même maladie, la cause doit en être attribuée à ce qui est le plus commun, à ce qui sert le plus à tous ; or cela, c’est l’air que nous respirons (…) Au temps où une maladie règne de façon épidémique, il est clair que la cause en est non dans le régime, mais dans l’air que nous respirons et qui laisse échapper quelque exhalaison morbifique contenue en lui » (§ 9 = L. VI 52-55).
Quelle est la conduite à tenir, si l’air est l’élément pathogène par excellence ? La mesure prophylactique la plus sage est de « changer d’air » en s’en allant le plus loin possible de la zone atteinte, ou à la rigueur si la fuite est impossible de respirer peu, puisque c’est par la respiration que ces éléments nocifs pénètrent dans le corps.
« Faire en sorte que l’inspiration (de mauvais air) soit aussi petite (…) que possible, c’est-à-dire d’une part s’éloigner autant qu’on peut dans le pays des localités envahies par la maladie, d’autre part atténuer le corps, atténuation qui réduit chez les hommes le besoin d’une forte et fréquente respiration », conclut ce même chapitre 9. Soulignons en passant une des difficultés des traductions anciennes : qui emploie encore « atténuer » au sens de rendre moins dense, plus léger ( tenuis ) ?
L’invasion du paludisme malin
Cette étiologie aérienne a totalement convaincu le corps médical et a pendant des siècles interdit aux médecins d’envisager la notion de passage d’homme à homme.
On peut se l’expliquer à mon avis comme suit : c’est au Vème siècle qu’apparaît en Grèce, en même temps que sont écrits les traités cités, le paludisme malin dû à l’hématozoaire Plasmodium falciparum dans des populations encore vierges [1] ; le diagnostic ne fait pas de doute pour certains cas hippocratiques de maladies aux urines sombres, de certaines fièvres rémittentes [2], ou encore de la catastrophe qui frappa les Carthaginois lors de l’épisode historique du siège de Syracuse (396-395 avant J. -C.) [3]. Les zones touchées sont clairement délimitées et peu étendues. Pour de telles fièvres « épidémiques », dont sont frappées des populations entières dans un pays donné dans une courte période donnée, avec des caractéristiques semblables chez tous et chaque année, et qui ont une recrudescence saisonnière, l’étiologie aérienne fonctionne bien et logiquement. En effet, la maladie apparaît et se développe dans des régions marécageuses ou proches de marais, où stagnent les eaux et où règne un air mauvais ; et pour qui ne sait rien du rôle des moustiques l’air semble
effectivement chargé d’émanations, qui souillent l’air, de miasmes morbifiques produits par une perturbation de la nature, agent causal actif de la maladie.
Une théorie salvatrice ?
Cette théorie a le mérite supplémentaire de s’inscrire dans l’effort de rationalisation de la médecine grecque du Vème siècle : si l’air est mauvais, ces « pestes » catastrophiques sont un fait de nature et les dieux n’y sont pour rien. Aucune divinité en colère n’a de ses flèches provoqué la pestilence, comme il arriva au temps de la guerre de Troie, à ce que racontait le poète. Les hommes malades ne sont pas coupables ; ils ne paient pas collectivement la faute de l’un d’entre eux ; il n’y a pas de miasme de la vengeance divine.
Devant l’apparition d’une maladie considérée comme nouvelle, le paludisme à falciparum , la tentation a dû être grande pour les pauvres humains de se livrer au désespoir et à l’accablement. C’est la grandeur des médecins hippocratiques d’avoir délivré de cette idée désolante les plus évolués de leurs contemporains et de les avoir entraînés par leur enthousiasme areligieux à chercher une autre explication, imparfaite certes, mais infiniment préférable. Cette théorie salvatrice eut cependant des effets catastrophiques à long terme. En effet, si l’air est tenu pour responsable de ces maladies épidémiques, il n’y a plus besoin d’envisager d’autres hypothèses, en particulier on fait très bien l’économie de l’idée d’un passage de la maladie d’homme à homme, par « contagion » [4].
GALIEN ET L’ÉLÉPHANT
L’arrivée de la lèpre
La vraie lèpre, très ancienne en Extrême-Orient, est déjà connue des Grecs du temps d’Hippocrate, mais seulement par des cas sporadiques importés, d’où l’usage de noms marquant son caractère étranger. Elle commence son expansion à l’époque hellénistique en Égypte. Elle y est attestée pour la première fois sous un nom qui indique l’étiologie qu’on lui prête : c’est la « cacochymè », maladie aux mauvais sucs, selon Straton, qui travaille à Alexandrie au III-IIème siècle avant J. -C., d’abord comme élève et secrétaire d’Érasistrate, et qui en parle avec le sentiment qu’il s’agit d’une maladie nouvelle. Elle gagne alors l’Asie mineure et l’Italie, et devient progressivement endémique en Europe dès la fin de la République, ayant attaqué les armées de Pompée en Syrie en 60 avant J.-C. Pline (XXVI 7) affirme que « l’éléphantiasis ne s’est pas manifesté en Italie avant l’époque de Pompée ». Celse (III 25) considère que cette maladie est « presque inconnue en Italie mais très répandue dans certaines régions ». Plutarque se demande s’il s’agit bien là d’une maladie nouvelle (VIII 9, 731 A – 732 B).
Le nom de la maladie
Selon les descriptions des Anciens, il s’agit d’une maladie chronique qui se manifeste spectaculairement par la modification de la voix, l’épaississement de la peau, la lente destruction du cartilage nasal et des extrémités. La maladie porte en grec et en latin le nom savant d’éléphantiasis ou populaire d’éléphant [5], ou d’autres, également métaphoriques, selon les étapes de son évolution, comme celui de satyriasis [6]. Le nom de λε´πρα, lepra , qui deviendra celui de la vraie lèpre au Moyen Âge, ne désigne alors que différentes dermatoses plus bénignes. Il ne faut pas s’étonner de l’usage du procédé littéraire cher à la langue médicale, qui consiste à faire appel à une métaphore pour désigner une maladie, et dont Galien justifie le principe dans un célèbre passage de La méthode thérapeutique (II 2 = K. X 81) . Dans ce cas particulier, les Anciens cherchent à justifier le passage du nom de l’animal à la maladie de différentes façons, aspect extérieur, couleur, taille, durée de vie. En particulier, la couleur sombre des malades fait penser à la nuit et à la mort, et selon la définition médicale pseudo-galénique no 295, « l’éléphant est une affection qui produit une peau épaisse et irrégulière, qui la rend livide, qui rend également livide le blanc des yeux, qui dévore les extrémités des bras et des jambes et qui fait couler une sérosité livide et de mauvaise odeur ». Si l’ingéniosité des écrivains médecins est grande en la matière, il est fort probable que c’est surtout la peau de l’éléphant qui a frappé l’imagination populaire et a suscité le rapprochement entre une bête que bien peu de gens connaissaient, pour l’avoir vue dans l’arène, et une maladie, certes effroyable, mais qui n’était pas encore un fléau.
Étiologie, épidémiologie, traitement
La lèpre (de Hansen) proviendrait d’humeurs mauvaises qui ont envahi les profondeurs du corps, réclame un traitement asséchant et est difficilement curable. Galien dans le traité Par quels médicaments 1 rapporte : « J’ai guéri un éléphant à ses débuts, en pratiquant tout de suite la saignée et la purge, et chaque année la répétition d’une purgation unique lui suffit, mais si elle n’est pas faite tout de suite la maladie se manifeste… ». En dehors de ces moyens agressifs, Galien, fidèle à Straton quant à la pathogenèse présumée (les mauvais sucs), choisit une thérapeutique nettement liée à l’étiologie qu’il lui prête et qui appelle de sa part des remarques épidémiologiques.
« Ainsi donc à Alexandrie bien des gens souffrent d’éléphantiasis, à cause de leur régime et de la chaleur du pays. Mais dans les Germanies et dans les Mysies, cette maladie se voit très rarement. Et chez les Scythes buveurs de lait, elle ne se manifeste pour ainsi dire jamais. Mais à Alexandrie, à cause du régime (des gens), elle se produit très fréquemment ; en effet, ils se nourrissent de gruau, de soupe de lentilles, de coquillages et de toutes sortes de salaisons. Certains mangent aussi de la viande d’âne et d’autres choses du même genre qui produisent un suc épais et plein de bile noire. Et, vu que l’atmosphère qui les entoure est chaude, le mouvement du flux humoral se porte à la peau (…). Pour le régime, prescrivez abondamment le suc de
ptisane, le sérum du lait et des légumes, la mauve, l’arroche, la bette, et des courges dans leur saison. Parmi les poissons, donnez ceux de roche ; donnez tous les oiseaux, sauf ceux des marais ».
On peut se demander si, comme les deux augures qui, selon Cicéron, ne pouvaient se regarder sans rire, Galien pouvait sans rire concocter puis dicter la recette de cuisine médicale qui suit : « La chair des vipères est un médicament merveilleux contre l’éléphantiasis. Faites-en manger, préparées comme vous l’avez vu faire aux Marses, éleveurs de bêtes et de serpents, en leur coupant d’abord la queue et la tête sur une longueur de quatre doigts, puis en leur enlevant tous les viscères et la peau, ensuite en leur lavant le corps dans l’eau. Jusque-là la préparation est semblable à celle de la thériaque, mais le mode de cuisson diffère. Pour la thériaque, nous ajoutons dans l’eau de l’aneth et un peu de sel ; en revanche, nous préparons les vipères à la sauce blanche comme des anguilles dans un plat. Voici le procédé : versez beaucoup d’eau, un peu d’huile et avec l’huile du poireau et de l’aneth. Il convient évidemment de faire bouillir la chair de vipère jusqu’à ce qu’elle devienne parfaitement molle. Le médicament (…) est pris avantageusement en potion par les individus ainsi affectés, et sert, si l’on veut, pour frotter la peau. Tous ces moyens arrivent parfois à détacher les écailles de la peau, comme se détache chez les serpents ce qu’on appelle vieille peau » ( De la méthode thérapeutique II 12).
Ses souvenirs de jeunesse ont certainement aiguillé Galien dans ses recherches en matière de thérapeutique ; en effet il a connu des expériences occasionnelles, mais aussi il a fait des expériences répétées, ce qui marque une certaine avancée sur la voie de l’expérimentation véritable.
Lèpre contagieuse, lèpre guérie
Le traité
Des facultés des médicaments simples rapporte en effet quelques pittoresques cas de guérison constatés par Galien en Asie mineure, dans des circonstances parfois rocambolesques, que nous ne pouvons toutes commenter. La vipère, remède desséchant, y joue un grand rôle. Le récit du cas le plus intéressant, dans lequel l’implication de mauvais choix alimentaire se combine à l’étiologie miasmatique héritée d’Hippocrate, marque une étape importante vers la compréhension de la contagion. En effet, on sait aujourd’hui que les portes d’entrée du Mycobacterium leprae (évidemment inconnu des Anciens) semblent bien être les voies aériennes et les pores de la peau [7] : ce contage par l’air est extrêmement intéressant pour l’historien de la médecine puisqu’il ne présente pas de contradiction apparente avec la théorie miasmatique [8]. On sait aussi que l’état de la défense immunitaire joue un rôle dans l’évolution de la maladie, et que la pauvreté et la malnutrition ne sont pas étrangères à celui-ci, ce qui ne contredit pas non plus la théorie nutritionnelle du médecin de Pergame.
Voici l’histoire, au chapitre 11 du livre XI de ce traité. Au temps où Galien était encore un jeune homme en Asie mineure, « un homme qui souffrait de la maladie
appelée éléphant partageait la vie de ses compagnons, jusqu’au moment où, à cause de leurs relations avec lui et des contacts qu’ils avaient, la maladie se communiquât à certains d’entre eux et que lui-même devînt d’une odeur insupportable, et affreux à voir.
« On lui construit donc une cabane à proximité du village, au bas de la colline, près d’une source ; on y installe l’homme et on lui apporte chaque jour assez de nourriture pour qu’il puisse subsister. Au moment du lever de la constellation du chien, des moissonneurs vinrent faire la moisson pas loin de là où il était ; et on leur apporta du vin qui sentait fort bon dans un vase d’argile. Celui qui avait apporté le vin déposa le vase et se rendit auprès des moissonneurs. Vint le moment de boire ; or c’était la coutume chez eux de remplir le cratère avec une quantité convenable d’eau pour couper le vin ; le jeune homme souleva le vase d’argile, fit couler le vin dans le cratère, et il en tomba en même temps une vipère morte. Les moissonneurs eurent peur qu’il leur arrivât quelque ennui s’ils buvaient ce vin et ils burent de l’eau. Mais en partant, par philanthropie peut-être, ils firent cadeau de tout le vin à l’homme qui souffrait de l’éléphant, estimant que pour lui il valait mieux de toute façon mourir que de vivre ainsi (…). Celui-ci but du vin et recouvra la santé d’une façon extraordinaire ; en effet toute la couche squameuse de sa peau tomba, à la manière de la carapace des animaux à coquille molle. Ce qui était resté de la peau se montra tout à fait doux, comme celle des homards et des crabes lorsque la carapace qui les entoure est tombée ».
Milieu rural et art vétérinaire
La théorie, salvatrice en un sens, de la contamination par l’air eut cependant des effets catastrophiques à long terme, avons-nous dit. Et il y là un étrange paradoxe, car les vétérinaires et les maîtres des troupeaux savaient très bien, eux, qu’il y a contagion entre les animaux. Ils étaient soumis, eux, à l’expérience commune et à l’observation quotidienne. Ne voyant guère plus loin que les nécessités du gain et de la sauvegarde de leur cheptel, ils n’avaient l’esprit obscurci d’aucune théorie, si belle fût-elle. Le bon berger sait qu’une bête malade contamine les autres et qu’il faut soit l’isoler des autres soit conduire ailleurs le reste du troupeau. C’est chez les vétérinaires latins qu’on lit les textes les plus convaincants, mais on peut les utiliser pour les périodes plus anciennes, car cette littérature technique est très répétitive et s’inspire de près d’une littérature grecque aujourd’hui presque entièrement disparue. Végèce, le dernier des grands vétérinaires de l’Antiquité, écrit ainsi (prologue, §14) : « il y a des maladies qui commencent avec une bête ou quelques-unes, mais qui ensuite passent à un grand nombre d’entre celles qui partagent la même étable ou qui mangent la même nourriture. Très souvent elles passent ainsi à des troupeaux entiers, avec leur atroce contagion, si bien qu’un animal, qui était en bonne santé, meurt brutalement peu après, sous l’effet de la respiration d’un autre ». Il importe donc d’agir le plus vite possible pour éviter le passage, transitus , et couper court à la contagion.
Or les plus extraordinaires de ces histoires se passent en milieu rural, à la campagne, à la montagne, dans des lieux désertiques, zones où l’on voyait certainement plus souvent un vétérinaire qu’un médecin. Et justement les éleveurs, plus pragmatiques que les médecins, et ne s’embarrassant pas d’idées philosophiques, ont toujours su que leurs troupeaux pouvaient être frappés de maladies contagieuses et qu’il importait alors d’éloigner, ou d’isoler d’autres façons, la bête malade [9].
Dans un contexte d’élevage et d’agriculture, on isole donc le lépreux ; c’est une réaction paysanne toute naturelle, que Galien devenu médecin n’aurait probablement pas eue. Mais ce qui l’enchante, c’est que le recours tout à fait fortuit à la vipère a guéri le malheureux : en effet, notre médecin estime qu’il faut réduire et assécher les mauvais sucs responsables de la maladie, et il donne pour cela le précieux médicament à la chair de vipère. Quand Galien présente des récits de cas, ce n’est jamais pour le plaisir de raconter, mais toujours pour une bonne raison : ici il prétend trouver la preuve par une sorte d’expérimentation spontanée que son choix thérapeutique est le bon. Expérimentation truquée, histoire qu’on se répète, histoire mythique pour de savants médecins qui croyaient savoir mieux, histoire vraie pour le peuple des campagnes et pour ses vétérinaires. Malgré ses fortes réticences théoriques, Galien a admis la contagiosité de la lèpre, par le contact cependant avec une matière inerte et sans soupçonner un agent pathogène vivant, un germe actif. S’il avait parlé latin, peut-être aurait-il à son propos employé des syntagmes qu’on trouvait alors chez les vétérinaires, morbus contagiosus , passio contagiosa [10].
EN GUISE DE CONCLUSION
Adamantios Coray, de Chios, docteur de Montpellier, fondateur de la langue grecque moderne, repose au cimetière du Montparnasse. Ayant fui les Turcs qui gouvernaient durement sa chère terre grecque d’Asie mineure, il n’exerça pas la médecine mais se consacra à la traduction française de ses grands auteurs, médicaux surtout mais non exclusivement. En 1800 il publia à Paris, chez Baudelot et Éberhart, le texte qui nous a servi de point de départ, le Traité d’Hippocrate, des airs, des eaux et des lieux , traduction nouvelle avec le texte grec collationné sur deux manuscrits, des notes critiques, historiques et médicales, un discours préliminaire, un tableau comparatif des vents anciens et modernes, une carte géographique et les index nécessaires [11]. Dans le volume II, il évoque (p. 8) les maladies épidémiques, « maladies dépendantes de la constitution de l’air, et qui attaquent indistinctement plusieurs hommes à la fois, malgré la différence du régime qu’ils observent ». Et son idée (p. 69) pour lutter là-contre est celle d’une… grande muraille ! « Si l’on pouvait intercepter par un mur, toute l’influence d’un vent quelconque (…), on trouverait que les deux endroits séparés par ce mur auraient une température opposée. De là vient que certaines épidémies sévissent plus dans un quartier que dans un autre de la même ville (…). Baglivi observe qu’à Rome les quartiers les plus éloignés du Tibre sont les malsains, et que le phénomène a lieu même à de très petites distances ».
On le sait, la représentation du berger avisé et efficace a fait fortune dans la philosophie et la réflexion religieuse : chez les chrétiens ce fut le bon pasteur qui protège ses ouailles de la corruption et de la contagion morales. Auprès des médecins les plus avisés, l’image n’a pas fait mouche ; obnubilé par l’amour d’Hippocrate, confrère et compatriote, Coray en 1800 n’était pas encore au bout du chemin qui devait aboutir à l’affirmation de la contagion médicale.
ANNEXE
Éditions classiques des sources antiques :
• Celse,
De la médecine I-II CUF (Paris) ; III et s. Loeb (Londres).
• Galien,
Galeni opera omnia , ed. C. G. Kühn, 22 vol., Cnobloch 1821-1833 (Leipzig) :
Définitions médicales = K XIX ; De la différence des fièvres = K. VII ; Des facultés des médicaments simples = K XII ; Par quels médicaments … = K. XI ; De la méthode thérapeutique = K. XI.
• Hippocrate,
Œuvres complètes, ed. É. Littré, Baillière,1839-1861 (Paris) : Airs, eaux et lieux = L II, et CUF (Paris) ; Nature de l’homme = L VI ; Des vents = L VI, et CUF (Paris).
• Pline, Histoire naturelle , CUF (Paris).
• Plutarque,
Propos de table , CUF (Paris).
• Végèce,
Mulomedicina ( Médecine des chevaux ), Teubner (Stuttgart).
BIBLIOGRAPHIE [1] KIPLE K. — ed.
The Cambridge world history of human disease , Cambridge (Mass.), 1993 (lepra, malaria).
[2] GRMEK M. — Les maladies à l’aube de la civilisation occidentale. Paris, 1983, et La malaria dans la Méditerranée orientale, préhistorique et antique. Parassitologia , 1994, 36 , 1-6.
[3] GINOUVÈS R., GUIMIER-SORBETS A.-M., JOUANNA J., VILLARD L. — ed. L’eau, la santé et la maladie dans le monde grec. Supplément au Bulletin de correspondance hellénique, Athènes, 1994, 29 (avec notamment Collin-Bouffier S. – Marais et paludisme en Occident grec, 321-336 ;
Corvisier. J. -N. – Eau, paludisme et démographie en Grèce péninsulaire, 297-319 ; Villard F. – Les sièges de Syracuse et leurs pestilences, 337-344).
[4] GOUREVITCH D. — La medicina ippocratica e l’opere Delle arie, acque e luoghi. Breve storia della nascita e del potere di un’inganno scientifico. Medicina nei Secoli , 1995, 7 , 425-433.
[5] GOUREVITCH D. — Un éléphant peut en cacher un autre.
Mélanges Sabbah , Saint-Étienne, 2001, sous presse.
[6] GOUREVITCH D. — Une autre satyriasis. Médecine antique, philologie et histoire de l’art.
Medicina nei Secoli , 1995, 7 , 201-203.
[7] FERRON A. —
Bactériologie médicale . Paris, 1989 (la lèpre, chap. 48).
[8] DEBRU A. —
Le corps respirant. La pensée physiologique chez Galien , Leiden, 1996. et JOUANNA
J. – Miasme, maladie et semence de la maladie. Galien lecteur d’Hippocrate . Studi su Galen o,
Firenze : ed. Manetti D., 2000, 59-92.
[9] WILKINSON L. — Zoonoses and the development of concepts of contagion and infection . The advancement of veterinary science : the bicentenary symposium , Wallingford : ed. Michell
A.R.,1993, 73-90.
[10] GOUREVITCH D. — Une création lexicale continue, les dérivés en – osus dans le vocabulaire pathologique des médecins et des vétérinaires.
Les textes médicaux latins comme littérature .
Nantes : ed. Pigeaud A. et J., 2000, 113-126.
[11] JOUANNA J. — Place et rôle de Coray dans l’édition du traité hippocratique des Airs, eaux, lieux .
Médecins érudits, de Coray à Sigerist. Paris : ed. Gourevitch D., 1995, 7-24.
DISCUSSION
M. Gabriel BLANCHER
Hippocrate, Galien et leurs disciples ont-ils évoqué ou du moins soupçonné la théorie microbienne ?
Pas du tout, car l’idée de la pollution de l’air par des perturbations globales naturelles rend cette hypothèse inutile. C’est dans la littérature générale que sont évoqués des parva animalia invisibles, dans lesquels, dans leur désir de trouver des « précurseurs » à Pasteur, certains commentateurs contemporains ont voulu voir les microbes.
M. Jacques-Louis BINET
Est-ce que le rôle du moustique est évoqué dans le Traité des lieux, des airs et des eaux où le paludisme est décrit avec les caractères de la fièvre, la couleur des urines et les relations avec les saisons ?
On a des preuves paléozoologiques que l’anophèle vecteur du paludisme existait en Grèce bien avant la période classique. Mais aucun médecin n’a fait le rapprochement entre ce moustique et ces « fièvres ». Cf. Luigi Capasso et Gabriella di Tota : « Fossil Mosquitoes and the Origins of Human Malaria ». [Poster]. In Eve Cockburn, ed. Papers on Paleopathology Presented at the Eighth European Members Meeting of the Paleopathology Association, Cambridge, England, 19-22 September 1990, p. 8.
Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 5, 977-986, séance du 15 mai 2001